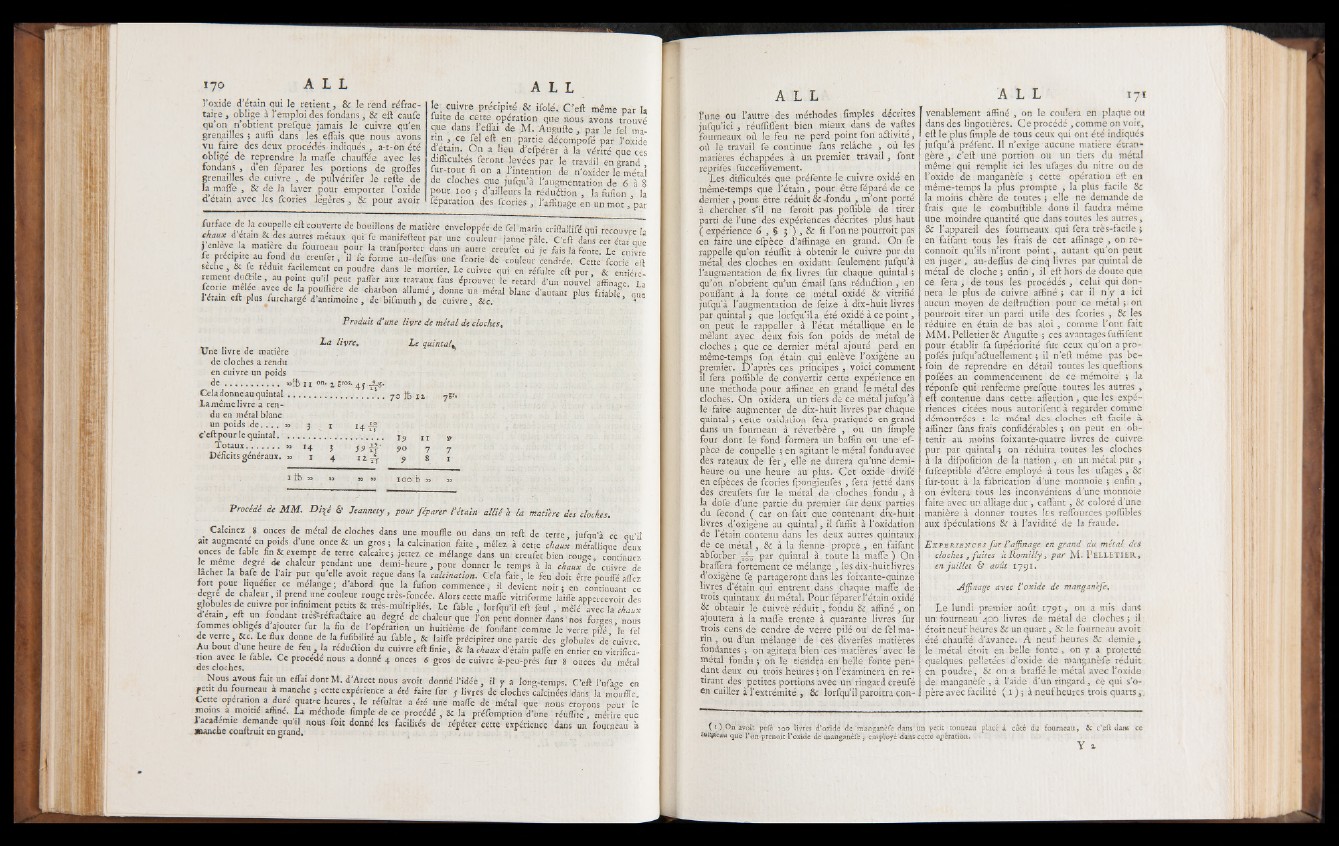
l'oxide d’étain qui le retient , & le rend réfractaire
y oblige à l’emploi des fondans, & eft caufe
qu’on n’obtient prefque jamais le cuivre qu’en
grenailles > auffi dans les effais que nous avons
vu faire des deux procédés-indiqués , a-t-on été
obligé de reprendre la maffe chauffée avec les
fondans , d’en féparer les portions de groffes
grenailles de cuivre * de puTvérifer le relie de
la malfe , & de la laver pour emporter l’oxide
d’étain avec les fcories légères , & pour avoir.
le cuivre précipité & ifolé.; C'eft même par I*
fuite de cette operation que nous avons trouvé
que dans l’eflai de M.Augufte , par le fel ma-
■5.ee jtïï partie décompofé par l’oxide
d etain. On a lieu d’efpérer à la vérité que ces
difficultés feront levees par le travail en grand ,
fur-tout fi on a l’intention de n’oxider le métal
de cloches que jufqu’à l’augmentation de 6 à 8
pour, ioo j d ailleurs la reduéiion , la fufion , la
feparation des fcories , l’affinage en un mot, par
iurface de la coupelle eft couverte de bouillons de matière enveloppée de fd’marin criiîalliCé qui recouvre la
chaux detam & des autres métaux qui'fe manifèfteut par une couleur . jaune'pâle. C'eft dus cet dta^ que
j enleve la matière du fourneau pour la tranfporter dans un autre creufet où je fais la fonte. l é cuivre
fe précipité au fond du creufet, il fe forme au-deffus-une fcorie de coàleur cendrée. Cette fcorie eft
seche ; & fe rédutt facilement en poudre dans le mortier. Le cuivre qui en réfulte eft pur, & entièré-
rement duâile, au point qu'il j>eut pafler aux travaux fans éprouver le têtard d'un nouvel affinage La
fcorie nnelee avec de la pouffiere de charbon allumé , donne un métal blanc d'autant plus ftiable que
1 étain eft plus^furchargé d antimoine j de bifmnth, de cuivre, &c. ' sj
Produit d'une livre de métal de cloches.
La livre. Le quintal.
U n e l iv r e de matiè re
d e c lo ch e s a rend u
en cu iv r e un poids
d e ............................ » f ë n on. 1 gros. ^ yJJS»
C e la donne au q u in t a l ............................ ..................... 7 0 Ife 12, ygr»
L a m êm e liv re a ren du
en métal b lan c
u n p o i d s .d e . . . . » ... 3 j 14 { j
c ’e ft p o u r le q u in ta l.................... i . ................................ l r ^
T o t a u x . ... ... » 14 3 S9:ij ’ 9 0 7 7
Déficits généraux. » 1 4 12 JL. 9 8 1
itb » » » » ioolb » »
Procède de MM. Diqé & Jeannety, pour féparer l’étain allié à la matière des cloches.
t Calcinez 8 onces de métal de cloches dans une mouffle ou dans un teft. de terre jufqu'à ce ou'il
ait augmente en potds d'une once & un gras; la calcination faite, mêlez à cette chaux métallique deux
onces de fable fin & exempt de terre calcaire; jetiez ce mélange dans- un creufet bien rouge, continuez
™en)e ,“ c^ r , , c“ aleur pendant une demi-heure , pour donner le temps à la chaux de cuivre de
“ Cher la bafe de l'air pur qu'elle avoit reçue dans la calcination. Cela fait, le feu doit être pouffé affcz
fort pour liquéfier ce mélangé; d'abord que la fufion commence, il devient noir; en continuant ce
degre de chaleur, .1 prend une couleur rouge très-foncée. Alors cette maffe vitriforme laiffe appercevoir des
globules de cuivre pur infiniment petits & très-multipliés. Le fable I lorfqn'il eft feul, mêlé avec la chaux
detam, eft un fondant tres-réfraftaire au degré de chaleurque îon peut donner dans'fios forges nous
iommes obliges d ajouter fur la fin de l'opération un huitième de fondant comme le verre pilé ' le fel
de verre, &c. Le flux donne de la fufibilité au fable, & laiffe précipiter une partie des globules de'cuivre
Au bout d une heure de feu la reduélion du cuivre eft finie, & la chaux d'étain pafl'e eh entier en vitrification
avec le fable. Ce procédé nous a donné 4 onces 6 gros de cuivre à-peu-près fur g ouces du métal
des cloches. - g j--. :i tU> .
Nous avons fait un eftai dont M. d’Arcet nous avoit donné l’idée, il y a long-temps. C’eft l’ufage en
jetit du fourneau à manche $ cette expérience a été faite fur 5 livres dé cloches calcinées dans; la mouffle.
€ette opération a duré quatre heures, le réfultat a été une mafle de métal que nous croyons pour le
moins a moitié affine. La méthode fimple de ce procédé , & la préemption d’une réuffite, mérire que
I academie demande qu’il nous foit donné les facilités de répéter cette expérience dans un fourneau à
manche conftruit en grand.
l’une ou l’autre des méthodes fimples décrites
jufqu’ici y réuffiffent bien mieux dans de vaftes
fourneaux où le feu ne perd point fon activité,
où le travail fe continue faas relâche , où les
matières échappées à un premier, travail y font
reprises fuccemvement.
Les difficultés que préfente le cuivre oxidé en
même-temps que l’étain, pour être féparé de ce
dernier , pour être réduit & -fondu , m’ont porté
à chercher s’il ne feroit pas poffible de tirer
parti de l’une des expériences décrites plus haut
( expérience 6 , § 3 ) , &: fi l’on ne pourroit pas
en faire une efpèce d’affinage en grand. On fe
rappelle qu’on réuffit à obtenir le cuivre pur du
métal des cloches en oxidant feulement jufqu’à
ï’augmentation de fix livres fur chaque quintal j
qu’on n’obtient qu’un émail fans réduction 3 _en
pouffant à la fonte ce métal oxidé & vitrifié
jufqu’à l’augmentation de feîze à dix-huit livres
par quintal 5 que lorfqu’ila été oxidé à ce point,
on peut le rappeller à l’état métallique en lé
mêlant avec deux fois fon poids de métal de
cloches ; que ce dernier métal ajouté perd en
même-temps fon étain qui enlève l’axigène au
premier. D ’après ces principes , voici comment
il fera poffible de convertir cette expérience en
une méthode pour affiner en grand le métal des
cloches. On oxidera un tiers de ce métal jufqu’à
le faire augmenter de dix-huit livres par chaque
quintal $ cette oxidation fera pratiquée en grand
dans un fourneau à réverbère , ou un fimple
four dont le fond formera un baffin ©u une efpèce
de coupelle 5 en agiiant le métal fondu avec
des rateaux de fer, elle ne durera qu’une demi-
heure ou une heure au plus. Ce t oxide divifé
en efpèces de fcories fpongieufes , fera jetté dans
des creufets fur le métal de . cloches fondu , à
la dofe d’une partie du premier fur deux parties
du fécond ( car on fait que contenant dix-huit
livres d’oxigène au quintal , il fuffit à l’oxidation
de 1’ étain contenu dans les deux autres quintaux,
de ce métal, & à la fienne • propre,, en faifant
abforber jËJ; par quintal à. toute la maffe ) On
braffera fortement ce mélange - , les dix-huit livres
d’oxigène fe partageront dans les foixante-quinze
livres d’étain, qui entrent dans chaque mane de.;
trois quintaux du métal. Pour fépar.eri’étain oxidé
& obtenir le cuivré réduit, fondu &, affiné , on
ajoutera à la maffe trente à quarante livres fur
trois cens de cendre de verre pilé ou de fel marin
, ou d’un mélange: de ces diverfes matières
fondantes j on agitera bien ces matières'avec lé
métal fondu j on le tiendra en belle fonte pen^
dant deux ou trois heures j on l’examinera en re-
tirant des petites portions avec un ringard creufé
en cuiller à l’extrémité , & lorfqu’il paroîtra convenabîement
affiné , on le coulera en plaque ou
dans des lingotières. C e procédé , comme on voit,
eft le plus fimple de tous ceux qui ont été indiqués
jufqua préfent. Il n’ exige aucune matière étrangère,,
c’eft une portion ou un tiers du métal
même qui remplit ici les ufages du nitre ou de
l’oxide de manganèfe ; cette opération eft en
même-temps la plus prompte , la plus facile &
la moins chère de toutes j elle ne demande de
frais que le combuftible don& il faudra même
une moindre quantité que dans toutes les autres,
& l’appareil des fourneaux qui fera très-facile >
en faifant tous les frais de cet affinage , on re-
connoît qu’ils n’iront point s autant qu’on peut
en juger, au-deffus de cinq livres par quintal de
métal de cloche ; enfin , il eft hors de doute que
ce fera y de tous les procédés , celui qui donnera
le plus de cuivre affiné j car il n ÿ a ici
aucun moyen de deftruétion pour ce métal ; on
pourroit tirer un parti utile des fcories , & les
réduire en étain de bas aloi, comme l’ont fait
MM. Pelletier & Augufte ; ces avantages fuffifent
pour établir fa fupériorité fur ceux qu’on a pro-
pofés jufqu’ aêtueliement ; il n’eft même pas be-
foin de reprendre en détail toutes les queftions
pofées au commencement de ce mémoire î la
rëponfe qui renferme prefque toutes les autres ,
eft contenue dans cette^ affertion , que les expériences
citées nous autorifent à regarder comme
démontrées : le métal des. cloches eft facile à
affiner fans frais confidérables ; on peut en obtenir
au moins foixante-quatre livres de cuivre
pur par quintal ; on réduira toutes les cloches
a la difpofîtion de la nation , en un métal pur 3
fufceptible d’être employé à tous les ufages j &
fur-tout à la fabrication d’une monnoie 5 enfin 3
on évitera tous les inconvéniens d’une monnoie
faite avec un alliage dur 3 caftant, & coloré d’une
manière à donner toutes les reftources poffibles
aux fpéculations &r à l’avidité de la fraude.
E x p é r i e n c e s fur Taffinage en grand du métal des
■ cloches s faites a Romilly 3 par M . PELLETIER,
ï en juillet & août 1791.
JÎffitiage avec Voxide de manganèfe.
Le lundi premier août 1791, on a mis dans
un- fourneau 400 livres de métal de cloches 5 il .
étoit neuf heures & un quart, & le fourneau avoit
été chauffé- d’avance. A neuf heures & demie,
le métal étoit en belle fonte , on y a proietté
quelques pelletées d’oxide de manganèfe réduit
en poudre, & on a braffé le métal avec l’oxide
de, manganèfe, à l’aide d’un ringard, cè qui s’opère
avec facilité (.1 ) j à neuf heures trois quarts ,.
(O,. On avoit pefé 100 livres d’oxidé de'manganèfe dans ün petit tonneau placé à côté du fourneau, & c’eft dans ce
teiyaeau que l’on-prenoft l’oxide de manganèfe j employé dans cette opération.