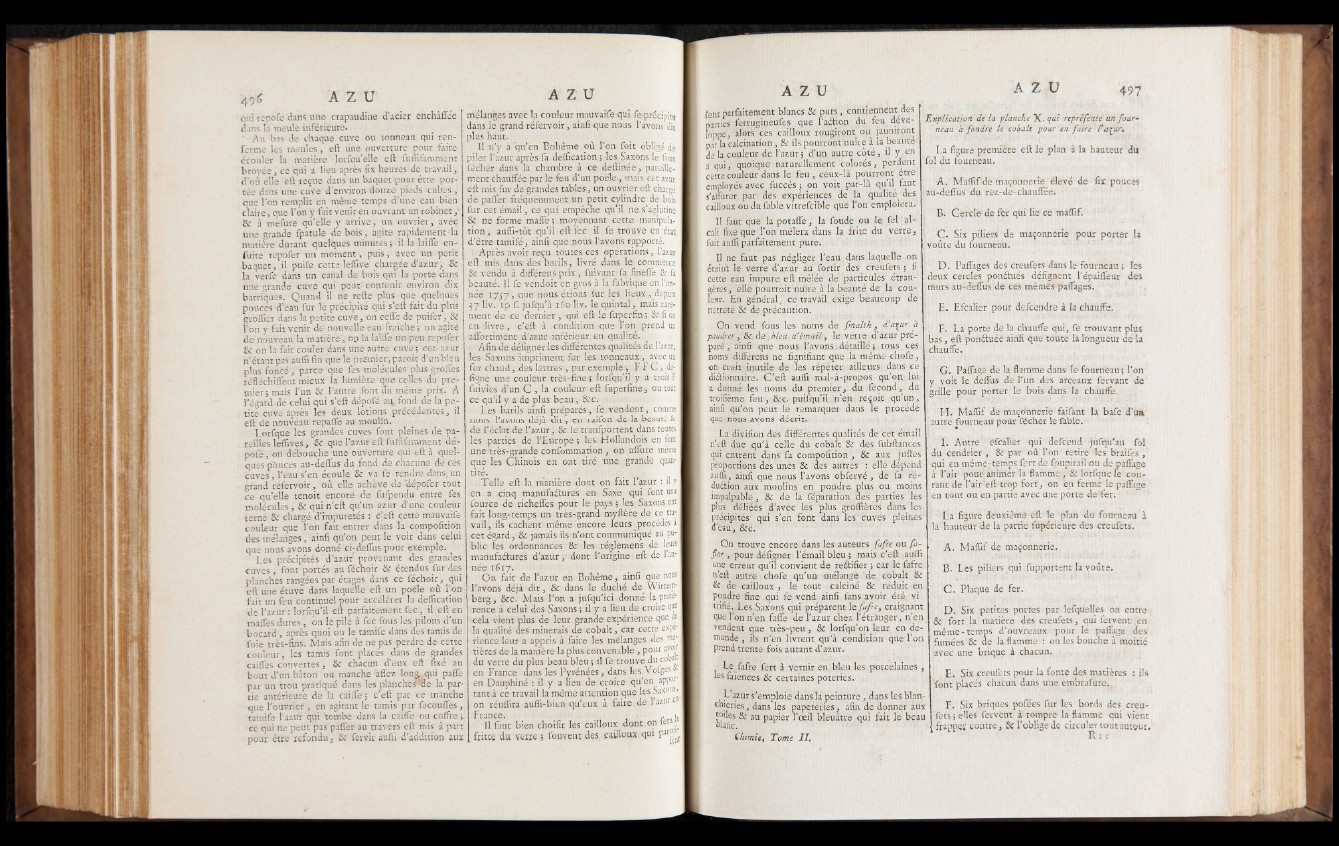
4 >)6 A Z U
qui repofe dans une crapaudine d’acier enchàffée
dans la meule inférieure*
' Au bas de chaque cuve ou tonneau qui renferme
les meules, eft une ouverture pour faire
écouler la matière lorfqu’elle eft fuffifamment
broyée, ce qui a lieu après fix heures de travail,
d'où elle eft reçue dans un baquet pour être portée
dans une cuve d'environ douze pieds cubes,
que l'on remplit en même temps d’une eau bien
claire, que l’on y fait venir en ouvrant un robinet ,•
& à mefure qu’elle y arrive, un ouvrier, avec
une grande fpatule de bois, agite rapidement la
matière durant quelques minutes; il la laiffe en-
fuite repofer un moment, puis, avec un petit
baquet, il puife cette leflive chargée d’azur, &
la verfe dans un canal de bois qui la porte dans
une grande cuve qui peut' contenir environ dix
barriques. Quand il ne refte plus que quelques
pouces d’eau fur lè précipité qui s’eft fait du plus
greffier dans la petite cuve, on eeffe de puifer, &
l'on y fait venir de nouvelle eau fraîche; on agite
de:nouveau la matière, on la laiflè-un peu repofer
& on la fait couler dans une autre cuve'; cet azur
n étant pas auffi fin que le premier, parOÎt d’un bleu
plus foncé , parce- que fes molécules plus-greffes
réfléchiflent mieux la lumière que celles du premier;
mais l’un & l ’autre font du même prix. A
l’égard de celui qui s’eft dépofé au, fond de la petite
cuve après les deux lotions precedentes, il
eft de nouveau repaffé au moulin. -
Lorfque les grandes cuves font pleines, de pareilles
leffives, & que l’azur eft fuffifamment dépofé,
on débouche une ouverture qui eft à quelques
pouces au-deffus du fond de çhacunê dé ces
cuves, l’ eau s’en écoula & va fe rendre dans.un
grand réfervoir, où elle achevé de depofer tout
ce quelle tenoit encore de fufpendu entre fes
molécules, & qui n’ eft qu’un azur d'une couleur
terne & chargé d’impuretés : c’ eft qette mauvaife ]
couleur que l'on fait entrer dans la compofition
des mélanges, ainfi qu'on peut lè voir dans celui
que nous avons donné ci-deffus pour exemple.
Les précipités d’azuf provenant des grandes
cuves, font portés au féchoir & étendus fur des
planches rangées par étages dans ce féchoir, qui
eft une étuve dans laquelle eft un poêle où l’on
fait un feu continuel pour accélérer la déification
de l’azur; lorfqu’il eft parfaitement fec, il eft en
maffes dures, on le pile à fec fous les pilons d’un
bocard, après quoi on le tamife dans des tamis de
foie très-fins. Mais afin de ne pas perdre de cette
couleur, les tamis font places dans de grandes
caiffes couvertes, & chacun d’eux eft fixé au
bout d’un bâton ou manche allez lon&reui pafife
par un trou pratiqué dans les planchfes*He la partie
antérieure de la càifle ; c’eft par ce manche
que l’ouvrier, en agitant le tamis par fecoulfes,
tamife l'azur qui tombe dans la caillé ou coffre ;
ce qui ne peut pas paffer au travers eft mis à part
pour être refondu, & fervir auffi d’addition aux
A Z U
mélanges avec la couleur mauvaife qui fe-précipit®
dansJe grand réfervoir* ainfi que nous ' T avons dit
plus haut.
Il n’y a qu’en Bohême où l’on foit obligé de
piler l’azur après fa déification ; des Saxons le fout
féchér dans la chambre à ce deftinée * pareillement
chauffée par le feu d’un poêle* mais cet azur
eft mis fur de grandes tables* un ouvrier eft chargé
de paffer fréquemment un petit cylindre de bois
fur cet émail * ce qui empêche qu’il ne.s’aglutine
& ne forme maffe ; moyennant cette manipulation*
auffi-tôt qu’il eft fec il fe trouve en état
d’être tamifé * ainfi que nous l’avons rapporté.
Après avoir reçu toutes ces opérations * l’azur
eft mis dans des barils* livré dans le commerce
& vendu à différens prix > fuivant-fa fiheffe & fa
beauté. Il fe vendoit en gros à la Fabrique en l’année
1757* que nous étions fur les lieux * depuis
: 37 liv. ip f. jufqu’ à 16© liv. le quintal* mais rarement
-de ce dernier * qui eft le fuperfin 5 & fi on
en livre* c’eft à condition que l’on prend un
alTortiment d’azur inférieur en qualité.
Afin de défigner les différentes qualités de l’azur,
les Saxons impriment fur les tonneaux* avec un
fer chaud* des lettres * par exemple *, F F C* dé*
ligne une couleur très-fine ; lorfqu’il y a trois F
fuivies d’un C * la couieuç eft fuperfîne* ou tout
ce qu’il y a de plus beau * ‘Ifeu
Les barils ainfi préparés, fe vendent * comme
nous l’avons déjà dit, en raifon de la beauté &
de l’éclat de l’azur* & fe tranfportent dans toutes
les parties de l’Europe ; les Hollandois en font
une très-grande confommation , on affure même
que les Chinois en ont tiré: une grande quantité.
. I M
. Telle eft la manière dont on fait l’azur : il y
en a cinq manufactures en Saxe qui font une
fource de richeffes pour le pays ; les Saxons ont
fait long-temps un très-grand; myftère de ce travail*
ils cachent même encore leurs procèdes a
cet égard* & jamais ils n’ont communiqué au public
les ordonnances & les réglemeris de leurs
manufacturés d’azur * dont l’origine eft de 1 année
1617.
On fait de l’azur en Bohême* ainfi que nous
l’avons déjà dit* & dans le duché de Wirtem-
berg* &c. Mais l’on a jufqu’ici donné la préférence
à celui des Saxons ; il y a lieu de croire que
cela vient plus de leur grande expérience que ®
! la qualité des minerais de cobalt * car cette expérience
leur a appris à faire les mélanges des ma;
tières de la manière la plus convenable * pour avoir
du verre du plus beau bleu ; il fe* trouve du coba |
en France dans les Pyrénées* dans les/Vofges
en Dauphiné : il y a lieu de croire qu’en appor
tant à ce travail la même attention que les Saxons, |
on réuffira auffi-bien qu’eux à faire de. l’azur e
France. * f l
Il faut bien choifir les cailloux dont.on ter
fritte du verre ; fouvent des, cailloux qui Par° nJ
A Z U A Z U 4 9 ?
fent parfaitement blancs Sc puis * contiennenydes
parties ferrugineufes que, l’aCtion du feu deye-
(oppe* alors ces cailloux rougiront ou jauniront
par la calcination * & ils pourront nuire à^ la beauté -'
de la couleur de l’azur ; d’un autre côté * il y en
a qui* quoique naturellement colorés * perdent
cette couleur dans le. feu * ceux-là pourront être
employés avec fucçès j on voit par-là qu’il faut
s’affurer par des expériences de la qualité des
cailloux ou du fable vitrefcible que l’on emploiera.
Il faut que la potaffe * la foude ou le. fel alcali
fixe que l’on mêlera dans la frite du verre*
foit auffi parfaitement pure/
Explication de la planche X. qui représente un four-
neau a fondre le cobalt pour en faire l* azur,
La figure première eft le plan à la hauteur du
fol du fourneau.
A. Maffif de maçonnerie élevé de fix pouces
1 au-deffus du rèz-de-chauffée.
B. Cerclé de fer qui lie ce maffif.
» C . Six piliers de maçonnerie pour porter la
voûte du fourneau.
Il ne faut pas négliger l’eau dans laquelle on j
éteint le verre d’azur au fortir des creüfets $ fi
cette eau impure eft mêlée de particules étrangères*
ellë pourroit nuire à la beauté de la couleur.
En général j ce travail exigé beaucoup de
netteté & de précaution.
On vend fous les noms de fmalth * d'azur a
poudrer 3 & de .bleu d'émail* le verre d’azur préparé*
ainfi que nous l’avons.détaillé ; tous ces
noms différens ne lignifiant que la même chofe*
on croit inutile de les répéter ailleurs dans ce
di&ionnaire. C ’eft auffi mal-à-propos qu’on lui
a donné les noms du premier* du fécond* du
troifième feu* &cç. puiiqiiil n’en reçoit qu’un*
ainfi qu’on peut le remarquer dans le procédé
que nqus ayons décrit.
La divifion des différentes qualités de cet émail
n’eft due qu’à celle du cobalt & des fubftances
qui entrent dans fa compofition * & aux julles
proportions des unes & des autres : elle dépend
auffi, ainfi que nous l’avons obfervé* de fa Réduction
aux moulins en poudre, plus ou moins
impalpable* & de la réparation des parties les
plus déliées d’avec les plus grbffières dans les.
précipités qui s’en font dans les "cuves pleines’
à eau* &c.
On trouve encore dans les auteurs fafre ou fa-
flor 3 pour défigner l’émail bleu} mais c’eft auffi
une erreur qu’il convient de rectifier ; car le fafre
n’eft autre chofe qu’un mélangé de cobalt &
& de cailloux , le tout calciné & réduit en.
poudre fine qui fe vend ainfi fans avoir été vi
trifié. Les Saxons qui préparent le fafre, craignant
que l’on n’en faffe de l’azur chez l’étranger, n’en
vendent que très-peu * & lorfqu’on leur en demande
* ils n’en livrent qu’à condition que l’on
prend trente fois autant d’azur.
D. Paffages des creüfets dans le fourneau * les
deux cercles ponCtués désignent l’épaiffeur des
murs au-deffus de ces mêmes paffages.
E. Efcalier pour defeendre à la chauffe.
F. La porte de la chauffe qui* fe trouvant plus
bas* eft ponctuée ainfi que toute là longueur dé la
chauffe.
G. Paffage de la flamme dans le fourneau;Ton
y voit le deffiis de l’un des arceaux fervant de
grille pour porter le bois dans la chauffe.
H. Maffif de maçonnerie faifant la bafe d’ua
; autre fourneau pour fécher le fable.
I. Autre ‘ éfcalier qui defeend jufqu’au fol
du cendrier , & par où l’on retire les braifes *
qui en mêm^temps fert de foupirail ou de paffage
à l’air pour animer la flamme *-:& lorfque le courant
de l’air’eft trop fort* on en ferme le paffage
en tout ou en partie avec une porte de fer.
La figuré deuxièmé eft le plan du fourneau à
là hauteur de la partie fupérieure des creüfets.
A. Maffif de maçonnerie.
B. Les piliers tqui fupportent la Yoûte.
C . Plaque de fer.
D. Six petites portes par lefquelles on entre
& fort la matière des creüfets* qui fervent en
même-temps d’ouvreaux pour le paffage des
fumées & de la flamme : on les bouche à moitié
lavée une brique à chacun.
: Le fafre fert à vernir en bleu les porcelaines *
les faïences & certaines poteries.
L azur s’emploie dans la peinture *sdans les blan-
chieries * dans les papeteries * afin de donner aux
toiles & au papier l’oeil bleuâtre qui fait le beau
blafic.
Chimie, Tome I I ,
E. Six creüfets pour la fonte des matières : ils
font placés chacun dans une embrafure,.
F. Six briques pofées fur les bords des creu-
Tets ; elles fervent à rompre la flamme qui vient
frapper contre* Sc L oblige de circuler tout autour.
R it