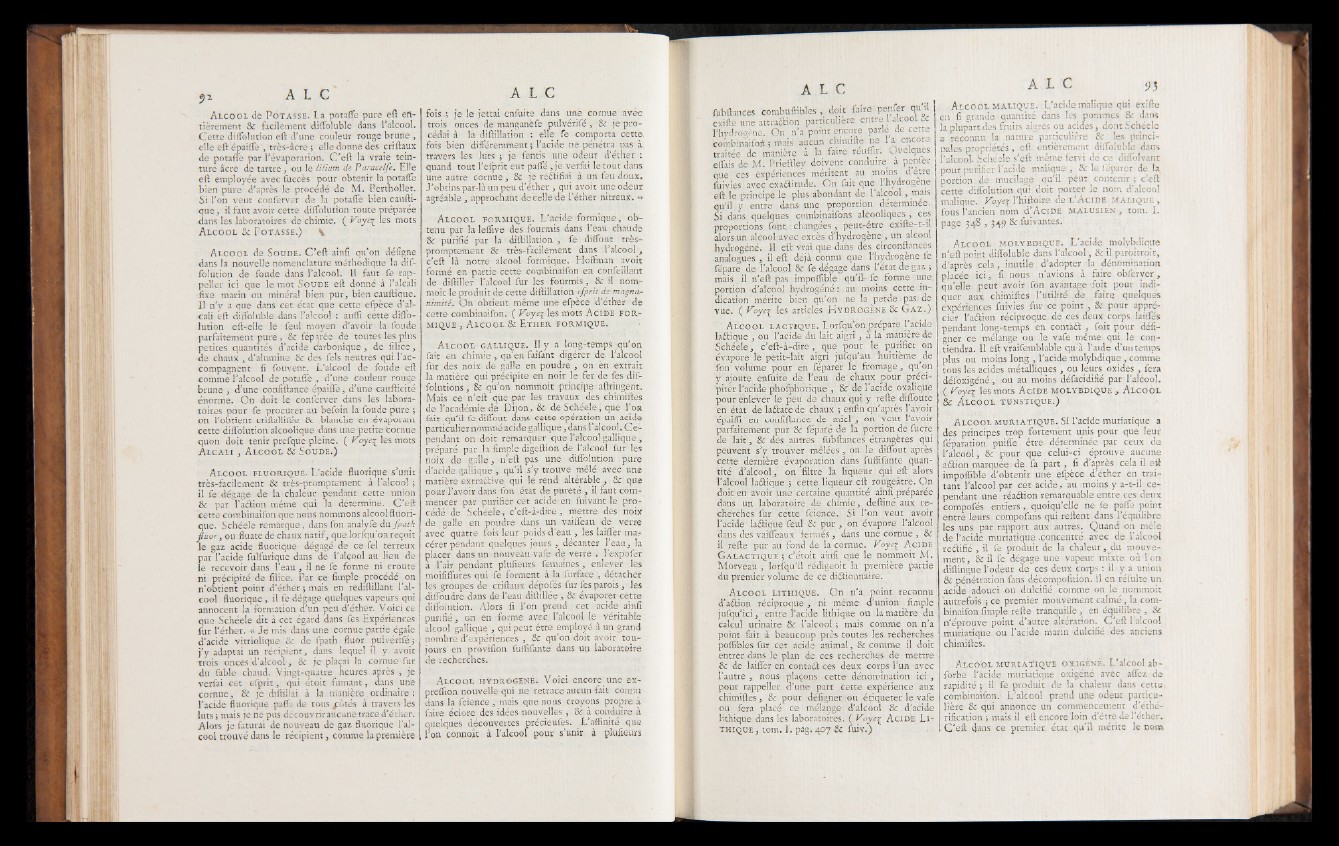
Alcool de P otasse. La pouffe pure eft entièrement
8c facilement diffoluble dans l'alcool.
Cette diffolution eft d’une couleur rouge brune *
elle eft épaiffe * très-âcre î elle donne des criftaux
de potaffe par l’évaporation. C ’eft la vraie teinture
âcre de tartre * ou le lilium de Paracrlfe. Elle
eft employée avec fuccès pour obtenir la potaffe
bien püre d’après le procédé de M. Berthollet.
Si l’on veut conferver de la potaffe bien eau (tique
* il faut avoir cette diffolution toute préparée
dans les laboratoires de chimie. ( Voye% les mots
A lcool & Potasse.) \
Alcool de Soude. C ’eft ainfi qu’on défigne
dans la nouvelle nomenclature méthodique la diffolution
de foude dans l’alcool. 11 faut fe rap-
peller ici que le mot Soude eft donné à l’alcali
fixe marin ou minéral bien pur* bien cauftique.
Il n’y a que dans cet état que cette efpèce d’alcali
eft diffoluble dans l’alcool : aufli cette diffolution
eft-elle le feul moyen d’ avoir la foude
parfaitement pure, 8c féparée de toutes les plus
petites quantités d’ acide carbonique 3 de filice *
de chaux * d’alumine 8c des fels neutres qui l’accompagnent
fi fouvent. L’alcool de foude eft
comme l’alcool de potaffe*. d’une couleur rouge
brune * d’une confiftance épaiffe * d’une caufticité
énorme. On doit le conferver dans les laboratoires
pour fe procurer au befoin la foude pure j
on l’obtient criftallifée & blanche en évaporant
cette diffolution alcoolique dans une petite fcornue
quon doit tenir prefque pleine. ( roye^ les mots
A lcali 3 A lcool & Soude.)
Alcool fluorique. L’acide ftuorique s’ unit
très-facilement & très-promptement à l’alcool ;
il fe ,dégage de la chaleur pendant cette union
& par l’a&ion même qui la détermine. C ’eft
cette combinaifon que nous nommons alcool fluorique.
Schéele remarque, dans fon analyfe du fpath
fluor3 ou fluatede chaux natif* que lorfqu’on reçoit
le gaz acide fluorique dégagé de ce fel terreux
par l’acide fiilfurique dans de l’alcool au lieu de
le recevoir dans l’eau * il ne fe forme ni croûte
ni précipité de filice. Par ce fimple procédé on
n’obtient point d’éther 5 mais en rediftillant l’alcool
fluorique * il fe dégage quelques vapeurs qui
annocent la formation d’un peu d’éther. Voici ce
que Schéele dit à cet égard dans fes Expériences
fur l’éther. « Je mis dans une cornue partie égale
d’acide vitriolique & de fpath fluor pulvérifé j
j’y adaptai un récipient* dans lequel il y avoit
•trois onces d’alcool * 8c je plaçai la cornue fur
du fable chaud. Vingt-quatre heures après * je
verfai cet efprit * qui étoit fumant, dans une
cornue* 8c je diftillai à la manière ordinaire :
l’acide fluorique paffa de tous ƒ ôtés à travers les
iuts î mais je ne pus découvrir aucune trace d’éther.
Alors je faturai de nouveau de gaz fluorique l’alcool
trouvé dans le récipient * comme la première
fois,; j e le jettai enfuite dans une cornue avec
trois onces de manganèfe pulvérife, 8c je procédai
à la diftillation : elle fe comporta cette,
fois bien différemment ; l’acide ne pénétra pas à
travers les luts ; je fentis une odeur d'éther :
quand tout l’efprit eut paffé,je verfai le tout dans
une autre cornue, 8c je rèétifîai à un feu doux.
J’obtins par-là un peu d’éther, qui avoit une odeur
agréable j approchant de celle de l’éther nitreux. ».
A l c o o l formique. L’acide formique, obtenu
par la leffive des fourmis dans l’eau chaude
& purifié par la 1 diftillation , fe diffout très-
promptement & très-facilement dans l’alcool,
c’eft là notre alcool formique. Hoffman avoit
formé en partie cette combinaifon eh confeillant
de diftiller l’alcool fur les fourmis, 8c il nom-
moit le produit de cette diftillation efprit de m agnanimité.
On obtient même une efpèce 'd’éther de
cette combinaifon. ( foye\ les mots Acide formique
, Alcool & Ether formique-.
Alcool■ gaélique. 11 y a long-temps ,qu’on
fait en chimie, qu’en faifant digérer de. l’alcool
fur des noix de galle en poudre , on èn extrait
la matière qui précipite en noir le fer de fes dif-
folutions, 8c qu’ on nommoit principe aftringent.
Mais ce n’eft que par les travaux des chimiftes
de l’académie de Dijon, & de Schéele, que l’on
fait qu’il fe diffout dans cette opération un acide
particulier nommé acide gallique, dans l’alcool. Cependant
on doit remarquer que l’alcool gallique ,
préparé par la fimple digeftion de l’alcool furies
noix de galle, n’eft pas une diffolution pure
d’acide gallique , qu’il s’y trouve mêlé avec une
matière extraétive qui le rend altérable,. & que
pour l’avoir dans fon état de pureté, il faut commencer
par purifier c'et acide èn fuivant le procédé
de Schéele; c’eft-à-dire, mettre des noix
de galle en poudre dans un vaiffeau de verre
avec quatre fois leur poids d’eau , les Iaiffer macérer
pendant quelques jours , décanter l’eau, la
placer dans un nouveau, vafe de verre , l'expèfer
à l’ air pendant plufiéurs femaines, enlever les
moififfures qui -fe forment à la furface , détacher
les groupes de criftaux dépofés fur fes parois, les
diffoudre dans de l’eau diftiUée , & évaporer-cette
diffolution. Alors fi l’on prend cet acide ainfi
purifié, on en forme avec l’alcool le véritable
alcool 'gallique , qui peut être employé à un grand
nombre d’expériences & qu’on doit avoir toujours
en provifion fuffifante dans un laboratoire
de recherches.
Alcool hydrogéné. Voici encore une ex-
preffion nouvelle qui ne retrace aucun fait’ connu
dans la fcience, mais que nous croyons propre, à
faire éclore des idées nouvelles , & à conduire à
quelques découvertes préc-ieufes. , L’affinité que
l’on connoît à l’alcool pour s'unir à plufieurî
fubftances combuftibles , doit faire" penfer qu’il
exifte une attraêtion particulière entre 1 alcool oc
L hydrogène.- On n'a. point encore parle de cette
combinaifon ; mais aucun chimille ne 1 a. encore
traitée de manière à la faire reuffir. Quelques
effais de M. Prieilley doivent conduire a penler
que ces èxpériences méritent ^ au moins d être
fuivies avec exactitude. On fait que 1 hydrogéné
eft le principe le plus abondant de l'alcoôl * mais
qu'il y entre dans une proportion déterminée.
Si dans quelques combinaifons alcooliques * ces
proportions font, changées * peut-être exifte-t-il
alors un alcool avec excès d’hydrogène * un alcool
hydrogéné. 11 eft vrai que dans des^ circonftances
analogues* il eft déjà connu que l'hydrogène fe
fépare de F alcool & fe dégage dans l'état de gaz ;
mais il n'eft pas impofîible qu'il- fe forme une
portion d'alcool hydrogéné: au moins cette indication
mérite bien qu'on ne la perde , pas'de
vue. ( Voye^ les articles Hydrogène 8c Ga z .)
Alcool lactique. Lorsqu'on prépare l'acide
laétique * ou l'acide du lait aigri * à la manière de
Schéele* c'eft-à-dire* que pour le purifier on
évapore le petit-lait aigri jufqu'au huitième de
fon volume pour en féparer le fromage* qu'on
y ajoute enfuite de. l'eau de chaux pour précipiter
l'acide phôfphorique * &r de l'acide oxalique
pour enlever le peu de chaux qui y refte diffôüte
en état de laêlate de chaux ; enfin qu'après l'avoir
épaiffi en confiftance de miel* on veut l'avoir
parfaitement pur & féparé de la portion de fucre
de lait* & des autres fubftances étrangères qui
peuvent s'y trouver mêlées* on le diffout après
cette dernière évaporation dans fuffifante quantité
d'alcool* on filtre la liqueur qui eft alors
l'alcool laêtique > cette liqueur eft rougeâtre. On
doit en avoir une'certaine quantité ainfi préparée
dans un laboratoire de chimie* delliné aux recherches
fur cette fcience. Si l'on veut avoir
l'acide la&ique feul 8c pur * on évapore l'alcool
dans des vaiffeaux fermés * dans une cornue * 8c
il refte pur au fond de la cornue. Voyeç A cide
Galactique ; c'étoit ainfi que le nommoit M.
Morveau * lorsqu'il rédigeoit la première partie
du premier volume de ce dictionnaire.
Alcool lithique. On n'a point reconnu
d'action réciproque * ni même d'union , fimple
jufqu'ici* entre l'acide lithique ou la matière du
calcul urinaire & l'alcool ; mais comme on n'a
point fait à beaucoup près toutes les recherches
poffibles fur cet acide animal* & comme il doit
entrer dans le plan de ces recherches de mettre 1
8c de Iaiffer en contaCt ces deux corps l'un avec
l'autre * nous plaçons cette dénomination ici *
pour rappeller d'une part cette expérience aux
chimiftes* 8c pour défigner ou étiqueter le vafe
ou fera placé ce mélange d'alcool 8c d’acide
lithique dans les laboratoires. ( Voye^ A cide Lithique*
tom. I. pàg. 407 8c fuiv.)
A lcool MALIQUE. L’acide malique qui exifte
en fi grande ■ quantité dans les pommes & dans
la plupart,des fruits aigres ou acides, dont Schéele
a reconnu la nature particulière 8c les principales
propriétés, eft entièrement diffoluble dans
f alcool. Schéele s’eft même fervi dé ce diffolvant
.pour purifier l’acide malique , 8c le féparer de la
portion de mucilage qu’il peut contenir ; c’eft
cette diffolution qui doit porter Je nom d’alcool
malique. Voyet^1 hiftoire de L A cide m a l iq u e ,
fous l’ancien nom d’ Acide malusien , tom. I.
page 348,349 8c fuivantes.
. Alcool molybdique. L’ acide molybdique
n’eft point diffoluble dans l’alcool, 8c il paroîtroit,
d'après cela, inutile d’adopter la dénomination
placée ici, fi nous n’avions à faire obferver,
qu’elle peut avoir fon avantage foit pour indiquer
aux chimiftès l’utilité de faire quelques
expériences fuivies fur ce point, 8c pour apprécier
l’aélion réciproque de ces deux corps laiffés
pendant long-temps en contait , foit pour défigner
ce mélange ou lfe vafe même-: qui le contiendra.
Il eft vraifemblable qu’à l'aide d’un temps
plus ou moins long , l'acide molybdique , comme
tous les acides métalliques, ou leurs oxides , fera
déloxigéné, ou au moins défacidifié par l'alcool.
(( Foyej les mots A cide molybdique , A lcool
8c A lcool tunstique.)
A lcool muriatique. Si l’acide muriatique a
des principes trop fortement unis pour que leur
réparation puiffe être déterminée par ceux de
l’alcool, 8c pour que celui-ci éprouve aucune
aâion marquée de fa part, fi d’après cela il eft
impoffible d’obtenir une efpèce d’éther en traitant
l'alcool par cet acide, au moins y a-t-il cependant
une -réaétion remarquable entre ces deux
compofés entiers ,. quoiqu’elle ne fe paffe point
entre leurs, compofans qui relient dans l’équilibre
les uns par rapport aux autres. Quand on mêle
de l’acide muriatique .concentré avec de l’alcool
reétifié , il fe produit de la chaleur, du mouvement,
8c il fe dégage une vapeur mixte où l'on
diftingue l’odeur de ces deux corps : il y a union
8c pénétration fans décompofition. Il en réfulte un
acide adouci ou dulcifié comme on le nommoit
autrefois ; ce premier mouvement calmé, la combinaifon
fimple refte tranquille, en équilibre, &
n’éprouve point d’autre altération. C ’eft l ’alcool
muriatique ou l’acide marin dulcifié des anciens
chimiftes.
Alcool muriatique oxigéné. L’ alcool ab-
forbe l’âcide muriatique oxigéné avec affez de
rapidité ; il fe produit d e là chaleur dans cette.
combinaifon. L’alcool prend une odeur particulière
8c qui annonce un commencement d’éthérification
; mais il eft encore loin d’être de l’éther,
C ’eft dans ce premier, état qu’il mérite le noua