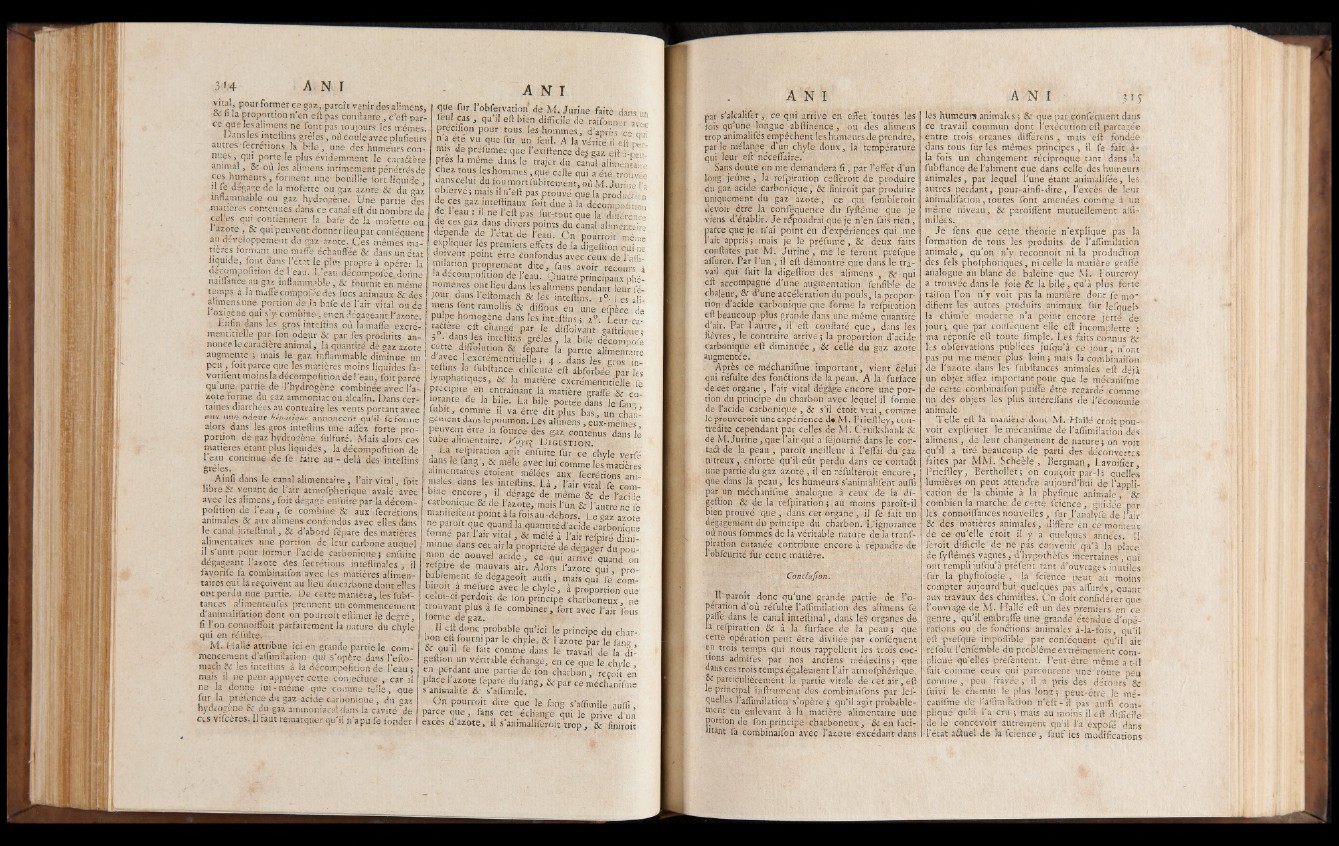
.314 A N I
vital pourformer ce gai,.paraît vc-Rirdesalimçns,
oc li la proportion n'en eft pas confiante, c'eft parce
que les alimens ne font pas toujours les mêmes.
Lan s les inteftins greles , où Coule avec plufieurs
autres fécretions la b:le , une des humeurs connues
j qui porte le plus évidemment le caractère
animal, & ou les alimens intimement pénétrés de
ces humeurs , forment une bouillie fort liquide,
il fe dégage de la mofette ou gaz azote & du °az
inflammable ou gaz hydrogène. Une partie des
matières contenues dans ce canal eft du nombre de
celes qui contiennent la bafe de la mofette ou
razote, & quipeuvent donner lieu par conféquent
au développement du gaz azote. Ces mêmes matières
formant une maffe échauffée 8c dans un état
liquide, lotit dans Tétât le pîfrs propre à opérer la
décompofition dé l'eau. T'eau décompofée doiine 1
naiflafice au gaz inflammable, & foùrnit en' même i
temps à la mufle compoféedes fucs animaux des
alimens une portion de la bafe de l'ait vital ou de !
1 oxygène qui- syebmbinè^èn-en Hégageantd'azote. *
Enfin dans lés gros inteftins où la maffe excrér I
mentitielle par fon odeur & par ,fes produits annonce
le caradereanimal, la quantité dê gaz azote •
augmente > mais le gaz inflammable diminue un
peu , foit parce que les matières moins liquides ,fa-
vojifent moins la décompofition de ! eau, foit parcé
qu une partie de l'hydrogène combinée avec Tapote
forme du gaz ammoniac oii alcalin. Dans cer^
taines diarrhées au contraire les vents portant avec
eux une odeur hépatique annoncent qu'if fe forme i-
alors dans les gros inteflins une affez forte proportion
de gaz hydrogène fulfuré. Mais alors ces
matières étant plus liquidés, la décompofition de
Teau continue de fe faire au-delà des inteflins
grêles.
; Ainfi dans le canal alimentaire, l'air vital, foit
libre & venant de l'air atmofphérique avalé-avec
avec les alimens, foit dégagé enfuice par la décompofition
de 1 eau, fe combine & aux fecréti on s
animales & aux alimens confondus avec elles dans*
le canal ir.teftinal, & d'abord fépare des matières
alimentaires une portion de leur carbone auquel
il s'unit pour former l'acide carbonique § enflüte
dégageant l'azote des fecrétions inteflinaîes , il
fayorife la combinaifon ayec lès matières alimentaires
qui la reçoivent au lieu du carbone dont elles
ont perdu une partie. • De cette manière, les fubl-
tances aümenteufes prennent un.commencement
d'animalifation dont on pourroit eflimer le degré,
fi Ton connoiffoit -parfaitement la nature du chyle
qui en réfulte.
xM. Halle attribue içi en grande partie le commencement
d'aflimilatipn qui s'opère dans Teflo- ■
mach 8c ies inteflins a la décompofition de Teau j
mais il ne peut appuyer cette, conjeéture car il I
ne la donne lui-même que comme telle, que
fur la préfence du gaz acide'carbonique, dû eaz
hydrogène 8c du gaz ammoniacal dans la cavité "de
ccs Yifcères. Il faut remarquer qu'il n’apu fe fonder I
a n r
que fur lobfervation* de M, Jurine faite dans un
feul ,f.as j qu il eft bien difficile dç rai Tonner avi r
preemon pour tous les hommes.* d'après ce Ltj
n a ete vu que fur un feul. A la vérité i! eft neî-
mis de prelumer que lexiftence desgaz eiB-pt r
près la meme dans le trajet du canal alimenta..',,
chez tous les hommes , que colle qui a été tronv- c
dans celui du fou uiort fubiterpent, où Jv]. Jur|nf. i •
obfetvé; mais il n’eil pas prouvé que là produiben
de ces gaz mteftinaux foit due à la décompom,,."
ae 1 eau : il. ne l'eft pas lur-tout que la ditféren'»
de ces gaz dans divers points du canal alimentaire
dépende de J état de l'eau. On pourrait même
expliquer les premiers effets déjà digeftion qui ne
doivent point être confondus avec ceux de l'affi-
tnilation proprement dite* fans avoir recours i
la dL-compofition de. l'eau. Quatre principaux phénomènes
ont heu dans les alimens pendant leurfé-
jour dans.l eftomach & les inteflins. i 1*- le s alimens
font ramollis & diffous, en une' efpèce de
pulpe homogène dans les, inteflins.;, 4fj. Leunca-
r^tere eft changé par le diffolvant gaftrique;
, • daI]?ie? niteitii.s grêles, la bile décpmpofe
cette diffolution & fépare la partie alimentaire
d ayec excrementitielle ; 4 ,. dans -les grosain-
teflins la fubftance-ichileiile eft abforbéê parles
lymphatiques; 8ç la matière excrémentitiellè fe
précipité en entraînant la matière greffe .& colorante
de la bile. La bile portée dans le fan»
lubit* comrrte il va,être dit plus bas, un changement
dans lepoutnon. Les alimens * eux-mêihes
peuvent être la fôurce des gaz contenus dans le
tube alimentaire. Poye^ Digestion.
La refpiration agit enfuitefur ce chyleviverfe
dans le. ftngmêlé;.avec lui comme les matières
alimentaires étoicnt mêlées aux fecrétions animales,
.dans les ^inteflins. Là * l'air vital fe; combine
encore, il dégage dé même & de l'acide
carbonique & de T azote, mais l'un & l'antrene fe
manfteitent point àla fois au-dehors. Le gaz azote
ne parait que quand la quantité d'acide carbonique
forme, par l'air vital , & mêlé à l'air refpiré dimi-
minue.dans cetgirla propriété de dégager dijipou-
mon de nouvel acide , ce .qui, arrive quand ou
refpire.de mauvais air. Alors l'azote qui . nro-
bablement fe dégàgeoit auffi, mais qui. fe com-
bipou a mefure avec le chyle, .à proportion eue
cerni ci perdoit de fon principe charboneux, ne
trouvant plus a fe combiner, fort avec l'air fous
iornie de gaz.
Il eft donc probable qu'ici le principe du char-,
bon eft fourni par le chyle, 8c l'azote par le fang
& qu il fe fait comme dans le travail de la di-
geition un véritable échange, en ce que le. chyle
en peroant une partie de fon charbon, reçoit- en
place 1 azote feparé du fang, & par ce méchanifme
s anierjalile & s'aflimile.
On pourroit dire que le fang s'affimile .auflî,
parce que , fans cet échange qui le prive d un
exces d azote, il s'animaliferoit trop,. & finiroit
A N I A N I 315
par s’alcalifer,, ce qui arrivé en effet 'routés les
fois qu'une longue abflinence, ou des alimens
trop animalifés empêchent les humeurs de prendre,
par le mélange d'un chylè doux,, la température
qui leur eft nécefîaire.
Sans doute on me demandera f i , par reffet d’un
long jeûne, la refpiration cefieroit de produire
du gaz acide carbonique, & finiroit par produire
uniquement du gaz azote, ce qui fembleroit.
devoir être la conféquence dir- fyftême que je
viens d'établir. Je répondrai que je n'en fais rien, ;
pafee que je n'ai point eu d'expériences qui me
l'ait appris j mais je le préfume, & deux faits
confiâtes par M. Jurine , mê' le feront prefque ■
alfurer. Par l ’un , il eft démontré que dans le travail
.qui fuit la digeftion des alimens , &: qui
eft accompagné d'une augmentation1 fenfiblé de
chaleur, 8c d'une accélération du pouls, la proportion
d'acide carbonique que forme la refpiration
eft beaucoup plus grande dans une même quantité,
d'air. Par T autre, il eft conftaté que, dans les
fièvres, le contraire arrive} la proportion d'acide
carbonique eft diminuée, » & celle du gaz azote
augmentée.
. Après ce méchanifme important, vient celui
qui réfulte des fondions de la peau. A la’ furface
dexet organe , l'air vital dégàge encore une portion
du principe du charbon avec lèqiiel -il forme
de Tacide carbonique , & s'il étoit vrai, comme
le pfouveroit une expérience de M. Prieftîey, contredite
cependant par celles de M. Cruikshank &
de M.Jurine,que Tairqüra'féjourné dans le co;fc-
taift de la peau, paroît meilleur à l'eftai du gâz
nitreux , enforte qu’il eût perdu dans cè con^ét
une partie du gaz azote, il en réfulteroit encore,
que dans là peau, 1 les humeurs s'anirnal lient auffi
par un méchanifme analogue a ceux dé ,1a digeftion
& de la refpiration ; au moins paroît-il
bien prouvé que, dans cet organe, il fe fajt un
dégagement du principe du charbon. L ’ignorance
ou nous fommës de la véritable nature de la tranf-
piration cutanée contribue encore à répandre de
Tobfcurité fur cette màtière. '
Conclujion:
11 paroît donc qu'une: grande partie de l’operation
d’où réfulte Taifimilation des alimens (e
paffe dans le canal inteftinal,; dans les organes de
la refpiration & à là furface de la peau j que:
cette opération peut être divifée par conféquertt
en trois temps qui nous rappellent les frdis coç-
tiôns admiifes par nos anciens médecins > que
dans ces trois temps également l'air atmofphérique*
& particulièrement la partie vitale de cet air., eft
le principal inftrumëilt des combinaifons par îef-
qùelles Taflimilation-' s'opère ; qu'il agit probablement
èn enlevant à la matière alimentaire une
portion de fon principe^charboneux, & en facilitant
fa combinaifon avec l’azote excédant dans
les humeurs animales ; & que par conféquent dans
ce travail commun dont l’exécution eft partagée
entre trois organes différons , mais eft fondée
dans tous furies mêmes principes, il fe fait à-
la fois un changement réciproque tant dans la
fubftance de l'aliment que dans celle des humeurs
animales, par lequel l'une étant animalifée, les
autres perdant, pour-ainfi-dire, l’excès de leur
animalifation, toutes font amenées comme à un
même niveau, & paroiflfent mutuellement afti-
milées.
Je fens que cette théorie n'explique pas la
formation de tous les produits de Taflimilation
animale , qu'on n’y . reconnoît ni la produ&ion
des fels phoiphoriques, ni celle la matière grâfle
analogue au Diane de baleine que M. Fourcroy
a trouvée dans le foie 8c la bile , qu'à plus forte
rajfon Ton n'y volt pas la manière dont fe mo*
difient les autres, produits animaux fur JefqueL
la chimie' moderne n’a point encore jette de
jour j. que par conféquent elle eft incomplette :
ma-réponfe eft toute fimple. 1 es faits connus 8c
ks obfervàtions publiées jufqu'à ce jour, n'ont
pas pu me mener plus loin j mais la combinaifon
dè l'azote dans les fubftances animales eft déjà
un objet affez important pour que Je mécanifme
de cette combinaifon puiffe être regardé comme
un des objets les plus intéreffans de l'économie
animale.
Telle eft la manière dont M. Halle croit pouvoir
expliquer le mécanifme de Taflimilation des
alimens, de leur changement de nature} on voit
qu'il a tiré beaucoup de parti des découvertes
faites par MM. Scheèîe, Bergman, Lavoifier
Prieftîey, Berthollet ; on conçoit par-là quelles
lumières on peut attendre aujourd'hui de l'application
de la- chimie à là phyfiquè animale ‘. 8c
combien la marche de cette fcience, guidée par
les connoiffances nouvelle^ , fur J'analyfe de Tair
& dés matières animales , diffère en ce moment
dè ce qu'elle étoit il y à quelques années. Il
ferdit dilficile' de ne pas convenir qu'à la place
de fyft'êmes vagues,, d'hypothéfes incertaines, qui
ont:rempli jufqu'à préfent tant d'ouvrages inutiles
fur la phyfioiogie ,;y Ja fcience 'peut au moins
compter' aujourd’hui -quelques pas affurés, quant
aux travaux des chimiftes. On doit confidérer que
Touviagë de M .. Hàllé eft-un dès premiers en ce
genre, qu’il embr^ffe une.grande étendue d'opérations
ou de fondions animales à-Ia-fois, qu'il
:eft prèfquè impoflîble';par conféquent qu'if ait
ré folu -Tehfëmbie du problème extrêmement compliqué
quelles préfentent. Peut-être’même a-t-il
: fait comme. ceux qui parcourent une route peu
connue, peu frayée }; iTa pris des détours^&
fuivi le chemin le plus long j peut-être le mé-
canifme de TaffimiLtion n’è ft- il pas auffi compliqué
qu'il l'a cru } mais au moins il eft difficile,
'de le concevoir autrenjent qu'il Ta expofé dans
l’état aduel de k fcience, fauf les modifications