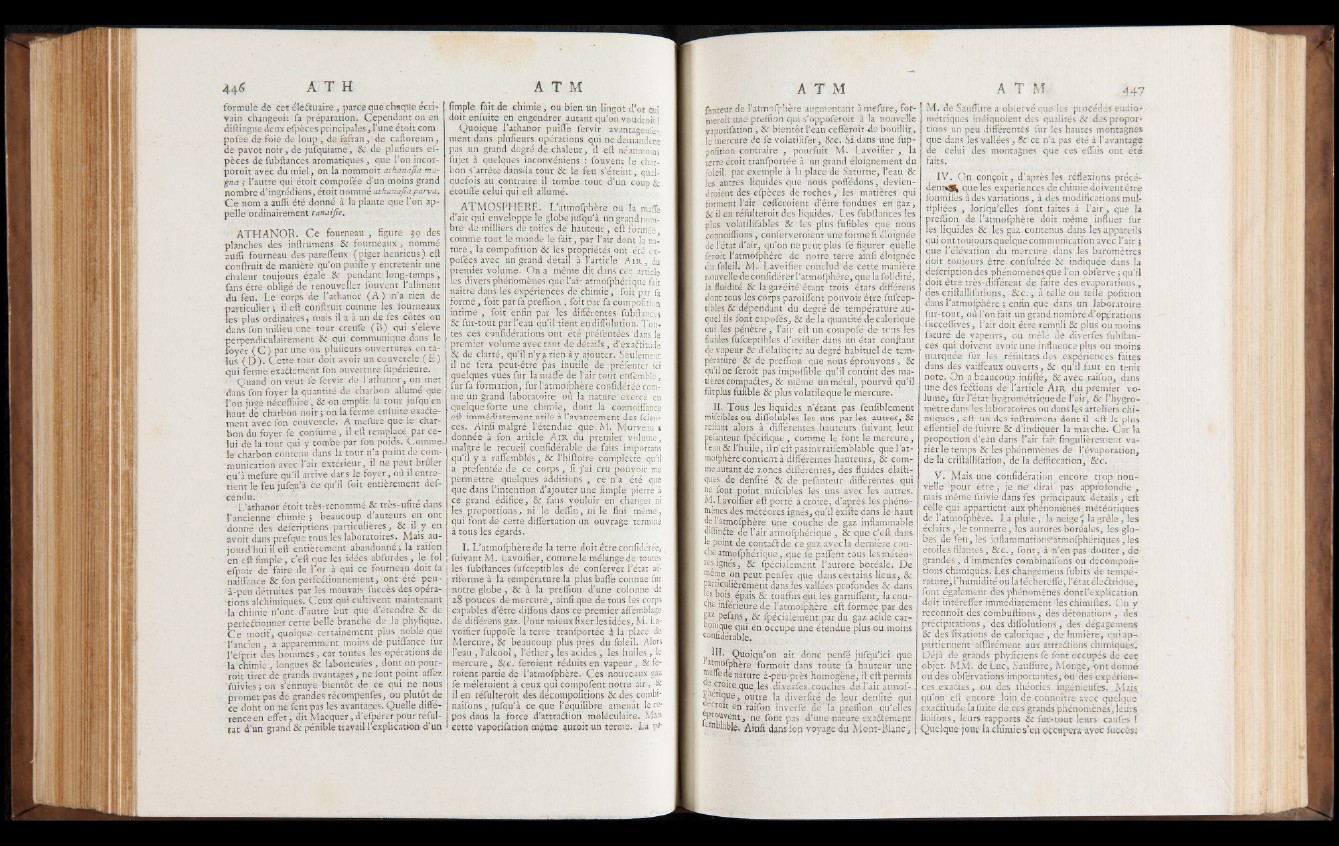
44 6 À T H
formule de cet éle&uaire , parce que chaque écri- ,
vain changeoic fa préparation. Cependant on en
diftingue deux efpèces principales , l'une étoit com-
pofée de foie de loup, de fafran, de caftoreum,
de pavot noir, de jufquiame, 8c de plufieurs efpèces
de fubftances aromatiques,. que Ton incor-
poroit avec du miel, on la nommoit atkanafia magna
,• l’autre qui étoit compofée d’un moins grand
nombre d’ingrédiens, étoit nommé atkanafia parva.
C e nom a aufti été donné à la plante que Ton appelle
ordinairement tanaifie.
A THANOR . Ce fourneau , figure 39 des
planches des inftrumens & fourneaux, nommé
au (fi fourneau des parefteux ( piger henricûs ) eft
conftruit de manière qu’on puifle y entretenir une
chaleur toujours égale & pendant long-temps,
fans être obligé de 'renouveller fouvent l’aliment
du feu. Le corps de l’athanor ( A ) -n’a rien de
particulier 5 il en conftruit comme les fourneaux
les plus ordinaires, mais il a à un de fes côtés ou
dans fon milieu une tour creiïfe (B) qui s’élève;
perpendiculairement 8c qui communique dans le
foyer ( C ) par une ou plufieurs ouvertures en talus
(D ) . Cette tour doit avoir un couvercle (E/);
qui ferme exaêtement fon ouverture fupérieure.
Quand on veut le fervir de l ’athanor , on met
dans fon foyer la quantité de charbon allume que
l’on juge néceffaire, & on emplit la tour jufqu en
haut de charbon noir > on la ferme enfuite exa&e-
ment avec fon couvercle. A mefure que le charbon
du foyer fe confume, il eft remplacé par celui
de la tour qui y tombe par fon poids. Comme,
le-charbon contenu dans la tour n a point de communication
avec l’air extérieur, il ne peut brûler
qu’a mefure qu’il arrive dans le foyer, où il rentre-,,
tient le feu jufqu’à ce qu’il foit entièrement descendu;'.
; , , ,
L’athanor étoit très-renomme & tres-ulite dans
l’ancienne chimie j beaucoup d auteurs en ont
donné des defcriptions particulières, 8c il y en
avoit dans prefque tous les laboratoires. Mais aujourd’hui
il eft entièrement abandonné { la raifon
en eft fimple, c’eft que les idées abfurdes, le fol
efpoir de faire de l’or à qui ce fourneau doit la |
nailfance & fon perfectionnement, ont été peu-
à-peu détruites par les mauvais fuccès des opérations
alchimiques. Ceux qui cultivent maintenant
•la chimie n’ont d’autre but que d’étendre 8c de
perfectionner cette belle branche de la phyfique.
C e motif, quoique-certainement plus noble que
l’ancien, a apparemment moins de puiflance fur
l’efprit des hommes, car toutes les opérations de
la chimie , longues & laborieufes, dont on pourront
tirer dé grands avantages , ne font point aftez
fuivies, on s’ennuye bientôt de ce qui ne nous
promet pas de grandes récompenfes, ou plutôt de
ce dont on ne fent pas les avantages. Quelle différence
en effet, ditMacquer, d’efpérerpourréful-
d’un gt and & pénible travail l’explication d’un
A T M
.fimple fait de chimie, ou bien un lingot d’or qui
doit enfuite en engendrer autant qu’on voudrait !
Quoique l’athanor puifife fervir avantageufe-
ment dans plufieurs opérations qui ne demandent
pas un grand degré de chaleur,, il eft néanmoins
fujet à quelques inconvéniens : fouvent le charbon
s’arrête dans*la tour 8c le feu s’éteint, quelquefois
au contraire il tombe tout d’un coup &
étouffe celui qui eft allumé.
ATMOSPHERE. L’atmofphère ou la maffe
d’air qui enveloppe le globe jufqu’à un grand nombre
de milliers de toifes de hauteur, eft formée
comme tout le monde le fait, par l’air dont la nature,
la compofition 8c lës propriétés ont été èx-
pofées avec un grand détail à l’article Ai r , du
premier volume. On a même dit dans cet article
les divers phénomènes que T air atmofphérique fait
naître dans les expériences de chimie, ’ foit par fa
forme, foit par fa preftion , foit par fa compofition
intime , foit 'enfin par les. différentes fubftances
& fur-tout par l’eau qu’il tient endiflblution. Toutes
ces confidérations ont été préfentées dans le
premier volume avec tant de détails, d’exattitnde
& de clarté, qu’il n’y a rien à y ajouter. Seulement
il ne fera peut-être pas inutile • dé préfenter.ici
quelques vues fur la maffe de l’air tout enfemble,
fur fa formation, fur l’atraéfphère confidérée comme
un grand laboratoire ou la nature exerce en
quelque forte une chimie, dont la çonnoiffance
éft immédiatement utile à l’avancement des fcien*
ces. Ainfi malgré l’étendue qüe\ M. Morveau s
donnée à fon article A ir du premier volume,
malgré le recueil confidérable de faits importans
qu’il y a raffemblés, & Lhiftoire cômplétte qu’il
a prefentée. de ce . corps, fi j’ai cru pouvoir me
permettre quelques additions , cé n’a été que
que dans l’intention d’ajouter une fimple pierre à
ce grand édifice, & fans vouloir en changer ni
les proportions j ni le deffin, ni le fini même ,
qui font de cette differtation un ouvrage terminé
à tous les égards. -
I. L’atmofphère de là terre doit être confidérée,
fuivant M. Lavoifièr, Comme le mélange de toutes
i les fubftances fufceptibles de conferver l’état ae*
riforme à la température la plus baffe connue fur
notre globe, 8c à la preftion d’une colonne de
28 pouces de mercure, ainfi que de tous les corps
capables d’être 'di flous dans ce premier affemblage
de différens gaz. Pour mieux fixer les idées, M. La-
voilier fuppofe la terre tranfportée à la place de
Mercure, 8c beaucoup plus près du foleil. Alors
l’eau, l’alcool, l’éther, les acides, les huiles, le
mercure, &c. feraient réduits en vapeur, &fe-
roient partie de l’atmofphère. Ces nouveaux gaz.
fe mêleroient à ceux qui compofent notre air, &
il en réfulteroit des décompofitions 8c des combina
ifons , jufqu’à ce que l’équilibre amenât le rf
pos dans la force d’attra&ion moléculaire. Mais
cette vaporifation même quroit un terme. La p*
A T M A T M 447
fanteur de l’atmofphère augmentant à mefure, for-
meroit une preffion qui s’oppoferoit à la nouvelle
vaporifation, & bientôt l’eau cefleroit de boüillif,
le mercure de fe volatilifer, 8ce. STdans une fup-
pofition contraire , potvrfuit M. Lavoifièr , la
terre étoit tranfportée à un grand éloignement du
foleil, par exemple à la.place de Saturne, l’eau 8c
les autres liquidés que nous pofledons, deviendraient
des efpèces de roches, les matières qui
forment l’air cefîeroient d’être fondues en gaz,
& il en réfulteroit des liquides. Les fubftances les
plus: volatilifables 8c les plus fufibles que nous
connoiftions, conferveroient une forme fi éloignée
de l’état d’air, qu’on ne peut plus fe figurer quelle
ferait l’atmofphère de notre terre ainfi éloignée
du foleil. M- - Lavoifièr condud de Cette manière
nouvelle de confidérër Latmofphère,'que la folidité,
la fluidité 8c la gazéité'étant trois états différens
dont tous les corps paroiftent pouvoir être fufeep-
tîbles & dépendant du degré dë température auquel
ils font expofés, & delà quantité de calorique
qui les pénètre , l’air eft un compofé de tous les
fluides fufceptibles d’exifter dans un état confiant
de vapeur 8c d’élafticité au degré habituel de température
8c de preftion que nous éprouvons, 8c
qu’il ne feroit pas impoftible qu’il contînt des matières
compa&es, 8c même un métal, pourvu qu’il
fiitplus fufible & plus volatile que le mercure.
IL Tous les liquides n’étant pas fenfiblement
mifcibles ou diflolubles les uns par les autres, &
reliant alors à différentes,hauteurs fuivant leur
pefanteur fpécifique, comme le font le mercure,
l’eau & l’huile, iln’ell pasinvraifemblable que l ’atmofphère
contient à différentes hauteurs, 8c comme
autant de zones différentes, des fluides élalli-
ques de denfîté 8c dé pefanteur différentes qui
ne font point mifcibles les uns avec les autres.
M. Lavoifièr eft porte à croire, d’après.les phénomènes
des météores ignés, qu’il exifte dans le haut
de l’atmofohère une couche de gaz inflammable
dilfindé de l’air atrnofphëriquè, & que ç’eft dans
le point de contaél de ce gaz avec la dernière couche
atmofphérique.,.'que fe paffent tous les météo-
ms ignés, & fpéci ale ment l’aurore boréale. De
meme on peut penfer que dans certains lieux, &
particulièrement dans les vallées profondes & dans
les bois^ épais 8c touffus qui les garniftent, la couche
inférieure de l’atmofphère eft formée par des
gaz pefans, 8c fpécialement par du gaz acide; carbonique
qui en occupe une étendue plus ou moins
confidérable.
HL Quoiqu’on ait donc penfé jufqu’ici que
atJ?0fphère formoit dans toute fa hauteur une
malle de nature à-peu-près homogène, il* eft permis
f (cÇ°ite quevles diverfes.couches de l’air atmof-
pnen^ue, oiitre la. diyerftté de leur denfité qui
cecroit en raifon inverfé fte'la preftion qu’elles
M » , ne font pas d’une nature exaélement
y 'm b l a b l ç , A i n f i d a n s f o n v o y a g e 4 u M o n t - B l a n c ,
M. dé Sauftîire a oblervé que’les procédés eudio-
métriques indiquoient des qualités & des proportions
un peu différentès fur les hautes montagnes
que dans les vallées, & ce n’a pas été à l’avantage
de celui des montagnes que ces eflais ont été
faits.
IV. On conçoit, d’après les. réflexions précé-
dent*3^ que les expériences de, chimie doivent être
foumifes à des variations, à dçs modifications multipliées.,
lorfqu’elles font faites à l’air, que la
preftion de l’atmofphère doit même influer fur
les liquides & les gaz contenus dans les appareils
qui ont toujours quelque communication avec l’air 5
que l’élévation du mercure dans les baromètres
doit toujours être, confultée & indiquée dans la
defeription des phénomènes que l’on obferve j qu’il
doit être très-différent de faire des évaporations,
des criftallifations, & c . , à telle ou telle pofition
dans l’atmofphère. j enfin que dans un laboratoire
fur-tout, où l’on fait un grand nombre d’opérations
fucceftives, l’air doit être rempli & plus ou moins
faturé de vapeurs, ou mêlé de diverfes fubftances
qui doivent avoir une influence plus 011 moins
marquée fur les réfultats.des expériences faites
dans des vaifteaux ouverts, & qu’il faut en tenir
note. On a beaucoup infifté, & avec raifon, dans
une des fe&ions de l’article A ir du premier vo-
lume^ fur l’état hygrométrique de l’air, 8c l’hygromètre
dansles laboratoires ou dansles atteliers chimiques,
eft un des-inftrumens dont il eft le plus
eflentiel de fuivre 8c d’indiquer la marche. Car la
proportion d’eau dans l’air fait fingulièrement varier
le temps 8c les phénomènes de- l’évaporation,
; de la criftâllifation, de la defliccatioh, 8cc.
V. Mais une confîdération encore trop nou-
■ vëlle ‘pour être, je. ne dirai pas approfondie,
mais même fuivie dans fes principaux détails, eft
celle qui appartient aux phénomènes météoriques
de l’atmofphère. La pluie, la- neige, la grêle, les
éclairs , le tonnerre, les aurores boréales, lés globes.
de feu, les inflammations^àtmofphériques, les
étoiles filantes, & c ., font, à n’en pas douter, de
grandes, d’immenfés combinaifons ou décompofi-
tions chimiques. Les changemens fubits de température,
l’humidité oulafécherefte, l’état éleétricjue,
font également des phénomènes dont l’explication
doit intérefter immédiatement les chimiftes. On y
reconnoît des combuftions, des détonations, des
précipitations, des difîolutions, des dégagemens
8c dtes fixations de calorique, de lumière, qui appartiennent
aflurément aux attraéfions chimiques'.
Déjà de grands phyficiens fe font occupés de ceç
objet. MM. de Luc, Saufturei Monge, ont donné
ou des obfërvafiotis importantes, ou dés expériences
-exaétes.,.. ou. .des .théories ingénieufes. JViais,
qu’on eft encore loin de-connoître avec quelque
exaditude la fuite de. ces grands phénomènes, leurs
liaifonsleurs rapports & fur-tout leurs caufes I
•Quelque j o u r la chimie s’en occupera avec fuccès*