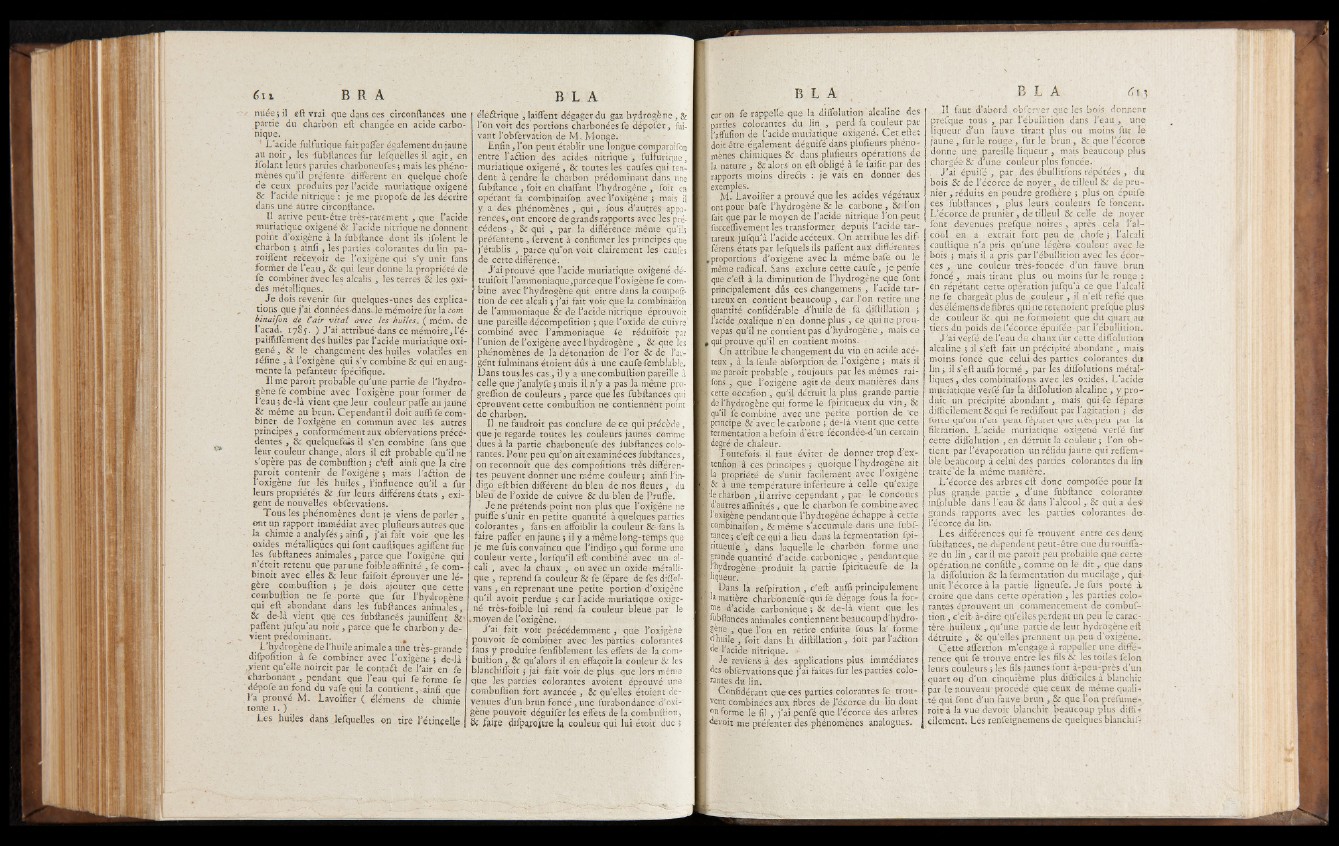
6n B R A B L A
nüée 5 il eft vrai que dans ces circonftances une
partie du charbon eft changée en acide carbonique.
' L'acide fullurique faitpaffer egalement;du jaune
au noir, les -fubftances fur lefquelles il agit, en
ifolar.t leurs parties charboneufes ; mais les phénomènes
qu'il préfente diffèrent en quelque cftofe
de ceux produits par Pacifie muriatique oxigené
& l'acide nitrique : je me pîopofe de les décrire
dans une autre circonftance.
Il arrive peut-être très-rarement, que facide
muriatique oxigené'& l'acide nitrique ne donnent
point d'oxigène à la fubftance dont ils ifolent le
charbon ; ainfi, les parties colorantes du lin pa-
roiflent recevoir de l’oxigène qui sAy unit fans
former de l'eau, & qui leur donne la propriété de
fe combiner avec les alcalis , les terres & les oxi-
- des métalliques.
y Je dois revenir fur quelques-unes des explications
que j'ai données-dansvle mémoire fur la com
binaifort de Pair vital avec les huiles. ( mém. de
l'acad. 1785..). J'ai attribué dans ce mémoire,l'é-
paiffiffement des' huilés par l'acide muriatique oxigené
, & le changement des huiles volatiles en
léline , à l'oxigène qui s’y combine & qui en augmente
la pefanteur foécifique.
Il me paroît probable qu'urie partie de l'hydrogène
fe combine avec l'oxigène pour former de
l'eau 5 de-là vient que leur couleurpaffe au jaune
& même au brun. Cependantil doit auflife combiner
de l'oxigène en commun avec les autres
principes , conformément aux obfervations précédentes
, & quelquefois il s’en, combine fans que
leur couleur change, alors il eft probable qu'il ne
s'opère pas de combuftion 5 c'"eft ainfi que la cire
paroît contenir de l'oxigène ; mais Ta&ion de
l'oxigène fur lés huiles, l'influence qu'il a fur
leurs propriétés & fur leurs différens états , exigent
de nouvelles obfervations.
Tous les phénomènes dent je viens de parler , ,
ont un rapport immédiat ayec plufieurs autres que
la chimie a analyfés ; ainli, j'ai fait voir que les
oxides métalliques qui font cauftiques agiffent fur
les fubftances animales, parce que l'oxigène qui
ifétoit retenu que par une foible affinité , fe com-
binoit avec elles & leur faifoit éprouver une légère
combuftion ; je dois ajouter que cette
combuftion ne fe porte que fur l'hydrogène
qui eft abondant dans les fubftances animales ,
& de-là vient que ces fubftances jauriiîfênt ,
paffent jufqu’au noir, parce que le charbon y devient
prédominant.
_ L'hydrogène de l'huile animale a une très^grande
difpofition à le combiner avec l’ oxigène ; de-là
Pyient qu'elle noircit par le contaél de l'air en fe
tharbonant , pendant que l'eau qui fe forme fe
dépofe au fond du vafe qui la contient,-ainli que
l'a prouvé M. Lavoifier ( élémens de chimie
tome 1. )
L e s h u ile s dans .le fq u e lle s o n t ir e l 'é u n ç e l l e
élé&rique , laiffent dégager du gaz hydrogène, &
I’ôn voit des portions charbonéesfe dépçffer, fui-
vant l’obfervation de M. Monge.
Enfin, l'on peut établir une longue comparaifon
entre l'a&ion des acides nitrique , fulfurique,
muriatique oxigené, & toutes les caufes qui tendent
à gendre le charbon prédominant dans une
fub.ftance , foit en chaffant l'hydrogène , foit en
opérant fa combinaifon avec l'oxigène ; mais il
y a des phénomènes , qui, fous d'autres^appa-
rences, ont éneore de grands rapports avec les précédons
, _& qui , par la différence même qu'ils
préfentent», fervent à confirmer les principes que'
j'établis , parce qu'on voit clairement les caufes
de cette différence:
J'ai prouvé que l’acide muriatique oxigené dé-
truifoit l'ammoniaque,parce que l’oxigène fe combine
avec l'hydrogène qui, entre dans la compofr-
tîon de cet alcali ; j'ai fait voir que la combinaifon
de l'ammoniaque & fie facide nitrique éprouvoit
une pareille décompcfition ; que l'oxide de cuivre
combiné avec l'ammoniaque le réduifoit par
l’union de l'oxigène, avec l'hydrogène , & que les
phénomènes de fa détonation de l'or & de l’ar-'
ge'nt fulminans étoient dûs à une caufe femblablc.
Dans tousJes cas., il y a une combuftion pareille à
celle que j'analyfe ; mais iL n'y a pas la même pro-
greflîon de couleurs, parce que les fubftances qui
éprouvent cette combuftion ne contiennènt point
de charbon.
Il ne faudroit pas conclure de ce qui précède,
que je regarde toutes les couleurs jaunes comme
dues à la partie charboneufe des fubftances colorantes.
Pour peu qu'on ait examinéces fubftances.,
on reconnoît que des compofitions très différentes
peuvent donner une même couleur ; ainfi l'indigo
eft bien différent dû bleu de nos fleurs, du
bleu de l'oxide de cuivre & dm bleu de. Prude.
Je ne prétends-point non plus que l'oxigène ne
puiffe s'unir en petite quantité à quelques parties
colorantes, fans en aftoiblir la couleur &• fans la
faire paffer en jaune ; il y a même long-temps que
j e me fuis convaincu que l’indigo, qui forme une
couleur verte, lorfqu’ïl eft combiné avec un alcali
, avec la çhaux , ou avec un oxide - métallique
, reprend fa couleur & fe fépare de fes diffol-
vans, en reprenant une petite portion d'oxigène
qu'il avoit perdue ; car facide muriatique oxigené
très-foible lui rend fa couleur bleue par le
tmoyen de l’oxigène.
J'ai fait voir précédemment, que l’oxigène
poüvoit fe combiner à^ec les parties colorantes
fans y produire-fenfiblement les effets de la combuftion
, & qu'alors il en effaçoit la couleur & les
blanchiffoit j jai fait voir de plus que lors même
qiie les parties colorantes avoient éprouvé une
combuftion fort avancée , & qu'elles étoient devenues
d’un brun foncé, une furabondance d'oxigène
pouvoit déguifer lés effets: de la combuftion,
& f t û f e f t i f p a r o î t r e U c o u l e u r q u i l u i é t o i t d u e 5
B L A
[ Car on fe rappelle que la diffolution alcaline des
[ parties colorantes du lin , perd fà Couleur par
Faffufion de l'acide muriatique oxigené. Cet effet
1 doit être-également déguifé dans plufieurs phéno-
[ mènes chimiques & dans plufieurs opérations de
[ la nature , & alors' on eft obligé à le fàifir, par des
[ rapports moins directs je vais en donner des
[exemples.
M. Lavoifier a prouvé que les acides, végétaux
I ont pour bafe l'hydrogène & le carbone, & 1 on
[ fait que par le moyen de l'acide nitrique l'on peut
[fucceffivement les transformer depuis l'acide tar-
[ tareux jufqu’à l'acide acéteux. On attribue les dif-
Iferèns,états par lefquelsils paffent aux différentes
[proportions d’oxigène avec la même bafe ou le
[même radical. Sans exclure cette caufe, je penfe
[que c’eft à la diminution de l'hydrogène que font
[ principalement dûs ces changement , l'aeidé tar-
[ tareux en contient beaucoup , car .l'on retire une
[.quantité confidérable d'huile de fa diftillation ;
[ l’acide .oxalique n’en donne plus ', ce qui ne prou-
jvepas qu'il ne contient pas d'hydrogène, mais ce
[qui prouve qu'il en contient moins.
| On attribue le changement du vin en acide acé-
| teux, à la feule abforption de. l’oxigène ; mais il
[ me paroît probable , toujours par les mêmes rainons,
que l’oxigène agit de deux manières dans
[cette occafion, qu'il détruit la plus grande partie
Ide l'hydrogène qui forme le fpiritue.ux du vin, &
[qu'il fe combine avec une petite portion de 'ce
[principe & avec le carbone ; de-là vient que cette
I fermentation a befoin d’être fécondée-d’un certain
[degré1 de chaleur.
I, Toutefois- il faut éviter de donner trop d'ex-
tenfion à ces principes -, quoique l'hydrogène ait
[la propriété de s'unir facilement avec l'oxigène .
|& à une température inférieure à celle qu'exige
[le charbon , il arrive cependant, par le concours
| d'autres affinités, que. le charbon fe combine avec
[l’oxigène. pendant que l'hydrogène échappe à cette
[combinaifon, & même s'accumule dans une fubf- ,
[tance; c'eft ce qui a lieu dans là fermentation fpi-
[ritueufe , dans laquelle le charbdn forme une
[grande quantité d'acide, carbonique , pendant que
[l’hydrogène produit la partie- fpiritueufe de la,
[liqueur.
Dans là refpi'ration , c'eft auffi principalement
[h matière charboneufé'quife dégage fous la for- i
[me d'acide carbonique > & de-là vient que les
f fubftances animales contiennent beaucoup d'hydro-
ï.8én'e , que l’on en retire enfuite fous la' forme
[d'huile, foit dans h diftillation,. foit par l'a&ion
[de l'acide nitrique.
Je reviens à des applications plus immédiates
[des obfervations que j'ai faites fur les parties colo-
[rantes dû lin.
Confidérant que ces parties colorantes fe trou-
[vent combinées aux fibres de j'é_corce du lin dont
[°n formé' le fil ,' j’ai .penfé que l’écorce des arbres
devoit me préfenter des phénomènes analogues. (
B L A 6 1.3
Il faut d’abord obferver que les bois donnent
prefque tous , par l’ébuilition dans l’eau , une
liqueur d’un fauve tirant plus ou moins fur le
jaune, furie rouge, fur le brun, & que l’écorce
donne une pareille liqueur , mais beaucoup plus
chargée & d’ une couleur plus foncée.
, J'ai épuifé , par des ébullitfons répétées , du
bois & de l'écorce de noyer, de tilleul & de prunier,
réduits èn'poudre groflière ; plus on épuife
ces fubftances , plus leurs couleurs fe foncent.
L’écorce de prunièr, de tilleul & celle de noyer
font devenues prefque noires, après cela l’alcool
en a extrait fort peu de chofe ; l’alcali
cauftique n’a pris qu’une légère- .couleur avec le
. bois ; mais il a pris par l’ébullition avec les écorces
, une couleur très-foncée d’un fauve brun
foncé , mais tirant plus ou moins fur le rouge :
en répétant cette operation jufqu'à ce que l'alcali
ne fe chargeât plus de couleur , il n'eft refté que
dès élémens de fibres qui ne retenoient prefque plus
de couleur & qui ne.formoient que du quart ait
tiers du poids de l'écorce épuifée-par l'ébullition.
J'ai verfé de l'eau de chaux fur cette diffolution
alcaline ; il s’eft fait un précipité abondant, mais
moins foncé que celui des parti.es colorantes dit
lin > il s’eft âuffî formé , par les diffolutions métal--
liques, des,combinaifons avec les oxides, L’acid&
muriatique verfé fur la 'diffolution alcaline, y produit
un précipité abondant, mais qui-fe fépare-
difficilement & qui fe rediffout par l’agitation ; de-
forte qu’on, n’en peut féparer que très;péu par la,
filtration. L’acide muriatique' oxigené verfé fut'
cette diffolution , en détruit la couleur ; l’on ob--
tient par l'évaporation un réfidu jaune qui reffem--
ble beaucoup à celui des parties colorantes du lin
traité^de la même manière.
L'écorce des arbres eft donc compofée pour I*
plus grande partie x d’une fubftance colorante-
inColuble dans l’eau & dans l 'a lc o o l& qui a des
grands rapports avec les parties colorantes de--
l'écorce du lin.
Les différences qui fë trouvent entre ces deux-'
fubftances, ne, dépendent peut-être que du rouillage
du lin, car il me paroît peu probable que cette-
jopérationjie con fi rtecomme on le dit, que dans-
la diffolution & la fermentation du mucilage, qui-
unit l’écorce à la- partie ligneufe. Je fuis porté à-
croire que dans cette opération 3. les parties colorantes
éprouvent un commencement de combuftion,
c’eft-à-dire qu’elles perdent un peu le carac- u
tère-huileux ,. qu’une partie de leur hydrogène eft
détruite ,: & qu’elles prennent un peu doxigène.
Cette affertion m’engage à rappeller une différence
qui fe trouve entre les fils & les toiles félon
leurs couleurs ; lés fils jaunes font à-peu-près d'un
quart 011 d'un cinquième plus difficiles à blanchir
par le nouveau'procédé que ceux de même quali-»
.té qui font d'un fauve brun , & quel'onpréfume-
roir à la vue devoir blanchir beaucoup plus diffi-*
cilement. Les renfeignemens de quelques blanchift