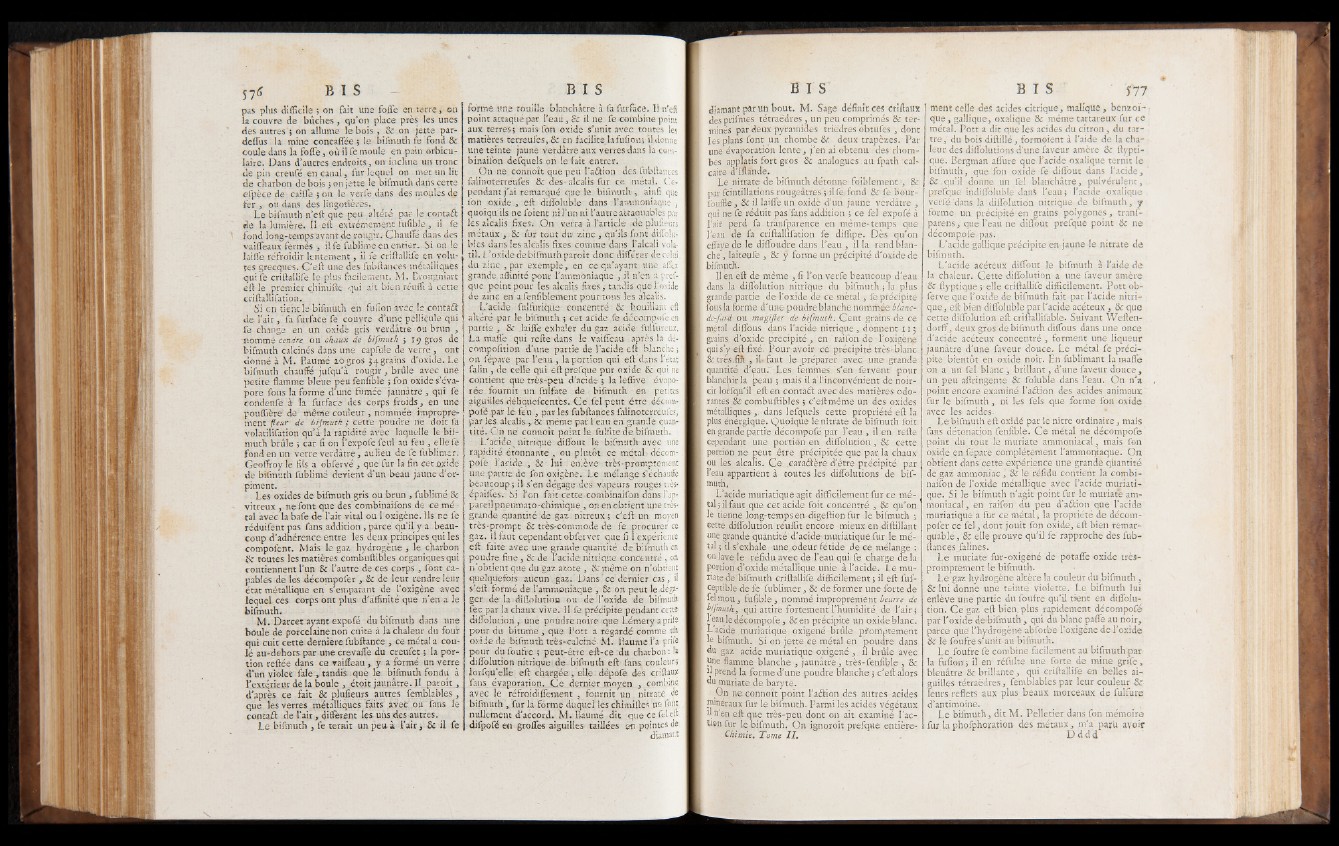
j7<> B I S
pas plus difficile ; on fait une foife en terre j on
la couvre de bûches, qu'on place près les unes
des autres i on allume le bois , & .on jette par-
deffus la mine concaffée; le biimuth fe fond &
coule dans la foffe , où il fe moule en pain orbicu*
laire. Dans d’autres endroits, on incline un tronc
de pin creufé en canal, fur lequel on met un lit
de charbon de bois ; on jette le bifmuth dans cette
efpèce de caille > on le verfe dans des moules de
fer , ou dans des lingotièrès. \ . -
Le bifmuth n’eib que peu altéré par- le contaét
de la lumière. Il eft extrêmement fulible., il fe
fond long-temps avant de rougir;- Chauffé dans des
vailfeaux fermés , il fefublime en entier. -Si on le
laide refroidir lentement, il fe crïllaliife en volutes
grecques. C ’eft une des fubltances métalliques
qui fe criltallife le plus facilement. M. Crongniart
eft le premier chimide qui att bien rc-uflî à cette
criftallifation.. j
üi en tient le bifmuth én fu lion avec, le contaét
de l’air, fa fûrlacé fe co.uyre d’une pellicule qui
fe change en un oxide gris verdâtre ou brun 3
nommé cendre ou chaux de bifmuth ; 19 gros de
bifmuth calcinés dans une capfule de verre , ont
donné à M. Eaumé 10gros 5^.grains d’oxide. Le
bifmuth chauffé jufqu’à rougir , brûle avec une
petite flamme bleue peu fenfible ; fon oxide s’évapore
fous la forme d’une fumée’ jaunâtre -, qui fe
condenfe à la furface des corps froids, en une
pouffière de même couleur , nommée impropre1
ment fieur de bifmuth ; cette poudre ne doit fà
volatilifation qu’à la raoidité arec laquelle le bifmuth
brûle i car fi on l’expofe feul au feu a elle fe
fond en un verre verdâtre, aulieu de fe lublimer.
Geoffroy le fils a obferve a que fur la fin cet oxide
de biimuth lublimé devient d’un beau jaune d’orpiment.
Les oxides de bifmuth gris ou brun . fublimé &
vitreux,-ne font que des combinaifans de ce mé tal
avec la bafe de l’air vital ou Loxigène. Ils ne fe
réduifent pas fans addition , parce qu’il y a, beaucoup
d’adhérence entre les deux principes qui les
compofent. Mais le gaz hydrogène i; le. charbon
8c toutes les matières combuftibies oxganiques qui
contiennent l’un & l’autre de ces cor.ps.a font capables
de les décompofer , 8c de leur rendre leur
état métallique en s’emparant de l’oxigène avec
lequel ces corps ont plus d'affinité que n’en a le
bifmuth.
M. Darcet ayant expofé du bifmuth dans une
boule de porcelainenon cuite à la chaleur du four
qui cuit cette derniere fubftance , ce métal a coulé
au-dehors par une.crevaffe du creulet ; la portion
reftée dans ce vai£teau 3 y a formé un verre
d’un violet fale , tandis que le bifmuth fondu à
IVxrérihiif de la boule étoit jaunâtre. I f paroît,
d’après ce fait 8c piufieurs autres femblables ,
que les verres métalliques faits avec .ou fans le
contait de l’air, diffèrent les uns des autres.
Le bifmuth , fe ternit un peu-à l’air, 8c il fe
B I S
forme une rouille blanchâtre à fa furface. Il n'eft
point attaqué par l'eau, & il ne fe combine point
aux terres> mais fon oxide s'unit avec toutes les
matières terreufes,,8c en facilite, la fuliou; il donne
une teinte jaune verdâtre aux verres dans la coin-
binailon defquels on le fait entrer.
On ne connoît que peu l’aêtion des fubltances
falinoterreufes 8c des* alcalis fur ce métal. Cependant
j’ai remarqué que le bifmuth , ainlî que
fon oxide., eft diflbluble dans l'arnmoniaque ,
quoiqu'ils ne foient ni l'un ni l'autre attaquables parles
alcalis fixes. On verra à l'article de plufieurs
métaux , 8e fur tout du zinc , qu'ils font diffolu-
bies dans les alcalis fixes comme dans l’alcali volatil.
L'oxide de bifmuth paroit donc différer de celui
du zinc , par exemple.j en ce qu’ayant une alla
grande affinité pour l’ammoniaque 3 il n'en a pref-
que. point pour les alcalis fixes, tandis.que l'oxide
de zinc en afenfiblement pour tous les alcalis.
L'acide fnlfurique concentré Se bouiîlanv eft
altéré par le bifmuth ; cet acide fe décompofé en
partie , & Jaiffe exhaler du gaz acide fulfureux.
La maffe qui refte dans le vaiffeau après la dé-
compofition d’une partie de l’acide eft blanche,
on fépare par l’eau, la portion qui eft dans l’état
falin , de celle qui eft prefque pur oxide & qui ne
contient que très-peu d’acide 5 la leflïve évaporée,
fournit un fuîfate de bifmuth en petites
aiguilles déliquefcentes. C e fol peut être décom-
polêpar lé,feu , parles fubftances falinoterreufes,
parles alcalis,. 8c même par l ’eau en grande quantité.
Gn ne connoît point le Tulfite de bifmuth.
L’acide^ nitrique diffout le bifmuth avec une
rapidité étonnante ., ou plutôt ce métal • décom-
pofe l’acide , 8c lui - eniève-très-promptement
une partre.de fon oxigène. Le mélange s'échauffe
beaucoup ; il s’en dégage- des vapeurs rouges très-
épaiffes. Si l’on fait cette combinailon dans l’appareil
pneumato-chimîque, on en obtient une très-
grande quantité de.gaz mitreux ; c’eft un moyen
très-prompt & très-commode de fe procurer ce
gaz. il faut cependant obferv.er que fl l'expérience
eft faite avec une grande quantité de bifmuth en
poudre fine, 8cde l’acide:nitrique concentré , on
n’obtient que du gaz azote , 8c même on n'obtient
quelquefois aucun gaz.’ Dans‘ ce dernier cas, il
sfoft. formé de l’amrnpnïaque , 8c on peut le -dégager
de la.difloLution ou de l’oxide de bifmuth
foc. par la chaux vive. 11 fe précipite pendant cette
diffolution, une poudre noire que Lémeryaprils
pour du bitume, que Pott a regardé comme un
oxide de bifmuth très-.calciné. M. Baume l’a prife
pour clufoufre } peut-êtte eft-ce du charbon: h
diffolution nitrique de bifmuth eft fans; couleur}
jlorfqu’ellè eft chargée, elle : dépofe des .crifiaux
fans évaporation.. Ce. dernier moyen , combina
avec le refroidi {Tentent , fournit un nitrate ce
bifmuth, fur la forme duquel les chimiftes tte font
nullement d’accord. M. Baumë. dit que ce Tel eft
. difpofé en groffes aiguilles taillées en pointes de
diamant
B I S
diamant par un bout. M. Sage définit ces criftaux
des prifmes tétraèdres, un peu comprimés 8c terminés
par deux pyramides triëdres obtufes , dont
les plans font un rhombe 8c deux trapèzes. Par
une évaporation lente, j’en ai obtenu des rhom-
bes applatis fort gros 8c analogues. au fpath caL
caire dTfâhde.
Le nitrate de bifmuth détonne: foiblement ", 8c
par fcintillations rougeâtres'} il foi fond 8c fe. bour-
fouffie, 8c il laiffe un oxide d’un jaune verdâtre ,
qui ne fo réduit pas Tans addition ; ce fol expofé à
l’air perd fa trànfparence en même-temps que
Teau de fa criftallifation fe diflipe. Dès qu’on
effâye de le diflbudre dans l’eau, il la rend blanche
, laiteufo , &'ÿ forme un précipité d’oxide de j
bifmpth.
Il en eft de même , fi l’on verfe beaucoup d’eau
dans la diflolution nitrique du bifmuth ; la plus
grande partie de l’oxide de ce métal, fe précipite
fous la forme d’une poudre blanche nommée blanc-.,
de-fard ou ma gifler de bifmuth. Cent grains de ce
métal diftous dans l’acide nitrique, donnent 113
grains d’oxide précipité,,. en ‘ rai fon de ' l’oxigèn.e
•quis’y eft fixé. Paur avoir cé précipité très-blanc
& très.fih , il* faut le préparer avec une grande
quantité d’eau: Les femmes s’en fervent pour
blanchir la peau; mais il a: l’inconvénient de noircir
lorfqu’il eft en contaét avec des matières odorantes
& combuftibies ; c’eft même un des oxides
métalliques ,. dans lefquels cette propriété eft la.
plus énergique. Quoique le nitrate de bifmuth foit:
en grande, partie décompofé par l’eau , il en refte
cependant une portiôn en diffolution, & cette
portion ne peut être précipitée que par la chaux
ou les alcalis. C e .earaétère d’être précipité par ;
l’eau appartient à toutes les difîblutions de bif-
mutK, .
L’acide muriatique agit difficilement fur ce métal;
il faut que cet acide foit concentré 3 & qu’on
le tienne long-temps.en digeftion fur le bifmuth ;
cette diflolution réuffit encore mieux en diftillant
une grande quantité d’acide muriatique fur le métal
; il s’exhale -une .odeur fétide de ce mélange :
on lave le réfidu avec de l’eau qui fe charge de la
portion d’oxide métallique unie à l’acide. Le mu-
riate de bifmuth criftallifo difficilement ; il eft fuf-
ceptible de fe fublimer, & de former une forte de
fol mou fufible 3 nommé, improprement beurre de
bifmuth, qui attire fortement l’humidité, de l’air;
1 eau le décompofé , &en précipite un oxide blanc.
L acide muriatique oxigené brûle promptement
le bifmuth. Si on jette.ee métal en poudre, dans I
du gaz acidè muriatique oxigené,. il brûle avec I
pne flamme blanche , jaunâtre , très-fenfible-, & ;
û prend la forme d’une poudre blanche ; c’eft alors I
du muriate de baryte.
On ne. connoît point l’aétion des autres acides
minéraux fur le bifmuth. Parmi les acides végétaux
u n’en eft que très-peu dont on ait examiné l'action
fur le bifmuth. On ignoioit prefque entière- .
Chimie, Tome II.
B I S J77
ment celle des acides citrique, mallqilê, benzoïque,
gallique, oxalique & même tartareux fur ce
métal. Pott a dit que les acides du citron, du tartre,
du bois diftillé, formoient à l’aide de la chaleur
des difîblutions d’une faveur amère 8c ftyptî-
.que. Bergman afflue que l’acide oxalique ternit le
bifmuth, que Ton oxidé Te diftout dans l’acide,
& . qu’il donne un fol blanchâtre, pulvérulent,
prefque indiffdluble dans l’eau; l’acide oxalique
verfé dans là diffolution nitrique de bifmuth, y
forme un, précipité en grains polygones, tranf-
parens, que.L’eau ne diffout prefque point & ne .
décompofé, pas:,
L’acide gallique précipite en-jaune le nitrate de
bifmuth.
L’acide acétèux. diffout le bifmuth à l’aide de
la chaleur. C.ette diflolution a une faveur amère
8c ftyptique.;- elle criftallifo difficilement. Pott ob-
forve que l’oxide de bifmiith fait par l’acide nitrique,
eft bien diffoluble par l’acide acéteux, 8c que
cette diffolution eft criftallifable. Suivant Weften-
dorff, deux gros de bifmuth diffous dans une once
d’acide âcéteux concentré, forment une liqueur
jaunâtre d’une faveur douce. Le métal fe précipite
bientôt en oxide noir. En fublimant la maffe
on a un fol blanc , brillant, d’une faveur douce „
un peu aftringente 8c foluble dans l’eau. On n'a
point encore examiné l’aêlion des acides animaux
fur le bifmuth, ni les fols que forme fon oxide
avec les-acides. '
Le bifmuth eft oxidé par le nitre ordinaire, mais
fans détonation fenfible. C e métal ne décompofé
point du tout le muriate ammoniacal, mais fon
oxide en fépare complètement l’ammoniaque. On
obtient dans cette expérience une grande quantité
de,gaz ammoniac 3 8c le réfidu contient la combi-
naifon de l'oxide métallique avec l’acide muriatique.
Si le bifmuth n’agit point fur le muriate ammoniacal,
en raifon du peu d’aêtion que l’acide
muriatique a fur ce métal, la propriété de décompofer
ce fol, dont jouit fon oxide, eft bien remarquable
, 8c elle prouve qu’il fe rapproche des fubftances
Jalines.,
Le muriate fur-oxigené de potaffe oxide très-
promptement le bifmuth.
Le gaz hydrogène altère la couleur du bifmuth ,
8c lui donne une teinté violette. Le bifmuth lui
enlève une partie du foufre qu’il tient en diffolution.
Ce gaz eft bien, plus rapidement décompofé
pat- l’oxide de bifmuth , qui du blanc paffe au noir,
parce qué l’hydrogène abforbe l’oxigène de l’oxide
8c le foufres’uriit au bifmuth.
Le foufre fo combine facilement au bifmuth par
la fufion ; il’ en rëfulte une forte de mine grife,
bleuâtre 8c brillante, qui criftallifo en belles ata
guilles tétraèdres, femblables par leur couleur 8c
leurs reflets aux plus beaux morceaux de fulfure
d’antimoine.
Le bifmuth, dit M. Pelletier dans fon mémoire
fur la phofphoration des métaux, m’a paru avoir
Dddd