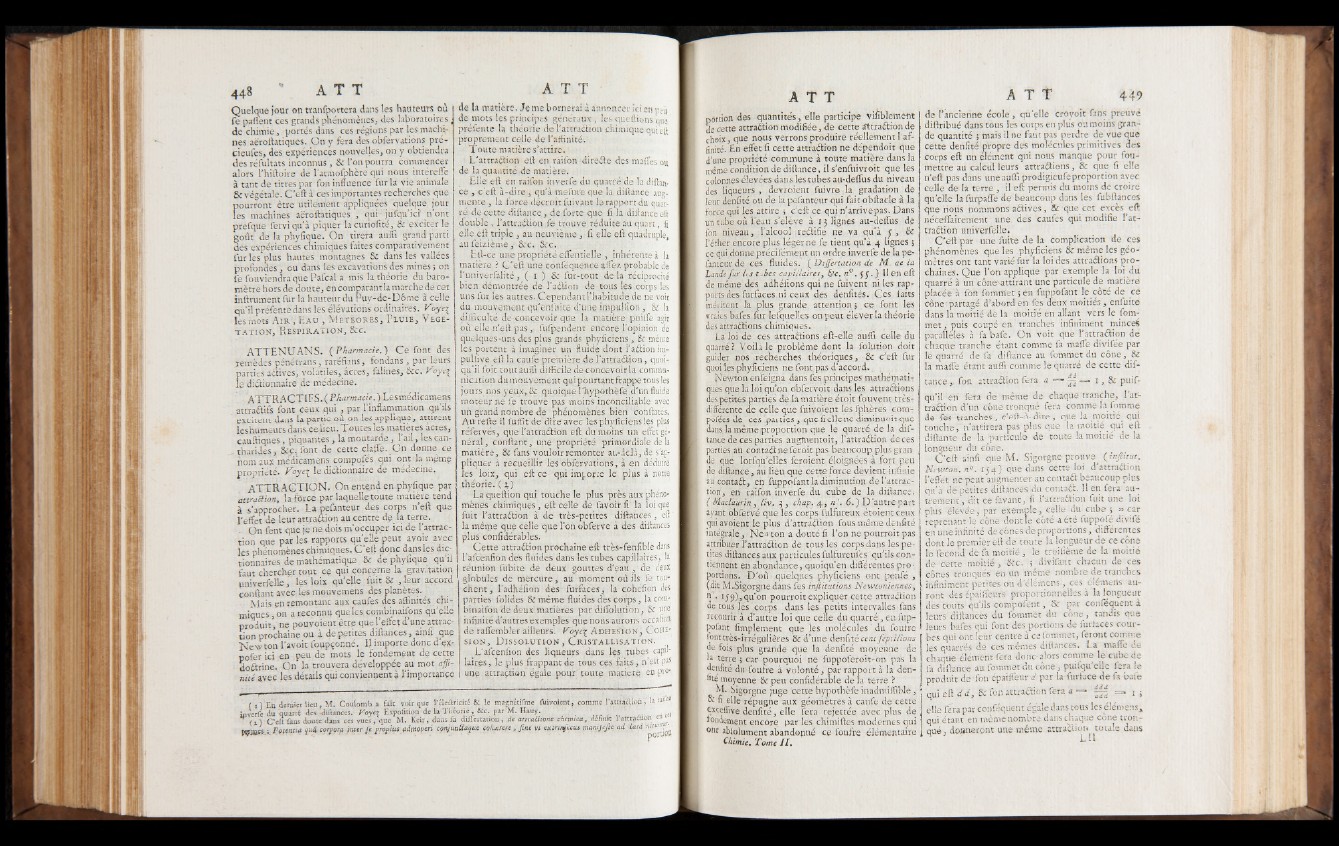
4 4 8 * A T T
Quelque jour on tranfportera dans les hauteurs où
fe pallent ces grands phénomènes* des laboratoires ,
de chimie , portés dans ces régions par les machines
aëroftatiques. On y fera des obfervations pre-
cieufes, des expériences nouvelles, on y obtiendra
des réfultats inconnus, & i’ori pourra commencer
alors l*hiftoire de l’atmofphère qui nous intérefle
à tant de titres par fon influence fur la vie animale
& végétale. C ’eft à ces importantes recherches que
pourront être utilement appliquées quelque, jour
les machines aëroftatiques , qui jufqu ici' n ont
prefque fervi quà piquer la curiofité, & exciter le
goût de la phyfique. On tirera aiifti grand parti
des expériences chimiques faites comparativement
lur les plus hautes montagnes & dans les vallées
profondes, ou dans les excavations des mines} on
fe fou viendra que Pafcal a mis la théorie du baromètre
hors de doute, en comparant la marche de cet
inftrumentfur la hauteur du Puy-de-Dôme à celle
qu il préfente dans les élévations ordinaires. Voyei
les mots A ir , Eau , M e t eo r e s , Plu ie , V égét
a t io n , R e s p ir a t io n , 8ec.
A T TEN U AN S . ( Pharmacie.) C e font des
remèdes penétrans, raréfia ns, fondans , par leurs
parties aPives, volatiles, âcres, falines, &c. Voye^
le diPionnaire de médecine.
A TTRA CTIF S. ( Pharmacie.} Lesmédicamens
attraPifs font ceux qui , par 1‘inflammation qu'ils
excitent dans la partie où on les applique, attirent
les humeurs dans ce lieu. Toutes les matières âcres,
cauftiques, piquantes, la moutarde, 1 ail, lesçan-
-thariies, &p.; font de cette ciaffe. On donne ce
nom aux médicamens compofés qui ont la meme
propriété. Foyei le dictionnaire de médecine,
A T T R A C T IO N , On entend emphyfique par
attraction, la force par laquelle toute matière tend |
à s’approcher. La pefanteur des corps n’eft que |
l’effet de leur attraction au centre de la terre.
On fent que je ne dois m’occuper ici de l’attraction
que par les rapports quelle peut avoir avec
les phénomènes chimiques. C ’eft donc dans les dictionnaires
de mathématique & de phyfique qu’il
faut chercher tout ce qui concerne la gravitation
univerfelle, les loix qu elle fuit & , leur accord
confiant avec les mouvemens des planètes.
Mais en remontant aux caufes des affinités chimiques
, on a reconnu que les combinaifons quelle
produite ne pouvoient être que l’effet d’une attraction
prochaine ou à de petites diftances, ainfi que
Newton l’avoit foupçonué. 11 importe donc d’.ex-
„ofer ici en peu de mots le fondement de cette
doctrine. On la trouvera développée au mot affinité
avec les détails qui conviennent à l’irnportançe
A T T
de la matière. Je me bornerai à annoncer ici en peu
de mots les principes généraux , les que fiions que
préfente la théorie de l’attradtion chimique qui eil
proprement celle de l’affinité.
Toute matière s’attire.
L’attraPion eft en ràifon direPe des martes ou
de la quantité de matière.
Elle eft en raifon inverfe du quarré de la diftaiv
c e , c'eft à-dire, qu’à mefure que la diftance augmente
, la force décroît fuivant le rapport du quarré
de cette diftance, dé forte que fi la diftance eil
double, F attraction fé trouve réduite au quart, fi
elle eft triple , au neuvième, fi elle eft quadruple,
au feizième , &c. &ç.
Elt-ce une propriété effientielle , inhérente à la
matière ? C ’eft une conféqueriee afiez probable de
l’univerfalité, ( i ) & fur-tout delà réciprocité
bien démontrée de l’apion de tous les.corps les
uns fur les autres. Cependant l’habitude de ne voir
du mouvement quënihité dffirie impullion , & la
difficulté de-conçevoir que la matière puifte agir
où elle n’eft pas, fufpendent encore l’opinion de
quelques-uns des plus grands phyficiens, & même
les portent à imaginer un fluide dont l’aPion im-
puliive eft la caufe première de l’attraPion, quoiqu’il
foi-t toutauffi difficile de concevoir la communication
du mouvement qffipôurtant frappe tous les
jours nos yeux., & quoique rhypothèfë d’un fluide
moteur ne fe trouve pas moins inconciliable avec
un grand nombre de phénomènes bien ton datés.
Au refte il f uffit de dire avec les phyficiens les plus
réferyés, que l’attraPion eft du moins un effet gé*
néral, confiant, une propriété primordiale delà
matière, & fans vouloir remonter aurdelà, de s'apr
pliquer à recueillir les obfèrvaiions, à en déduire
les loix, qui eft ce qui importe le plus à notre
théorie/(
Laqueftionqui touche le plus près aux phénomènes
chimiques, eft celle de favoif fi la loi que
fuit l’ attraction à de très-petites diftances, eft
la même que celle que l’on obferve à des diftances
plus confidérables.
Cette attraction prochaine eft très-fenfible dans
Lafcénfion des fluides dans les tubes capillaires? la
réunion fubite de deux gouttes d’eau, de deux
globules de mercure, au moment ou ils fe tou-
chënt, l’adhéfion des fuiffaces, lq cohéfion des
parties foliées & même fluides des corps, la coin-
binaifon de deux matières par diffolution, & une
infinité d’autres exemples que nous aurons occafion
de rartembler ailleurs. Voye% A dhesion^ C ohés
io n , D is so l u t io n , C r is t a l l is a t io n .
L’afcenfion des liqueurs dans les tubes capillaires,
le .plus frappant de tous ces faits, n’elt pas
une attraction égale pour'route matierq. en pi'0'
( i ) Ea dernier lieu, M. Coulomb, a fait voir que t’éleàricicé 6c le mapétifroe fiiivoient, comme l’aaràlftioè ? la
înverfe du quarré des -diftances. Foyer Expofition de la Théorie, &c. par M. Hauy. - K ! „
(i) C’eft fans doute dans ces vues , que M. Keir, dans fa diüeitation, de anraSlione chemica, définit 1 attraction eu
pgjQSS ; Petenda corpora inter Je propius admoveri cpnjuaÜaque cokarerc, fine vi extrinfuus manijefie ad Lata 'H-'“"'. ’
A T T A T T 449
portion des quantités, elle participe vifiblemetit
de cette attraction modifiée, de cette àttraPionde
choix, que nous verrons produire réellement 1 affinité.
En effet fi cette attraction ne dépeudoit que
d’une propriété commune à toute matière dans la
même condition de diftance, il s’enfuivroit que les
colonnes élevées dans les tubes au-defîus du niveau
des liqueurs , devroient fuivre la gradation de
leur denfité. ou de la pefanteur qui fait obftacle à la
force qui les attire * c’eft ce qui n’ arrivepas. Dans
un tube où l’eau s’élève à 13 lignes au-deflus de
fon niveau, l’alcool repifié ne va qu’à j , &
l’éther encore plus léger ne fe tient qu à 4 lignes ;
ce qui donné précifément un ordre inverfe de la .pefanteur
de ces fluides. ( Dijfenation de M. de La
Panât fur Ils t^bes capillaires, &-c. n°. . ) Il en eft
de même des adhéfions qui ne fuivent ni les rapports
des furfaces ni ceux des denfités. Ces faits
méritent fa plus grande attention j ce font les
vraies bafes. fur Iefquelies on peut élever la théorie
des attractions chimiques.
La loi de ces attrapions eft-elle auffi celle du
quarré? Voilà le problème dont la folution doit
guider nos recherches théoriques, & c’eft fur
quoi les phyficiens ne font pas d’accord.
Newton enfeigna dans fes principes mathémati-r
ques que la loi qu’on obfervoit dans les attrapions
des petites parties de la matière étoit fpüvent très-
différente de celle que fuivoient les fphères com-
pôfées de ce,s ^parties, que fi elle ne diminuoit que
dans, la même proportion que le quarré de la dif-
tantedeces parties augtnentoit, l’attraCtion de ces
parties au contaCt ne feroit pas beaucoup plus gran
de que lorfqu’elles feroient éloignées à fort peu
de diftance, au lieu que cette force dévient infinie
au contaCt, en fuppofant la diminution de l'attraction,
en raifon inverfe du cube de la diftance.
( Maclaurin 3 liv. 3, chap. 4 , n\ 6 . ) D ’autre part
ayant obferve que les corps fulfureux étoienteeux
qui avoient le plus d’attraCtion fous même denfité
intégrale, Newton a douté fi l’on ne pourroit pas
attribuer .f attraPion de tous les corps dans les petites
diftances aux particules fulfureufes qu’ils contiennent
en abondance, quoiqu en différentes proportions.
D ’où quelqiies phyficiens ont penfé ,
(dit M'.Sigoi gne dans fes inftitutions Newtoniennes,
I59)J qu’on pourroit expliquer cette attraPion
de tous lés corps dans les petits intervalles fans
recourir à d’autre loi que celle du quarré, en fup-
ppfant Amplement que les molécules ' du. foufre
fonttrès-irrégülières & d’une denfité cent fepxilions
de fois-plus grande que la denfité moyenne de
la terre \ car pourquoi ne fuppoferoit-on pas la
denfité du foufre à volonté, par rapport à la dénoté
moyenne & peu confidérable de la terre ?
M. Sigorgne juge cette hypothèfe inadmiffible,
& fi elle répugne aux géomètres à caufe de cette
exceffive denfité, elle fera rejettée avec plus de
rondement encore par les chimiftes modernes qui
ont abfolument abandonné ce foufre élémentaire
Chimie, Tome II»
de ^ancienne école, qu’elle croyoit fans preuve
diftribué dans tous les corps en plus pu moins grande
quantité j mais il ne faut pas perdre de vue que
cette denfité propre des molécules primitives des
corps eft un élément qui nous manque pour fou-
mettre au calcul leurs attra&ions, & que fi elle
n’eft pas dans une auffi prodigieufeproportion avec
celle de la terre , il eft permis du moins de croire
quelle la fur parte de beaucoup dans les fubftances
que boiis nommons aélives, & que cet excès eft
néceflairement une des caufes qui modifie l’attraction
univerfelle.
C ’eft par une fuite de la complication de ces
phénomènes que les phyficiens & même les géomètres
ont tant varié fur la loi des attrapions prochaines.
Que l’on applique par exemple la loi du
quarré à un cône\attirant une particule de matière
placée à fon fommet 5 en fuppofant le côté de ce
■ cône partagé d’abord en fes deux moitiés, enfuite
dans la moitié de la moitié en allant vers le fommet,
puis coupé en tranches infiniment minceé
parallèles à fa bafe. On voit que l’ attraPion de
chaque tranche étant comme fa mafle divifée par
lé quarré de fa diftance au fommet du cône, &
là malfe étant auffi comme le quarré de cette diftance,.
fon attraPion fera a 1 , & puifqu’il
eri fera de même de chaque tranche, !’attraPion
d'un cône tronqué fera comme la femme
de fës tranches, c’eft-à- dire, que la moitié qui
touche,' n’attirera pas plus que la moitié qui eft
diftante de la particule de toute la moitié de là
longueur du cône.
C ’eft ainfi que M. Sigorgne prouve^ ( infiitut.
Newton, ri0, 154) que dans cette loi d’attraPion
l’effet ne peut augmenter au contaP beaucoup-pius
qu’à dë petites diftances. du contaP. Il en fera autrement,
dit ce favant, fi l’attraètion fuit une loi
plus élevée, par exemple, celle dü cube > » car
reprenant le cône dont le côté a été fuppofé divifé
en une infinité de cônes de proportions, différentes
dont le premier eft de -toute la longueur de ce cône
le fécond de fa moitié, le troifième de la moitié
de cette moitié, &c, 3 divifant chacun de ces
cônes tronqués en un même nombre de tranches
infiniment petites-ou d ’élémens, ces éiémens auront
des épailfeurs proportionnelles à la longueur
des touts qu’ils compofent, & par conféquent à
leurs diftances du fommet du cône, tandis que
leurs bafes qui font des portions de furheés courbes
qui ont.leur centre à ce fommet, feront comme
les quartés de ces mêmes diftances. La maffe de
chique élément fera donc-alors comme le cube de
fa diftance au fommet du cône, puifqu’elle fera le
produit de fon épaiffeur d par la furface de fa bafe
qui eft d d3 & fon attraPion fera a ==» ~ = , j ;
elle fera par conféquent égale dans tous les éiémens*
qui étant en même nombre dans chaque cône tronqué,
dpaneront une même attraPion totale dans