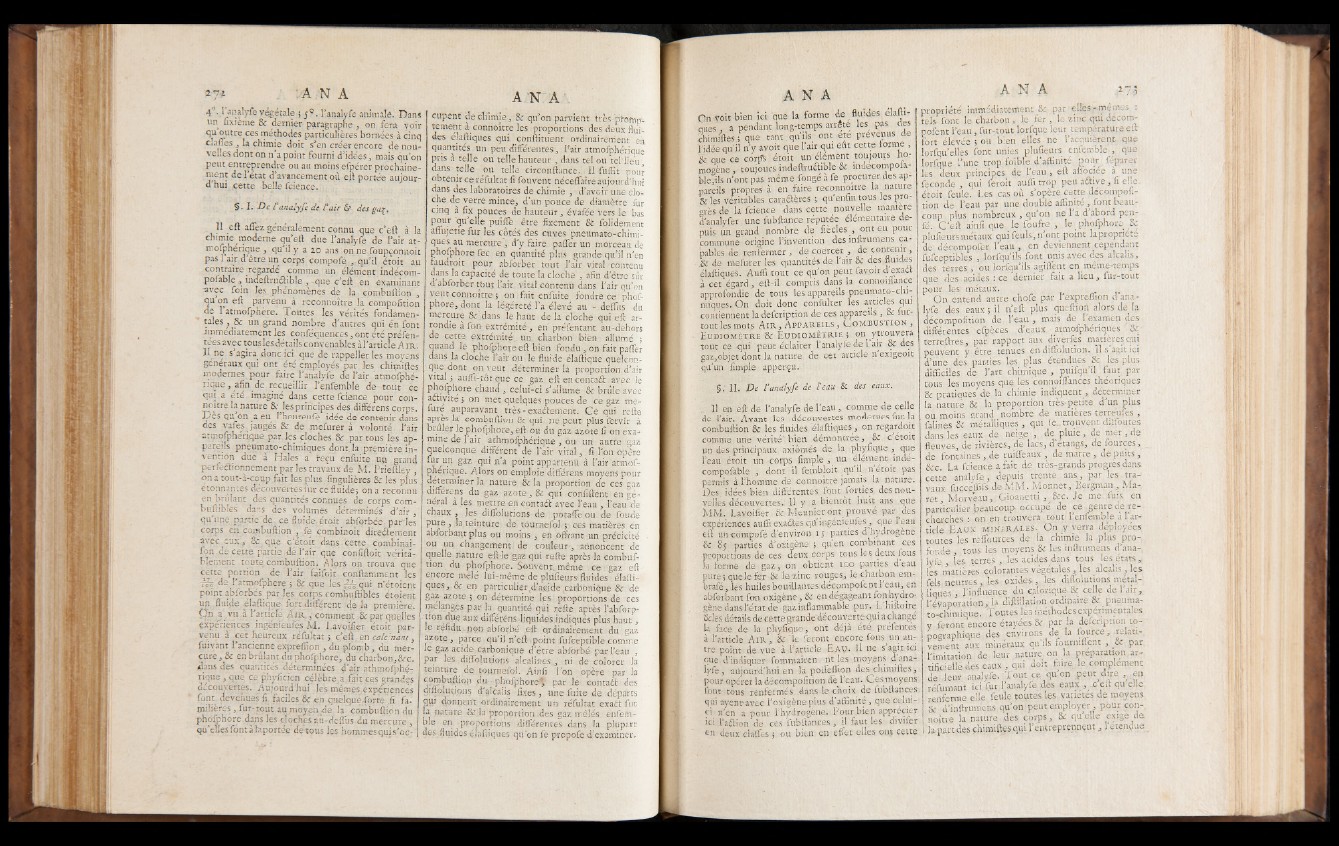
2 T I :A.N A
4 • 1 anaîyfe végétale $ j Q. l’analyfe animale. Dans
un fixieme & dernier- paragraphe ? on fera voir
*îu outre ces méthodes particulières bornées à cinq
dalles , la chimie doit s'en créer encore de nouvelles
dont on n a point fourni d’idées , mais qu’on
peut entreprendre ou au moins efpérer prochainement
de l’état d’avancement ou eft portée aujour-
d hui cette belle fcience.
§. I. De tanalyfe de V air & des gar.
Tl eft allez généralement connu que c’eft à la
chimie moderne qu’eft due l’analyfe de l’air at-
mofpherique , qu il y a 20 ans on ne.foupçonnoit
pas 1 air d’être un corps compofé m qu’il, étoit au
contraire regarde comme un élément indécom-
pofable j, indéfiniélible , -que c’eft en examinant
-avec foin les phénomènes de la. combuftion 3
qu on eft parvenu à reconnoître la compolîtion
de 1 atmofphère. Toutes les vérités fondamentales
^ & un grand nombre d’autres qui en font ;
-immédiatement les conféquences ,ont été préfen- I
tees avec tous les détails convenables à l’article A ir .
Tl ne s’agira donc ici que de rappeller les moyens
généraux qui ont été employés par les chipiiftes
modernes pour faire l’analyfe de l’air Jatmofpné-
rique , afin de recueillir l’enfemble de-tout ce
qui a été imaginé dans cette fcience pour con-
noitre la nature &r les principes des différens corps.
Des qu on a eu l’heureufe idée de contenir dans
des vafes , jaugés & de mefurer à volonté l’air
armofpherique par les cloches & par tous les appareils
pneumato-chimiques dont, la première invention
due à Haies a reçu enfui te un grand
perfeélionnement par les travaux de M . Prieftley 3
on a tout-à-ccup fait les plus. fingulières & les plus
étonnantes découvertes fur ce fluide5 on a reconnu
en brûlant des quantités connues de corps com-
buftibîès dans des volumes déterminés d’air,
qu une partie de, ce fluide- était abforbéè- paroles
cqrps en combuftîon , fe çombinoit direâement
avqç eux j 8^ qiie c ’étoit dans. cette, combinai-
fon de cet-te partie dé l’air que conflftoit véritablement
toute combuftion, Alors on trouva que
cette portion de l’air faifoit conftamment les
réo de 1 atmofphere 5 & que les j^ q u i n’etoienr
point abforbes par les corps combuftibles étaient
un fluide dlaftique* fort différent de^la première.
Qn ,a_ vu à l’article A ir . , comment & par quelles
expériences ingénieufes M. Lavoifier étoit parvenu
a çet heureux réfultat j c’eft. en calcinant 3
fuivant l'ancienneexpreffion , du plomb, du mercure,
& en brûlant du phofphore, du charbon,&rc.
dans des quantités déterminées d’ajr athmofbhé-
rique , que ce phyfîcjen célèbre, a. fai t cgs grandes
decouvertes. Aujourd'hui les mêmes,expériences
font devenues fi faciles & en quelque-forte ’ fi familières
, fur-tout au .moyen, ;de la combuftion du
phofphore dans les cloches au-deflus-du mercure ,
qu’elles font à taportée de tous les hommes qui s’ocj \
a :n i k
cupent de chimie, & qu’on parvient très promptement
à connoître les proportions des deux fluides
elaftiques qui conftituent ordinairement en
quantités un peu différentes, Eair atmofphérique
pris a telle ou telle hauteur , dans tel ou teMieu,
dans telle ou telle circonftance. 11 fuffit pour
obtenir ce réfultat fi fouvent néceffaire aujourd’hui
dans des laboratoires de chimie , d’avoir une cloche
de verre mince, d’un pouce de diamètre fur
cinq a fix pouces de hauteur, évafée vers le bas
pour qu’elle puiffè être fixement & folidement
afiujetie fur les côtés des cuves pneumato-chimiques
au mercure, d’y faire paffer un morceau de
phofphore fec en quantité plus grande qu’il n’en
faudroit pour abforber tout l’air vital contenu
dans la capacité de toute la cloche , afin d’être sûr
d abforber tout l’air vital contenu dans l’air qu’on
veut connoître j on fait enfuite fondre ce phof- ■
phore,dont la légèreté l’a élevé au - defius du
mercure &';dans Je haut de la cloche qui eft arrondie
a fon- extrémité-, eh préfentant au-dehors
de cette, extrémités un. charbon bien allumé ;
quand le phofphore eft bien fondu , on fait pafler
dans la cloche l’air ou le fluide élaftique quelconque
dont on veut déterminer la proportion d’air
vital 5 auflî-tôt que ce gaz eft encontaél avec le
phofphore chaud , celui-ci s’allume & brûle avec
activité 5 on met quelques pouces de ce gaz me-
fure auparavant; très-exactement. Ce qui refte
apres la combuftion & qui ne.peut plus fervir à
brûler le phofphore, eft ou du gaz azote fi on examine
de l’air athmofphérique , ou un autre igaz
quelconque différent de l’air vital, fi l’on opère
u.n gaz qui n’a point appartenu à l’air atmof-
pherique. Alors on emploie'différens moyens pour
déterminer la nature & la proportion de ces gaz
différens du gaz azote , & qui confiftent en general
a les mettre en contaét avec l’eau , l’eau de
chaux, les diiTolutions de potaffe.ou de fondeI
Pufe j Ta.-.teintu-re. de tôurnefoj ; ces matières en
abforbant plus ou moins , en ,offrant un précicité
ou un. changement, de couleur-, annoncent de
quelle nature eft le gaz qui refte après la combuftion
du phofphore. 'Souvent,.même.,.ce . gaz eft
encore mêlé ; lui-même-de plufieurs- fluides élafti-
ques, & en . particulier td’a.dde .carbonique & de
gaz azqte.v on détermine les proportions de ces
mélangés par-' la quantité qui refte après l’abforp-
tion dpe aux différons liquides .indiqués plus haut,
le refidu non abforbé .eft ordinairement du gaz
azote, parce qu’il n’eft »point fufceptiblecomme
le gaz acide, carbonique d’être abforbé par l’eau ,
par les diflolutions alcalines ., ni de colorer la
teinture de;tournefol. Ainfi l’on opère par la
cqmbuftion Tdu-- phofphore% par le contait des
qilïblutions df alcalis fixes, une fuite de départs
qui donnent ordinairement un réfultat exait fur
la nature & la proportionnes gaz mêlés enfem-
b!e en proportions différentes dans la plupart
des fluides elaftiques qu on fe propofe d’examiner*
A N A
On Voit bien ici què la forme de fluides élafti-
aues , a pendant long-temps arrête les^ pas. des
chimiftes.i que tant qu’ils; ont ete prévenus de
fidée qu'il n’y avoit que l’air qui eût cette forme ,
& que ce cortfs étoit un élément toujours homogène
, toujours indeftruitible & îndecompofa-
ble,ils n’ont pas même fongé à fe procurer des appareils
propres à en faire reconnoître la nature
& les Véritables car a itères 5 qu’énfintous les progrès
de la fcience dans cette nouvelle, maniéré
d’analyfer une fubftance réputée élémentaire depuis
un grand nombre de fiècles , ont eu pour
commune origine l’invention des inftrumens capables
de renfermer, de coercer , de contenir,
.& de mefurer les quantités de l’air & des fluides
elaftiques. Auffi tout ce qu’on peut favoir d exact
à cet égard, eft-il compris dans la connoifiance
approfondie-de tous les appareils pneumato-chi-
miques. On doit donc confulter les articles qui
contiennent la defcription de ces appareils, & fur-
tout les mots Air , Appareils, C ombustion^
Eudiomètre & Eudiometrie j on y trouvera
tout ce qui peut éclairer l’analyfe de 1 air & des
gaz,objet dont la nature de cet article n exigeoit
qu’un fimple apperçu.
§. II. De Vandlyfe de Veau. 8ç des eaux.
11 en eft de l’analyfe de l’eau, comme de celle
de l’air. Avant les découvertes modernesJut la
combuftion & les fluides elaftiques , on regardoit
comme une vérité’; bien démontrée, & c étoit
un des principaux axiômës de la phyfique , que
l’eau étoit un corps fimple , un élément indé-
compofable , dont il fembloit ;qu’il netoit pas
permis à l’homme de connoître jamais 'la nature. 1
Des. idées bien différentes, font Sorties, des nouvelles
découvertes'.; 11 y a bientôt huit ans que
MM. Layoifier . & Meunier ont prouvé par .des
expériences aufli exactes qtfingemeufes, que 1 eau
eft un compofé d’environ 15 parties d hydrogéné
& 85 parties d’oxigène j qu en combinant ces
proportions de ces deux corps tous les deux fous
la forme de gaz, on obtient. 100 parties deau
pure j que le fer & le. zinc rouges, le charbon em-
brafé, les huiles bouillantes décompofent 1 eau, en |
abforbant fon oxigène, & en dégageant fon hydrogène
dans l’état de - gaz inflammable pur. L’hiftoire
&les détails de cette grande decouverte qui a change
la face de la phyfique, ont déjà été préfentés
à l’article Air, & le feront encore fous .un autre
point de vue~à l’article Eau . Il ne s’agftlci
que d’indiquer fommairen- nt les moyens dana-
lyfe, aujourd'hui en la poiieiUon des cuimilies>.■
pour opérer la décompofition de l'eau. Ces moyens
font tous; renfermés dans le choix de fübftances.
qui ayenuavec l'oxigène plus d’affinité, que celui-
ci n'en a pour l'hydrogène. Pour .bien apprécier
ici -l’aâion de ces fubllances, il faut les dixifer
en deux elaffes ; ou bien en efiet elles ont cette
A N A .17.5
propriété immédiatement 8c par ellesrmemes .
.tels font le charbon , le fer, le zinc qui décompofent
l'eau, fur-tout lorfque leur température eft'
fort élevée 5 ou bien elles ne l’acquièrent que
lqrfqu'elles font unies plufieurs enfemble , que
lorfque "une trop foible d’affinité pour féparer
les deux principes de 1 eau , eu afiociee a une
fécondé, qui feroit auffi trop peu aétive, u elle.
étoit, feule. Les cas où s’opère cette décompofition
de- l’eau par une doublé affinité, font beaucoup
. plus nombreux, qu’on ne 1 a d abord pen-
fé. C’eft ainfi que le foufre , le phofphore 8c
plufieurs métaux qui feuls, n’ont point la propriété
de- décompofer l’eau , en deviennent cependant
fufceptibles , lorfqû’ils font unis avec des alcalis,
des terres , ou; lotfqu’ils agiffent en même-temps
que des acides : ce dernier fait a lieu, fur-tout
pour les métaux.
On entend autre chofe par l’expreffion d analyfe
des eaux; il n’eft plus queftion alors de la
décompofition de l’eau, mais de 1 examen des
différentes efpèces d’eaux atmofphériques &
terreftres, par rapport aux diverfes matières qui
peuvent y être tenues en dtffolution. 11 s’agit ici
d’une des parties les plus etendues Jk. les plus
difficiles de l’art chimique , puifqu il faut pat-
tous les moyens que les connoiflances théoriques
8c pratiques de la chimie indiquent, déterminer
la nature 8c la proportion très■ pet!te d un plus
ou moins grand nombre de matières terre'ufes ,
falines 8c métalliques, qui fe,trouvent difioutes
dans les ,;eatix de neige , de pluie, de mer, de
fleuves, de rivières,, de lacs, d’étangs, de fources, _
de fontaines, de ruiffeaux , de marre, dé puits,
8rc. La fcience a fait de très-grands progrès dans
cette analyfe, depuis trente ans, par les . travaux
fucceffifs de MM- Monnet, Bergman , Ma-
ret, îyioryeau, Gioanetti, 8ce. Je me .fuis en
particulier .beaucoup occupé de ce-, genre de'recherchés
:■ on en trouvera tout l’énfemble à l’article
Eaux minérales, On ,y verra déployées
toutes les reffources de la chimie la plus profonde
, tous les moyens 8c les inftrumens d’ana-,
lyfe , les terres , les acides dans tous les états,
les matières colorantes végétales, les alcalis, les
Tels, neutres , Tes oxides, les diffolutions métalliques',
l’influence du calorique 8ç celle de l’air,
l’évaporation, la diftitlation ordinaire 8c pneuma-
to-chimique. Toutes lès méthodes expérimentales
y feront encore étayées 8c parla defcription topographique
des environs de la fource, .relata-,
vement aux minéraux qu'ils fourmffent, 8c par.
l’imitation de leur nature, ou la préparation, artificielle
des eaux, qui doit faire le,complément
jgj leur analyfe. Tout ce qu’on peut dire „ .en
réfumant ici fur l’analyfe dés eaux , .c’eft qu’elle
renferme elle feule toutes les variétés de moyens
& d’inftr.umens qu on peut employer, pour çon-,
noître la nature des, corps, qu elle exige de
la part des çhimiftes qui l’entreprennent, 1 étendue