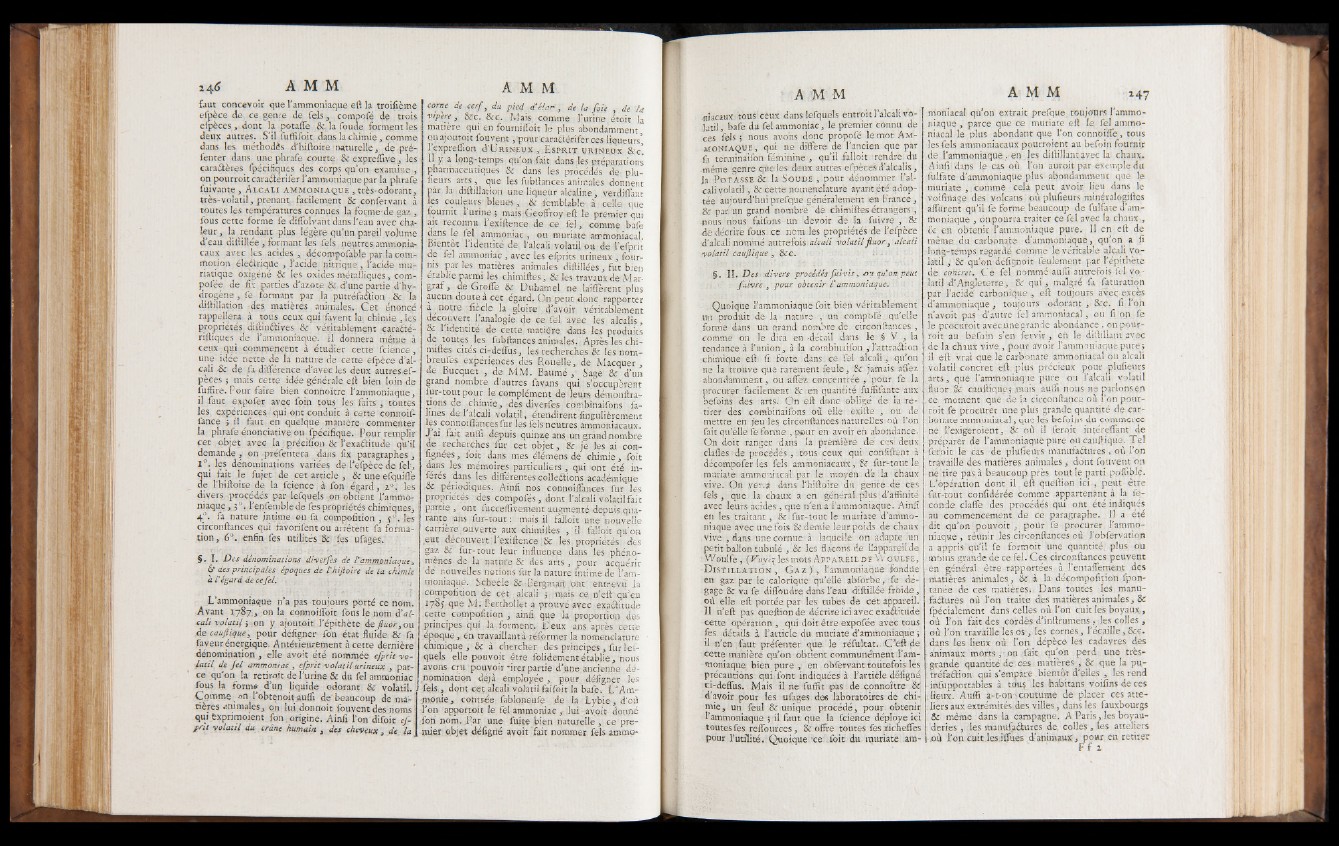
faut concevoir que l'ammoniaque eft la troifième
efpèce de ce genre de fels, compofé de trois,
efpèces, dont la potafle &: la foude forment les
deux autres. S'il.fufiifoit dans la chimie , comme
dans les méthodès d'hiftoire naturelle, de pré-
fenter dans une phrafe courte & expreffive , les
caraCtères fpécifiques des corps quon examine ,
on pourroit caraCfcérifer l'ammoniaque par la phrafe
fni van te j A l c a l i a m m o n i a q u e , très-odorant,
très-volatil, prenant, facilement & confervant à
toutes les températures connues la foi;me''de gaz
fous cette forme fe diffolvant dans l'eau avec chaleur,
la rendant plus légère qu'un pareil volume
d'eau dillillée , formant les fels neutres ammoniacaux
avec les .acides 5 décompofable par la commotion
éleCtriqile , l'acide nitrique 3 l'acide mu-
riatique ôx.igéné & les oxides métalliques, composée
de fix parties d'azote & d'une partie d'hydrogène
j fe formant par la putréfaction & la
diftillation des; matières animales. Ce t énoncé
rappellera à tous ceux qui favent la chimie , les
propriétés didinèfives & véritablement caraCté-
riftiques de l'ammoniaque, il donnera même à
ceux , qui commencent à étudier cette fcience,
une idée nette de la nature de cette efpèce d'alcali
.& de ;fa différence d'avec les deux autres ef-
pèces 5 mais cette idée générale eit bien loin de
fuffire. Pour faire bien connoïtre l'ammoniaque,
il faut expofer avec foin tous les faits 3 toutes
les expériences qui ont conduit à ce;tte connoif-
fance ; il faut , en quelque manière commenter
la phrafe énonciative ou fpécifique. Pour remplir
cet objet avec la préeifion & l'exaCtitude qu’il
demande , on préfentera dans f i x paragraphes 3
i° . les dénominations variées de l’efpèce oe feh
qui fait le fujet de cet article 3 & une efquiffe
de l’hiftoire de la fcience à fon égard, 2°.' les
divers, procédés par lefquels pn obtient l'ammo- j
niaque,3 ° . l'enfemblede fespropriétés chimiques,1
4 ’. fa nature intime ou fa compofition 3 les
circonftances qui favorifent ou arrêtént fa forma- ;
tion3 6°. enfin fes utilités &: fes ufages;.: '
§. I. Des dénominations diverfes de l'_qmjnt>niaque3
& des principales époques de Vhifloire de La chimie
d l'égard de ce fel. -
L’ammoniaque n'a pas toujours porté ce nom.
Avant 1787 3 on la connoififoit fous le .nom ééalcali
volatil ; on y aj.outoit l'épithète de fluor, ou
de eauftique 3 pour défigner fon état fluide & fa
faveur énergique. Antérieurement à cette dernière'
dénomination , elle avoit été nommée efprit volatil
de fe l ammoniac 3 efprit volât il urineux 3 parce
qu'on la retiroit de l'urine & du fel ammoniac,
corne de cerf, du pied d'èlar 3 de la foie 3 de ta.
vipere 3 &rc. 8c c. Mais comme l'urine étoit la
• matière qui en fourniifoit le plus abondamment,
[ Qu ajoutoit fouvent 3 pqur caraCtérifer ces liqueurs,
; 1 expreffion d’ÜRiNEUx , E s p r i t u r i n e u x &c*
| H ÿ a Iqng-temps qu'on fait dans les préparations
; pharmaceutiques & dans les procédés de; plu-
; fieurs arts , que les fubftances animales donnent
j par la diftillation une liqueur alcaline, verdiflant
les couleurs bleues, femblabîe. à celle que
fournit 1 urine $ mais Geoffroy eft le premier qui
ait reconnu l'exiftenc-e de ce fel, comme bafe
dans le. fel. ammoniac , ou muriate ammoniacal,
Bientôt 1 identité de l’alcali volatil ou de l'efprit
de fel ammoniac, avec les efprits urineux, fournis
fous la forme d'un liquide odorant & volatil. .
Comme?-on l'obtenoitauffi de beaucoup de ma-’
tières animales 3 on lui donnoit fouvent des noms
qui éxprimoient fon . origine. Ainfi Ton difoit ef-. •
p/it volatil du crâne humain 3 des cheveux , de la
par les matières animales diftillées, fut bien
établie parmi les chimiftesy & les travaux de Mar-
graf, de Grofle & Duhamel ne laifïerent plus
aucun doute a cet égard. On peut donc rapporter
a ;notre fiècle la gloire d'avoir véritablement
découvert 1 analogie de ce fel avec les alcalis,
& 1 identité de cette matière dans les produits
de toutes les fubftances animales. < Après les chi-
miftes cités ci-deffus, les recherches & les nom-
breufes expériences des Rouelle, de Macquer,
1 de Bucquet , de MM. Baumé g§ Sage & d'un
grand nombre d’autres favans qui s'occupèrent
fur-tout pour le complément de leurs démonftra-
uons de chimiej des diverfes combinaifons fa-
lines de l alcali , volatil, étendirent fingulièrement
les connoiflances fur les fels neutres ammoniacaux.
J'ai fait auffi depuis quinze ans un grand nombre
de recherches fur cet objet, & je les ai con-
fîgnées, ioit dans mes élémens de chimie, foit
dans les mémoires particuliers , qui ont été inférés
'dans les différentes collections académique
périodiques. Ainfi nos connoiflances fur les
propriétés des compofés , dont l’alcali volatil fait
partie , ont fucceflivement augmenté depuis:qua-
rante <ans fur-tout : mais il faîloit une nouvelle
carrière ouverte aux chimi-ftes , il falloit qu'on
.eut découvert ; l'exiftence ;& les propriétés des
gaz & fur-tout leur influence dans les phénomènes
de la nature & des arts , pour acquérir
de nouvelles notions fur la nature intime de l'ammoniaque.
Scheèle & -Bergman ont entrevu Ja
compolition de cet alcali 5 mais ce n'eft qu'en
1785 que M. Berthollet a prouvé avec exactitude
.cette compétition , ainfi que la proportion des
principes qui Ja.forment. Deux ans après cette
époque, en travaillant à réformer la nomenclature
chimique , & à chercher des principes, fur l efquels
elle pouvoit être folidementétablie, nous
avons cru pouvoir ’■ irer partie d'une ancienne dénomination
déjà employée, pour défigner les
fels., dont ceç alcali volatil faifoit la bafe. L'Ain-
monie, contrée fabloneijfe . .de la Lybie-, d’où
l'on apportoit le fel ammoniac , lui avoit donne
fon nom. ,P;ar une fuite bien naturelle , ce premier
objet défigüé avoit fait nommer fels ammo-
•niacaux-tous ceux dans lefquels èntrpit Talcàli vo-
latil, bafe du fel ammoniac, le premier connu de
ces fpls : nous avons donc propofé lernot Amm
o n i a q u e , qui ne diffère de l'ancien que par
fa terminaifon féminine , qu'il falloit.-rendre, clu
-même genre que les deux autres efpèces d'alcalis,
Ja R o t a s s e & la S o u d e , pour dénommer l'alcali
yolatil, &:cette nomenclature ayant été adoptée
aujourd'hui pxefque généralement en France, |
& par; un grand nombre “de chimiftes étrangers , 1
nous nous faifons un devoir de la fuiyre , &
de décrire fous ce nom les propriétés de l'efpèc'e
d'alcali nommé autrefois alcali volatil fluor, alcali
volatil eauftique , &c.
§. II. Des divers procédés fuivis3 *>:t qu'on peut
: fuivre , pour obtenir l 'ammoniaque. • U
Quoique l'ammoniaque foit bien véritablement
un produit de. la nature y un compOfé qu'elle;
forme dans un grand nombre de circonftances ,
comme on le dira en-détail dans le § V , la
tendance à l'union, à la cômbinaifbn , l'attraétion
chimique eft fi forte dans. ce fel alcali, qu'on
ne la trouve que rarement feule, & jamais a (fez
abondamment, ou aflez concentrée , pour fe la
procurer facilement & en quantité fuflifante aux
befoins des arts. On eft donc obligé de la retirer
des combiriaifons où elle exifte 3 oü démettre
en jeu les circonftances naturelles ou l'on
fait qu’èllé fe forme , pour en avoir eh abondance.!
On doit ranger dans la première de ces: deux;
clafles 'de procédés, tous ceux qui confiftent à
decompofer les fels ammoniacaux, & fur-tout le.
muriate. ammoniacs!, par le moyen. dé la chaux
vive. Qn verra dans .l’hiftoire du genre de ces
fels, que la chaux a en général, plus • d’affinité
avec leurs acides, que n'en a l’ammoniaque. Ainfi
en les traitant, & fur-tout le muriate d’ammoniaque
avec une fois & demie leur.poids de chaux
vive , dans une cornue à laquelle on adapte un
petit ballon tubulé , & les flacons de 1-appareilde.
Woulfe, les mots Appareil de W ou.lfe,
Dis t il la t io n , Ga z ):, fammoniaque fondue
en gaz par le calorique qu'elle abforbe, fe dégage
& va fe diffoudre dansl'èau diftillée froide,
où elle eft portée par les tubes de cet appareil.
Î1 n’eft pas queftionde décrire ici avec exactitude
cette opération , qui doit être expofée avec tous
fes détails à l'article du muriate d'ammoniaque s
il n'en faut préfenter que. le réfultar. -'Cleft fie
cette maniéré qu’on obtient communément l'ammoniaque
bien pure, en obfervant toutefois les
précautions qui font indiquées à l'article dëfigné
ci-deflus. Mais il ne fuffit pas de connoïtre St
d'avoir pour les ufages de6 laboratoires de chi-
nde, un feul & unique procédé, pour obtenir
l'ammoniaque ; iL faut que la fcience déployé ici
toutes fes refloufees, & offre toutes fes xichefles
pour l’utilité. Quoique 'ce^foit du rtuuiate amrriohiacal
qù'on extrait prefque toujours l’ammoniaque
, parce que ce muriate eft le fel ammoniacal
le plus abondant que l’on connoifle, tous
les fels ammoniacaux pourroient au befoin fournir
de J'ammoniaque . en les diftillant avec la chaux.
Ainfi dans le cas où l'on auroit par exemple du
fulfate d’ammoniaque plus abondamment que le
muriate ,. comme cela peut avoir lieu dans le
voifinage. des volcans ou plufieurs minéralogiftes
aflurent qu'il fe forme beaucoup de fulfate d'ammoniaque
, onpourra traiter ce fel avec la chaux ,
(k en obtenir l’ammoniaque pure. Il en eft de
même du carbonate d’ammoniaque, qu'on a fi
long-temps regardé comme le véritable alcali volatil
; & qu'on défignoit feulement par l’épithète
de. çoricret. Ç e fel nommé -auffi autrefois fel vo. -
latil d'Angleterre -, Sc qui, malgré fa faturation
par l’acide' carbonique, eft toujours avec excès
d'ammoniaque, toujours odorant , &c. fi l'on
n avoit pas d'autre fel ammoniacal, ou fi oji fe
le procuroit aveennegrande abondance, onpour-
roit au befoin s’en fervir , eh le diftillant avec
de la chaux vive , pour avoir l’ammoniaque pure;
il eft vrai que, le carbonate ammoniacal ou alcali
volatil concret eft .plus précieux pour plufieurs
arts, que l’ammoniaque pure ou l'alcali volatil
fluor & c-auftiquey .mais auffi nous ns parlons en
.ce moment que de la çirconftance où l’on pourroit
fe procurer une plus grande quantité de carbonate
ammoniacal, que les befoins du commerce
ne l'exiger oient, & où il ferqit inçereflant de
préparer de l’ammoniaque pure oü eauftique. Tel
ferait lé cas de plufieurs manufactures, où l’on
travaille des matières animales , dont fouvent on
ne tire pas, à beaucoup près tout le parti poffiblë.
L'opération dont i l . eft quèftion ici , peut être
für-toùt confidérée comme appartenant à la féconde
claffe des procédés qui ont été indiqués
au commencement de ce paragraphe. 11 a été
dit qu'on pouvoit , pour fe procurer l'ammoniaque
, réunir les circonftances où J’obfervation
a appris'qu'il fe formoit une quantité, plus ou
moins grande de ce fel. Ces circonftances peuvent
èn général être rapportées à l'entaffement des
matières animales, & à la déçompofition fpon-
tanée de ces matières.: Dans toutes les manufactures
où l'on traite dés matières animales, &
fpécialement dans celles où l’on cuit les boyaux,,
où f oh fait des cordés d'inftrumens . les colles ,
où l'on travaille les o$v les cornes, J'ecailie, &ç.
dans les lieux ou l'on dépèce les cadavres des
animaux morts , on fait qu'on perd une très*
grande quantité de ces matières , & que la putréfaction
qui s'empare bientôt d’elles , les rend
infupportables à tdus les habitans voifins de ces
lieux. Auffi a-t-on^coutume de placer cesatte-
. liers aux extrémités des villes , dans lés fauxbourgs
& même dans la campagne. A Paris, les boyau-
deries , :les manufactures de: colles, les atteliers
.où l’on cuit les ilfues d'animaux, pour en retirer