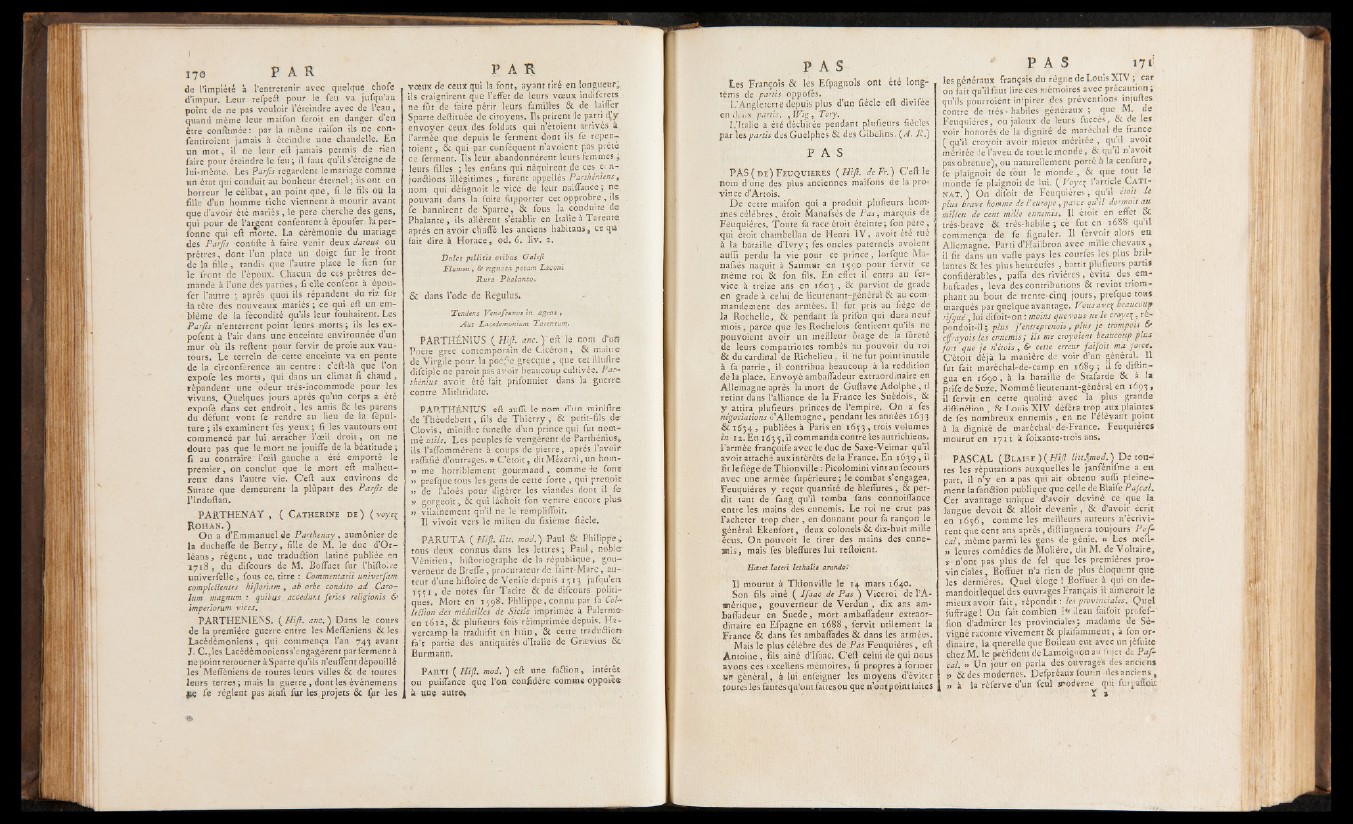
170 P A R
de l’impiété à l’entretenir avec quelque chofe
d’impur. Leur refpeft pour le feu va jufqu’au
point de ne pas vouloir l’éteindre avec de l’eau,
quand même leur maifon feroit en danger d’en
être confirmée : par là même raifon ils ne con-
fentiroient jamais à éteindre une chandelle. En
un mo t, il ne leur eft jamais permis de rien
faire pour éteindre le feii ; il faut qu’il s’éteigne de
lui-même. Les Parfis regardent le mariage comme
«n état qui conduit au bonheur éternel ; ils ont en
horreur le célibat, au point que, fi le fils ôja la
fille d’un homme riche viennent à mourir avant
que d’avoir été mariés , le pere cherche des gens,
qui pour de l’areent confentent à époufer la per-
fonne qui eft morte. La cérémonie du mariage
des Parfis con lifte à faire venir deux darous ou
prêtres, dont l’un place un doigt fur le front
de la fille , tandis que l’autre place le fien fur
le front de l’ époux. Chacun de ces prêtres demande
à l’une de's parties, fi elle confent à epou-
fer l’autre ; après quoi ils répandent du riz fur
iâ tête des nouveaux mariés ; ce qui eft un emblème
de la fécondité qu’ils leur louhaitent. Les
Parfis n’enterrent point leurs morts ; ils les ex-
pofent à Pair dans une'enceinte environnée d’un
mur où ils reftent pour fervir de proie aux vautours.
Le terrein de cette enceinte va en pente
de la circonférence au centre : c’eft-là que l’on
expofe les morts, qui dans un climat fi chaud ,
répandent une odeur très-inçommode pour les
vivans. Quelques jours après qu’un corps a été
expofé dans cet endroit, les amis & les parens
du défunt vont fe rendre au lieu de la fépul-
ture ; ils examinent fes yeux ; fi les vautours ont
commencé par lui. arracher l’oeil droit, on ne
doute pas que le mort ne jouiffe de la béatitude ;
fi au contraire' l’oeil gauche a été emporté le
premier, on conclut que le mort eft malheureux
dans l’autre vie. C’eft aux environs de
Surate que demeurent la plupart des Parfis de
l ’indoflan.
PA R TH EN A Y , ( C a t h e r i n e d e ) ( voyej
R o h a n . )
On a d’Emmanuel de Parthenay, aumônier de
la ducheffe de B e r ry , fille de M. le duc d’Orléans
, régent, une traduéfion latine publiée en
17 18 , du difcours de M. Boflùet fur l’hiftoîre
univerfelle, fous ce, titre : Commentant univerfam
complétantes hifloriam , db orbe condito ad Caro-
lum magnum : quibus accedurt fériés religionis &
imperiornrn vices.
PARTHENIENS. ( Hifi. anc. ) Dans le cours
de la première guerre entre les Mefféniens & les
Lacédémoniens , qui commença l’an 743 avant
J . C.,les Lacédémoniens s’engagèrent par ferment à
ne point retourner à Sparte qu’ils n’eu fient dépouillé
les Mefféniens de toutes leurs villes & de toutes
leurs terres; mais la guerre, dont les événemens
fe règlent pas ainfi fur les projets & fur les
P A R
voeux de ceux qui la font, ayant tiré en longueur*
ils craignirent que l’effet de leurs voeux indifcrets
ne fut de faire périr leurs familles & de laiffer
Sparte deftituèe de citoyens. Ils prirent le parti cÇy
envoyer ceux des foldats qui n’étoient arrives à
l’armée que depuis le ferment dont ils fe repen-.
toient, & qui par conféquent n’avoient pas prête
ce ferment. Ils leur abandonnèrent leurs femmes j
leurs filles ; les enfans qui naquirent de ces c< n-,
jonctions illégitimes , furent appellés Parthéniens,
110m qui défignoit le vice de leur naiffance ; ne
pouvani dans la fuite fupporter cet opprobre , ils
fe bannirent de Sparte, & fous la conduite de
Phalante, ils allèrent s’établir en Italie à Tarente
après en avoir cliaffé les anciens habitans, ce qtt
fait dire à Horace, od. 6. liv. 2.
Dtilce pellitis ovibus Galefi
& regnatapetam JLaconi
Rura Phalanto.
& dans l’ode de Regulus.
Tendens Venafranos in agros ?
j 4ut Laùedemonium Tarentum.
PARTHÉNIÜS {H ifi. anc. f e t t le nom chifî
Poëte grec contemporain, de Cicéron, & maître
de Virgile pour la poéfe grecque , que cet illuftre
diiciple ne paroit pas avoir beaucoup cultivée. Par-
thènius avoit été fait prifonnier dans la guerre
contre Mithridate.
PARTHÉNIÜS eft aufii le nom d’un miniftre
de Théodebert, fils de Thierry , & petit-fils de
Clovis, miniftre funefte d’un prince qui fut nommé
utile. L e s peuples fe vengèrent de Parthénius*
ils l’affommèrent à coups de pierre, après l ’avoir
raffafié d’outrages. » C’étoit, dit Mézerai, un hotn-
» me horriblement gourmand, comme de fon*
» prefquetous les gens de cette forte , qui prenpit
n de l’aloès pour digérer, les viandes dont il fe
». gçrgeôit, & qui lâchoit fon ventre encore plus
» vilainement qu’il ne le rempliffoir.
Il vivoit vers le milieu du fixième fiècle,
PA RU T A ( Hifi. litt, mod.) Paul & Philippe <
tous deux connus dans les lettres; Paul, noble'
Vénitien , hiftoriographe de la république, gouverneur
deBreffe, procurateur de faint-Marc ,,au-
: teur d’itne hiftoire de Venife depuis 1 5 13 jufqu’eu
1 5 5 1 , de notes fur Tacite & de difcours politi-
, ques. Morten 1598. Philippe , connu par fa Col-
IcElion des médailles de Sicile imprimée à Païenne;-
'en 16 12 , & plufieurs fois réimprimée depuis. Hà-
vercamp la traduifit en h tin , & cette trsduâioi»
fart partie des antiquités d’Italie de Grævius &
Burmann.
PART I ( Hifi. mod. ) eft une faftion , intérêt
ou puiffance que l’on confidère comme oppoke®
à une autre«
P A S
Les François & lés Efpagnols ont été long-
tèms de partis oppôfés.
L’Angleterre depuis plus d’un Cède eft divifée
en deux partis. , Wig, Tory.
L’Italie a été déchirée pendant plufieurs fiècles
par les partis des Guelphes & des Gibelins. (A. R.)
P A S
PAS ( d e ) F e u q u i e r e s (H ifi. de Fr.) C’eft le
nom d’une des plus anciennes maifons de la province
d’Artois.
De cette maifon qui a produit plufieurs hommes
célèbres, étoit Manafsès de P a s, marquis de
Feuquières. Toute fa race étoit éteinte; fon père, '
<jui étoit chambellan de Henri I V , avoit été tué
à la bataille d’I v r y ; fes oncles paternels avoient
aufii perdu la vie pour ce prince, lorfque Ma- i
nafsès naquit à Saumwr en 1590 pour fervir ce
même roi & fon fils. En effet il entra au fer-
vice à treize ans en 1,603 , & parvint de grade
en grade à celui de lieutenant-général & au commandement
des armées. Il fut pris au fiège de
la Rochelle,, & pendant fa prifon qui dura neuf
mois, parce que les Rochelois fentirent qu’ils ne
pouvoient avoir un meilleur ôtage de la fureté 1
de leurs compatriotes tombés au pouvoir du roi
& du cardinal de Richelieu, il lie fut point inutile
à fa patrie, il*contribua beaucoup à la reddition
de la place. Envoyé ambaffadeur extraordinaire en
Allemagne après la mort de Guftave Adolphe, il
retint dans l’alliance de la Francè les Suédois, & 1
y attira plufieiirs princes de l’empire. On a fes
négociations d’Allemagne, pendant les années 1633
& 1 6 3 4 , publiées à Paris en 1653 , trois volumes
i n 12 . En 16 3 5 ,11 commanda contre les autrichiens,
l ’armée françoife avec le duc de Saxe-Veimar qu’il
avoit attaché aux intérêts de la France. En 16 3 9 , il
fit le fiège de Thionville : Picolomini vint au fecours
avec une armée fupérieure; le combat s’engagea,
Feuquières y reçut quantité de bleffures, & perdit
tant de fang qu’il tomba fans connoiffance
entre les mains des ennemis. Le roi ne crut pas
l’acheter trop cher , en donnant pour fa rançon le
général Ekenfort, deux colonels & dix-huit mille
écus. On pou voit le tirer des mains des ennemis
, mais fes bleffures lui reftoient.
Haret lateri lethalis arundof
Il mourut à Thionville le 14 mars 1640.
Son fils aîné ( Ifaac de Pas ) Viceroi de l’A mérique,
gouverneur de Verdun , dix ans ambaffadeur
en Suede, mort ambaffadeur extraordinaire
en Efpagne en 1688 , fervit utilement la
France & dans fes ambaffades & dans les armées.
Mais le plus célèbre des de Pas Feuquières, eft
Antoine , fils aîné d’Ifaac, C’eft celui de qui nous
avons ces excellens mémoires, fi propres à former
un général , à lui enfeigner les moyens d’éviter
foutes les fautes qu’ont faites ou que n’ont point laites
P A S 1 7 $
les généraux français du règne de Louis X IV ; car
on fait qu’il faut lire ces mémoires avec précaution ;
qu’ils pourroient infpirer des préventions injuftes
contre de très - habiles généraux ; que M. de
Feuquières, ou jaloux de leurs fuccès, & de les
voir honorés de la dignité de maréchal de francc
( qu’i l croyoit avoir mieux méritée , qu’il avoit
m éritée de l’aveu de tout le monde, & qu ïl n avoit
pas obtenue), ou naturellement porté à la cenfure,
fe plaignoit de tout le monde , & que tout le
monde fe plaignoit de lui. ( Voye{ l’article C a t i -
N A T . ) On difoit de Feuquières, qu’il étoit le
plus brave homme de Veurepe, parce qu il dormoït au
milieu de cent mille ennemis. Il étoit en effet &
très-brave & très-habile ; cè fut en 1688 qu’il
commença de fe fignaler. Il fervoit alors en
Allemagne;. 'Parti d’Hailbron avec mille chevaux,
il fit dans un vafte pays les courfes les plus brillantes
& les plus heureufes , battit plufieurs partis
confidérables, paffa des rivières, évita des em-
bufeades , leva des contributions & revint triomphant
au bout de trente-cinq jours, prefque tous
marqués par quelque avantage. Vous ave1 beaucoup
rifqué, lui difoit-on : moins que vous ne le croye{ , ré-
pondoit-il; plus j*entreprends, plus je trompois &
effrayais les ennemis; ils me croyoient beaucoup plus
fort que je riétois, & cette erreur faifoit ma force.
C’ètoit déjà la manière de voir d’un général. 11
fut fait maréchal-de-camp en 1689 ; il fe diftin-
gua en 16 9 0 , à la bataille de Stafarde &. a la
prife de Suze. Nommé lieutenant-général en 1693 ,
il fervit en cette qualité avec la plus grande
diftinaion , & Louis X IV déféra trop aux plaintes
de fes nombreux ennemis, en ne l’élèvant point
à la dignité de maréchal-de-France. Feuquières
mourut en 1 7 1 1 à foixante-trois ans.
PA SCA L ( B l a i s e ){H ift. litt.\mod.) De toutes
les réputations auxquelles le janfénifme a eu
part, il n’y en a pas qui ait obtenu aufii pleinement
lafanaion publique que celle deBlaife Pafcal.
Cet avantage unique d’avoir deviné ce que la
langue devoit & aïloit devenir, & d’avoir écrit
en 16 5 6 , comme les meilleurs auteurs n’écrivirent
que cent ans après, diftinguera toujours Pafcal,
même parmi les gens de génie. « Les meil-
» leures comédies de Molière, dit M. de Voltaire,
»■ n’ont pas plus de fel que les premières provinciales,
Boflùet n’a rien de plus éloquent que
les dernières. Quel éloge ! Boflùet à qui on de-
mandoitlequel des ouvrages Français il aimerait le
mieux avoir fait, répondit : les provinciales. Quel
fuffrage 1 On fait combien I * ileau faifoit profef-’
fion d’admirer les provinciales; madame de Sé-
vigné raconte vivement & plaifamment, à fon ordinaire
, la querelle que Boileau eut avec un jéfuite
chez M. le pcéfldent de Lamoignon au fnjèt de Pafcal.
» Un jour on parla des ouvrages des anciens
!» & des modernès. Defpréaux founn îles anciens,
» à la réferve d’un feul moderne qui fui pafloit