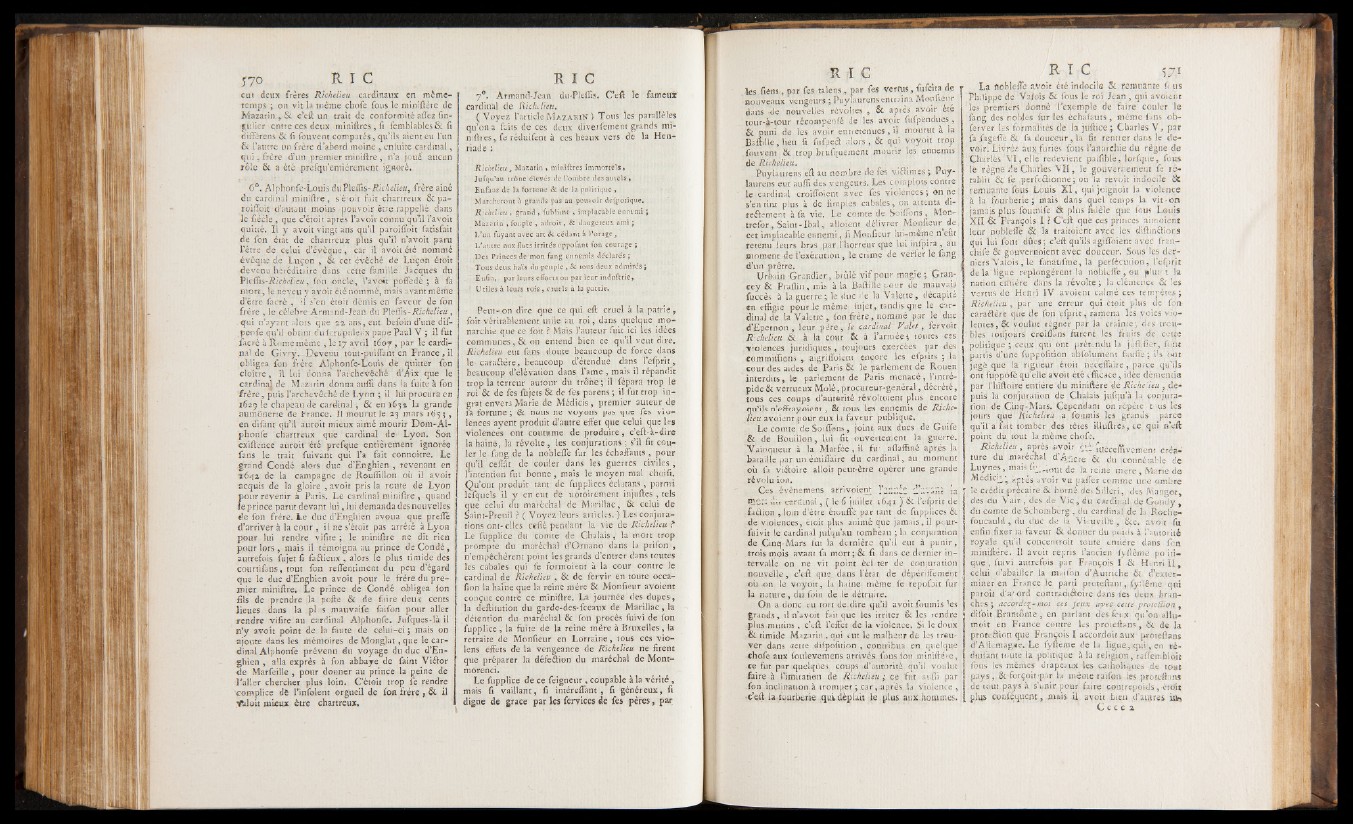
57° R I C
eur deux frères Richelieu cardinaux en même-
temps ; on vit la même chofe fous le miniftére de
Mazarin , & e’eft un trait de conformité affez fin-
guüer entre ces deux miniftres, fi femblables & fi
différens Sc fi fouvent comparés, qu’ils aient eu l’un
6c l’autre un frère d’abord moine , en fuite car dinal,
qui,.frère d’un premier miniftre , n’a joue aucun
rôle 8c a été prefqu’entièrement ignoré,
6 °. Alphonfe-Louis du V\zft\s- Richelieu, frère ainé
du cardinal miniftre, s’é'O'i't fait chartreux & pa-
roiffoit d’autant moins pouvoir être rappelle dans
le fiècle, que c’étoit après l’avoir connu qinl l’avoit
quitté. Il y avoit vingt ans qu’il paroifioit fat'isfait
de fon état de chartreux plus qu’il n’avoit paru
l’être de celui d’évêque, car il avoit été nommé
évêque de Luçon , &. cét évêché de Luçon étoit
devenu héréditaire dans cette famille. Jacques du
Vtefàs-Richelleu, fon oncle, l’à voit poffedé ; à fa
mort, le neveu y avoir été nommé, mais avant même
d’être facré , il s’en étoit démis en faveur de fon
frère , le célébré Arm and-Jean du Pleftis-Richelieu ,
qui n’ayant alors que 2.2. ans, eut befoin d’une dif-
penfe qu’il obtint duicrupuleiix pape Paul V ; il fut
facré à Rome même , le 17 avril 16 0 7 , par le cardinal
de Givry. -Devenu tout-puiffant en France , il
obligea fon frère Alphonfe-Louis de quitter fon
cloître, il lui donna l'archevêché d'Aix que le
cardinal de Mazarin donna aufli dans la fuite à fon
frè re , puis l’archevêché dé Lyon ; il lui procura en
1.629 le chapeau de cardinal, 8c en 1632 la grande
aumônerie de France. Il mourut le 23 mars 1 6 5 ; ,
en difant qu’il aurôit mieux aimé mourir Dom-Al-
phonfe chartreux que cardinal de Lyon. Son
exifténce aurüit été prefque entièrement ignorée
fans le trait fuivant qui l’a fait connokre. Le
grand Condé alors duc d’Enghien , revenant en
16 4 2 de la campagne de Rouffillon où il avoit
acquis de la gloire , avoit pris la route de Lyon
pour revenir à Paris. Le cardinal miniftre , quand
le prince parut devant lui, lui demanda des nouvelles
de fon frère. Le duc d’Enghien avoua que prefle
d’arriver à la cour , il ne s’étoit pas arrêté à Lyon
pour lui rendre vifite ; le miniftre ne dit rien
pour lors , mais il témoigna au prince de Condé,
autrefois fujet fi faâieux , alors le plus timide des
courtifans, tout fon refientiment du peu d’égard
que le duc d’Enghien avoit pour le frère du premier
miniftre. Le prince de Condé obligea fon
fils de prendre la pofte & de faire deux cents
lieues dans la pi s mauvaife faifon pour aller
rendre vifite au cardinal Alphonfe. Jufques-là il ;
n’y avoit point de la faute de celui-ci ; mais on
ajoute dans les mémoires de Monglat, que le cardinal
Alphonfe prévenu du voyage du duc d’Enghien
, alla exprès à fon abbaye de faint Vi&or
de Marfeille , pour donner au prince la peine de
l ’ aller chercher plus loin. C’étoit trop fe rendre
complice dè l’infolent orgueil de fon frère , & il
yaloit mieux être chartreux.
R I C
70. Armand-Jean du-Pleflis. C’eft le fameui'
cardinal de Richelieu.
(Vo y e z l’article M a z a r i n ) Tous les parallèles
qu’on a faits de ces deux diversement grands miniftres,
fe réduifent à ces beaux vers de la Hen-
riade ;
Richelieu j Mazarin , nvîniftres immortels,
Jutqu’au trône élevés de l’ombre des auiels ,
Enfans dç la fortune & de la politique ,
Marcheront à grands pas au pouvoir despotique.
Richelieu , grand , Sublime , implacable ennemi J
Mazarin , foupïe , adroit, & dangereux ami ;
I/un fuyant avec art & cédant à l’orage,
L’autre aux flots irrités oppofant fon courage ;
Des Princes dé'mon fan g ennemis déclarés ;
Tous deux haïs du peuple , & lous'deux admirés;
Enfin, par leurs efforts ou par leur induftrie,
i Utiles à leurs rois , cruels à la patrie.
Peut-on dire que ce qui eft cruel à la patrie,
foitvéritablement utile au ro i, dans quelque monarchie
que ce foit ? Mais l’auteur fuit ici les idées
communes, & on entend bien ce qu’il veut dire.
Richelieu eut fans doute beaucoup de force dans
le- cara&ère, beaucoup d’étendue dans l’efprit,
beaucoup d’élévation dans l’ame , mais il répandit
trop la terreur autour du trône; il fépara trop le
roi & de fes ftijets 8c de fes parens ; il fut trop ingrat
envers Marie de Médicis , premier auteur de
fà fortune ; 8t nous ne voyons pas que fes violences
ayent produit d’autre effer que celui que les
violences ont coutume de produire, c’eft-à-dire
la haine, la révolte , les conjurations ; s’il fit couler
le fang de la noblefle fur les échaffauts , pour
qu’il ceflât, dé couler dans les guerres civiles ,
l’intention fut bonne, mais le moyen mal choifi.
Qu’ont produit tant de fuppiiees éclatans, parmi
lefquels il y en eut dre notoirement injuftes , tels
que celui du maréchal de Mar illac, & celui de
Saint-Preuil ? ( Voyez leurs articles.) Les conjurations
ont-elles ceflé pendant la vie dq Richelieu ?
Le fupplice du comte de Ghalàis , la mort trop
prompte du maréchal d’Ornano dans la prifon ,
n’empêchèrent point les grands d’entrer dans toutes
les cabales qui fe formoient à la cour contre le
cardinal de Richelieu , & de fervir en toute occa-
fion la haine que la reine mère & Monfieur avoient
conçue contre ce miniftre. La journée des dupes,
la dèftitution du garde-des-fceaux de Marillac, la
détention du maréchal & fon procès fuivi de fon
fupplice, la fuite de la reine mère à B ruxelles, la
retraite de Monfieur en Lorraine, tous ces vio-
lens effets de la vengeance de Richelieu ne firent
que préparer la défeâion du maréchal de Mont-
morenci.
Le fupplice de ce feigneur, coupable à la vérité,
mais fi vaillant, fi intéreffant , fi généreux, fi
digne de grâce par les feryiees de fes pères, par
■ bs.fiêns, par fes. talerçs., par fes verftis, fufeita de
Bouveaux vengeurs ; Puylaurens entraîna Monfieur
dans -de nouvelles révoltes , 8c après avoir été
tour-autour récompenfé de les avoir fufpendues ,
& puni da les avoir entretenues, il mourut a la
Baftilie, lieu fi fufpect alors , 8c qui Yoyoit trop
fou vent 8c trop brufquement mourir les ennemis
de Richelieu.
Puylaurens eft au nombre de fes viffimes ; Puy-
laurens eut aufli des .vengeurs. Les complots contre
le cardinal croifloient avec fes violences ; on ne
s’en tinx plus à de firnpies cabales, on attenta di-
reâement à fa vie. Le comte de Soi fions, Mon-
trefor, Saint-Ibal, aLloient délivrer Mpnfieur de,
cet implacable ennemi, fi Monfieur lui-même n eiit
retenu leurs bras par l’horreur que lui infpira, au
moment de l’exécution , le crime de verfer le fang
d’un prêtre,
Urbain Granclier,, brûlé v if pour magie ; Gran-
cey & Praflin, mis à la Baftille pour de mauvais
fuccès à la guerre; le duc çl# la Valette, décapité
en effigie pour le même fujet, tandis que le cardinal
de la Valette , fon frère, nommé par le duc
d’Epernon , leur père , le cardinal Valet, fervoit
Richelieu & à la cour & à l’armée; tomes ces
violences juridiques , toujours exercées par des
commillions aigriffoient encore les efpiits ; la
cour des aides de Paris & le parlement de Rouen
interdits, le parlement de Paris menacé, l’intrépide
& vert«eux Mole,procureur-genèral, décrété,
tous ces coups d’autorité révoltoient plus encore
qu’ils n’effrayoient, & tous les ennemis de Richelieu
avoient .pour eux la faveur publique.
Le comte de Soi fions, joint-aux ducs de Guife
& de Bouillon, .lui fit ouvertement la guerre.
Vainqueur à la Marfée , il fir a Raffiné après la
bataille par un émjflaire du cardinal, au moment
où-fa vi&oire allo.it peut-être opérer une grande
révolu ion.
Ces événemens a fri voient la,
mer; du cardinal, ( le 6 juillet 16 4 1 ), 8c lVfprit de
Fadion , loin d’être étouffé par tant de fupplices 8 r
de violences, étoit plus animé que jamais, il pour-
fuivit le cardinal jufq.u’au tombeau ; la conjuration
de Cinq-Mars fut la dernière qu’il eut à punir,
trois mois avant fa mort; & fi, dans ce dernier intervalle
on ne vit point écl.ter de conjuration
nouvelle, c’eft que dans l’état de dépériffemeot
où on le voyoit, la haine même fe repofoit fur
la nature, du foin de le détruire.
On a donc eu tort de.dire qu’il avoit fournis les
grands, il n’avoit fait que les irriter 8c les rendre
plus mutins , ç’eft l’effet de la violence. Si le doux
& timide Mazarin, qui tut le malheur de les trouver
dans eette difpofition , contribua en quelque
chofe aux foulevemens arrivés.,fousion miniftére,
ce fut par quelques coups vd’autorité qu’il voulut ;
faire à l’imitation de Richelieu ; ce fut aufli par '
fon inclination à tromper ; car, après la violence ,
•c’eft la.fourberie qui déplaît le plus aux.hoaimes. ■
La noblefle avoit été indocile 5c remuante fi us
Philippe de Valois 8c fous le roi Jean , qui avoient
les premiers donné l’exemple de faire couler Je
fang des nobles fur les échafaurs, même fans ob-
ferver les formalités de la juftice ; Charles V , par
fa Jagefle &, fa douceur, la fit rentrer dans le devoir.
Livrée auxfuries fous l’anarchie du règne de
Charlês VI, elle redevient paifible, lorfque, fous
le règne de ChaVles V I I , le gouvernement fe rétablit
8c fe perfedionne; on la revoit indocile &
remuante fous Louis X I , qui joignoit la violence
à la fourberie ; mais dans quel temps la vit*on
jamais plus foumife & plus fidèle que fous Louis
X II 6c François I ? C ’eft que ces princes aimoient
leur nobleffé & la traitoient avec les diftindiors
qui lui font dues ; c’eft qu’ils agiffoient avec franchi
fe 6c gouveriîoient avec douceur. Sons les derniers
Valois , le fanatifme, la perfécution , l’efprit
de la ligue replongèrent la noblefle, ou plut't la
nation entière dans la révolte ; la clémence & les
vertus de Henri IV avoient calmé ces tempêtes;
Richelieu, par une erreur qui étoit plus de fon
caradèré que de fon efprit, ramena les voies violentes,
8c voulut régner par la crainte; des troubles
1 o il jour s' croiffans furent lès fruits de cette
politique ; ceux qui ont prétendu la juftlfier, font
partis d’une fuppofition abfolumem faufle ; ils cuit
jugé que la rigueur étoit nécéflaire, parce qu’ils
ont fuppofé quelle avoit été efficace, idée démentie
par l'hiftoire entière du miniftére de Riche'ieu , depuis
la conjuration de Chalais jufqu’à la conjuration
de Cinq-Mars. Cependant on répète t us les
jours que Richelieu a fournis les grands parce
qu’i la fait tomber des têtes illuftres, ce qui n’eft:
point du tout la même chofe.
Richelieu , après avoir r f ; Juiceffivcment créature
du maréchal d Ancre & du connétable de
Luynes, matsO ._lom de la reine mère , Marie de
Medicn 1, après avoir vu paffer comme une ombre
le crédit précaire 8c borné dei. Silleti, des Mangôt,
des du Vair , des de Vie,, du cardinal de Gondy ,
du comte de Sc bomber g , du cardinal de la Rochefoucauld
, du duc de la Vicuvilîfe, 8çc. avoit fu
enfin fixer ia faveur & donner du poids à l’autorité
royale qu’il concentroit toute entière dans fen
miniftére. Il avoir repris l’ancien fyftême poétique
, fuivi autrefois par François I 8c Henri I I ,
celui d’àbajfler la maifon d’Autriche 8c d’exterminer
en France le parti proteftant, fyftême qui
paroît d'af ord comradi&oire dans fes deux branches;
accorde^-moi ces Jeux avec cette proteéïion ,
dit oit Brantôme, en parlant des feux qu’on al lu-
moit en France contre les proteftans, 8c de la
proteâion que François I accordoit aux proteftans
d’Ailemagae. Le fyftême de la ligue,vqui, en ré-
duifant toute la politique à la religion, raflçmbk>it
fous les mêmes' drapeaux les catholiques de toyt
pays , 8c forçoit’.par la même rai fon les proteftans
, de tout pays à s’unir pour faire contrepoids , étoit
pjiis conféquentmais il avoir bien ,d’autres iürv
C c c c a