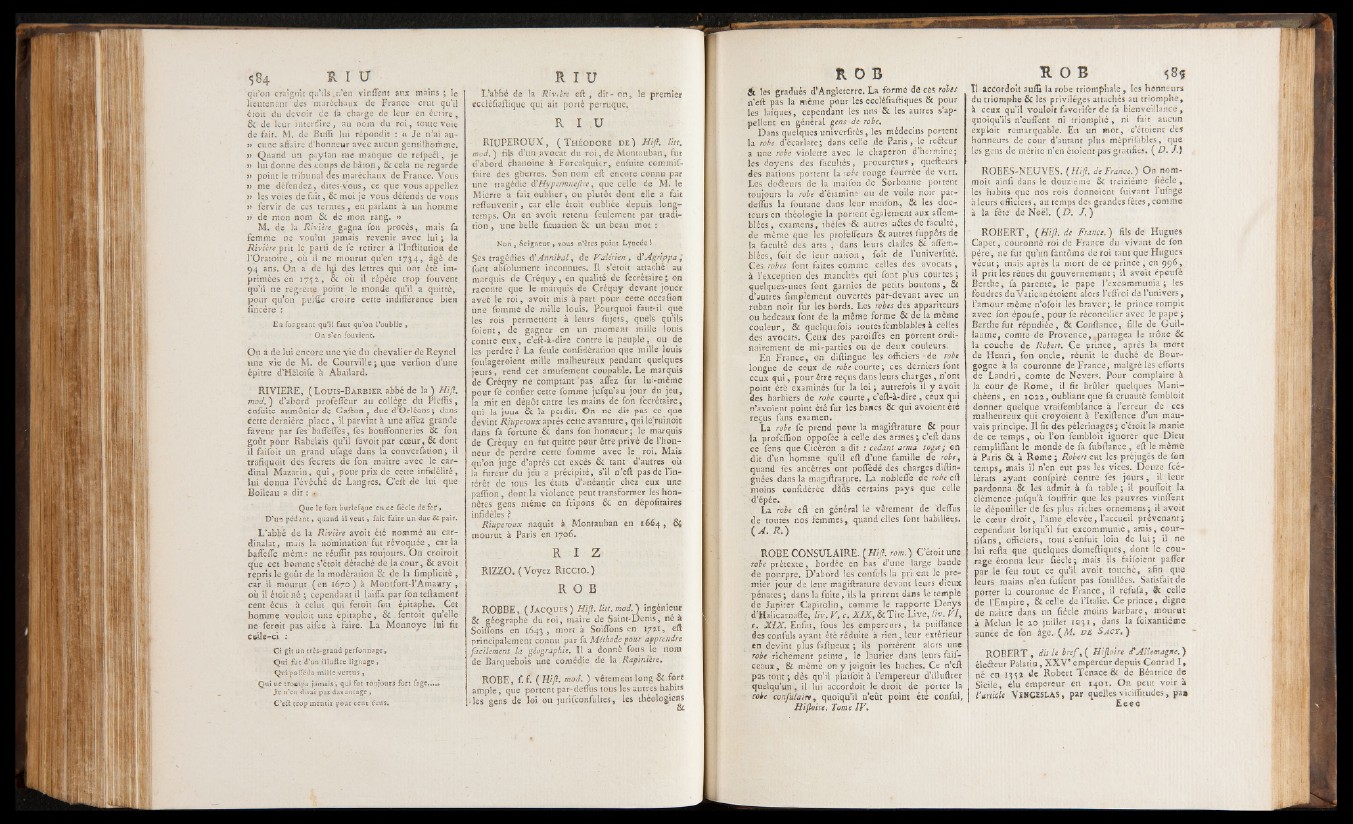
584 R I U R I U
qu’on craignît qu’ils .n’en vinflent aux mains ; le
lieutenant des maréchaux de France crut qu’il
étoit .du devoir cîe fa charge de leur en écrire,
& de leur interdire, au nom du ro i, toute voie
de fait. M. de Suffi- lui répondit : « Je n’ai au-
» cune affaire d’honneur avec aucun gentilhomme.
yy Quand un paytan me manque de refped, je
j> lui donne des coups de bâton, Sc cela ne regarde
» point le tribunal des maréchaux de France. Vous
m me défendez, dites-vous, ce que vous appeliez
yy les voies de fait, 8c moi je vous défends de vous
j> fervir de ces termes, en parlant à un homme
J» de mon nom & de mon rang. »
M. de la R iv iè r e gagna fon procès, mais fa
femme nç voulut jamais revenir avec lui ; la
R i v iè r e prit le parti de fe retirer à l’Inftitutioa de
l’Oratoire, où il ne mourut qu’en 17 3 4 , âgé de
94 ans. On a de lui des lettres qui ont été imprimées
en 17 5 2 , & où il répète trop fouvent
qu’il ne regrette point le monde qu’il a quitté,
pour qu’on puifle croire cette indifférence bien
liiicère :
En fongeant qu’il faut qu’on l’oublie ,
" On s’en fouvient.
On a de lui encore une vie du chevalier de Reynel
une vie de M. de Courville ; qne vérfion d’une
épitre d’Hèloïfe à Abailard.
R IV IER E , ( Louis-Barbier abbé de la ) Hift.
mod. ) d’abord profeffeur au collège du Pleffis,
ênfuite aumônier de Gafton , duc d’Orléans ; dans
cette dernière place, il parvint à une allez grande
faveur par fes bafTeffes, fes bouffonneries & fon
goût pour Rabelais qu’il favoit par coeur, 8c dont
il faifoit un grand ufage dans la converfation ; il
trafiquent dés fecrets 'de fon maître avec le cardinal
Mazarin, q u ip o u r prix de cette infidélité,
lui donna l’évêché de Langres. C’eft de lui que
Boileau a dit : 4,
Que le fort burlefque en ce fiècle de fer,
D’un pédant, quand il veut, fait faire un duc & pair.
L ’abbé de la Rivière avoit été nommé au cardinalat,
mais la nomination1 fut révoquée, caria
baffeffe même ne réuffit pas toujours. On croiroit
que cet homme s’étoit détaché de Ja cour, & avoit
repris le goût de la modération & de la fimplicité ,
car il mourut (en 1670 ) à Montfort-l’Amaary ,
où il étoit né ; cependant il lai (Ta par fon teftamenf
cent écus à celui qui feroit fon épitaphe. Cet
homme voulcit uns épitaphe, & . fentoit qu’elle
ne- ferait pas aifée à faire. La Monnoye lfcfi fit
ceile-ci :
Ci gît un,très-grand perfonnage,
Qui fut d’un jlluftre lignage ,
Qui polTéda mille vertus ,
Qui ne trompa jamais', qui fut toujours fort fage.,,.,
Je n’en dirai pas davantage,
C’eft trop mentir pour cent écus.
L’abbé de la Rivière eft , dit - on, le premier
eedéfiaftique qui ait porté perruque,
R I U
R IU P ERO U X , ( T h é o d o r e d e ) Hiß.. litt.
mod. \ fils d’un avocat du ro i, de Momauban, fut
d’abord chanoine à Fercalquier, enfuite commit-
faire des g'îterres. Son nom eft encore connu par
une tragédie d’Hypermneftre, que celle de M. le
Mierre a fait, oublier, ou plutôt dont elle a fait
reffouvenir, car elle étoit oubliée depuis longtemps.
On en avoit retenu feulement par tradition
, une belle fituation & un beau mot :
Non, Seigneur , vous n’êtes point Lyncée |
Ses tragédies d'A nnib a l , de Valerien, d’Agrippa $
font abfolument inconnues. Il s’étoit attaché\ au
marquis de Créqiiy , en qualité de fecrétaire; on
raconte que le marquis de Créquy devant joùër
avec le ro i, avoit mis à part pour cette ©ccafion
une femme de mille louis. Pourquoi faut-il que
les rois permettent à leurs fujets, quels qu’ils
foient, de gagner en un moment mille louis
contre eux , c’eft-à-dire contre le peuple, ou de
les perdre ? La feule confidération que mille louis
foulageroient mille malheureux pendant quelques
jeurs, rend cet amufement coupable. Le marquis
de Créquy ne comptant'pas affez fur lui-même
pour fe confier cette fomme jufqu’au jour dû jeu,
la mit en dépôt entre les-mains de fon fecrétaire,
qui la joua & la perdit. On ne dit pas ce que
devint Riuperoux après cette avanture, qui le’ruinoit
dans fa fortune 8c dans fon honneur; le marquis
de Créquy en fut quitte pour être privé de l’honneur
de perdre cette fomme avec le roi. Mais
qu’on juge d’après cet excès & tant d’autres où
la fureur du jeu a précipité, s’il n’eft pas de l’intérêt
de tous les états d’anéantir chez eux une
paffion, dont la violence peut transformer les honnêtes
gens même en fripons & en dépofitaires
infidèles ?
Riuperoux naquit à Montauban en 16 6 4 , &
mourut à Paris en 1706.
R I Z
RIZZO. ( V o y e z R i c c i o . )
R O B
RO BBE , ( J a c q u e s ) Hiß. litt, mod.) ingénieur
& géographe du roi, maire de Saint-Denis, ne à
Soiübns en 1643 , mort à Soiffons en 17 11» eft
principalement connu par fa Méthode pour apprendre
facilement la géographie. Il a donné fous le nom
de Barquébois une comédie de la .Rapiniete.
RO B E , f. fi ( Hiß. mod. ) vêtement long 8c.f©rt
ample, que portent par-deflùs tous les autres habits
j. les gens de loi ou juriiconfultes, les théologiens
R O B
& les gradués d’Angleterre. La forme dô cès robes
n’eft pas la même pour les eccléfiaffiques & pour
les laïques, cependant les uns & les autres s’appellent
en général gens'de robe.
Dans quelques univerfirés, les médecins portent
la robe d’écarlate; dans celle de Paris, le re&eur
a une robe violette avec le chaperon d’hermine;
les doyens des facultés, procureurs, quefteurs
des nations portent la robe rouge fourrée de vert.
Les dodeurs de la mai fon de Sorbonne portent
toujours la robe d’étamine- ou de voile noir par- ;
deffiis la foutane dans leur maifon-, 8c les doc- j
teurs en théologie la portent également aux aflem-
blées, examens, thèles v8c autres ades de faculté,
de même que les profefleurs 8c autres fuppôts de
la faculté des arts , dans leurs cia fies 8c a Semblées.,
foit de leur nation, foit de l’univerlité.
Ces robes font faites comme celles des avocats,
à l’exception des manches qui font plus courtes ;
quelques-unes font, garnies de petits boutons, 8c
d’autres fimplement ouvertes par-devant avec un
ruban noir fur les bords. Les robes des appariteurs
ou bedeaux font de la même forme 8c de la même
couleur, 8c quelquefois toutesfemblables à celles
des avocats. Ceux des paroilTes en portent ordinairement
de mi-parties ou de deux couleurs.
En France, on diftingue les officiers-de robe
longue de ceux de robe courte ; ces derniers font
ceux qui, pour être reçus dans leurs charges, n’ont
point été examinés fur la loi ; autrefois il y avoit
des barbiers de rohe courte , c’eft-à-dire, ceux qui
n’avoient point été fur les bancs 8c qui avoient éié
reçus fans examen.
La robe fe prend pour la magiftrature 8c pour
la profeffion oppoféë à celle des armes; c’eft dans
ce feiîs que Cicéron a dit ; cedant arma togx; ©n
. dit d’un homme qu’il eft d’une famille de robe,
quand fes ancêtres ont poffédé des charges diftin-
guées dans la magiftrature. La nobleffe de robe eft
moins confédérée dans certains pays que celle
d’épée.
La robe eft en général le vêtement de 'deffiis
de toutes nos femmes, quand elles font habillées.
{ A . R .)
ROBE CONSULAIRE. ( Hiß. rom.) C’étoîtune
robe prétexte, bordée en bas d’une large bande
de pourpre. D’abord les confuls la prùent le premier
jour de leur magiftrature devant leurs dieux
pénates; dans la fuite, ils la prirent dans le temple
de Jupiter Capitolin, comme le rapporte Denys
d’Halicarnafle, lïv. V, c. X IX , 8cTite Live, liv. V I,
c. X IX . Enfin, fous les empereurs, la puiffance
des confuls ayant été réduite à r ie n le u r extérieur
en devint plus fsftueux ; ils portèrent alors une
robe richement peinte, le laurier dans leurs faif-
ceaux, 8c même on y joignit les haches. Ce n’eft
pas tout ; dès qu’il plaifoit à l’empereur d’illuftrer
quelqu’un , il lui accordoit le droit de porter la
robe confulairt, quoiqu’il n’eût point été conful,
Hiftoire, Tome IV .
H O B
It âcCordoît suffi la robe triomphale , les honneurs
du triomphe 8c les privilèges attachés au triomphe,
à ceux qu’il vouloir favorifer de la bienveillance ,
quoiqu’ils n’eu fient ni triomphé, ni fait aucun
exploit remarquable. En un mot, c’étoient des
honneurs.de cour d’autant plus méprifables, que
les gens de mérite n’en étoient pas gratifiés. ( D. J.)
ROBES-NEUVES. (Hift. de France.) On nom-
moi c ainfi dans le douzième 8c treizième fiècle,
les habits que nos rois donnoient fuivant l’ufage
à leurs officiers, au temps des grandes fêtes, comme
à la fête de Noël. (Z J. J . )
R O B E R T , (Hift. de France.) fils de Hugues
Capet, couronné roi de France du vivant de fon
père, ne fut qu’un fantôme de roi tant que Hugues
vécut ; mais après la mort de ce prince , en 996 ,
il prit les rênes du gouvernement ; il avoit époufé
Berthe, fa parente, le pape l'excommunia’ ; les
foudres du Vatican étoient alors l’effroi de l’univers,
l’amour même n’ofoit les braver;, le prince rompit
avec fon époufe, pour fe réconcilier avec le pape ;
Berthe fut répudiée, 8c Confiance, fille de Guillaume,
comte de Provence,^partagea le trône 8c
la couche de Robert. Ce prince, après la mort
de Henri, fon oncle, réunit le duché de Bourgogne
à la couronne de France, malgré les efforts
de Landri, comte de Nevers. Pour complaire à
la cour de Rome, il fit brûler quelques Manichéens
, en io a a , oubliant que fa cruauté fembloit
donner quelque vraifemblance à l’erreur de ces
malheureux qui croyoient à l’exîftence d’un mauvais
principe. Il fit des pèlerinages; c’étoit la manie
de ce temps , où l’on fembloit ignorer que Dieu
rempliflant le monde de fa fubftance , eft le mêmé
à Paris & à Rome ; Robert eut les préjugés de (on
temps, mais il n’en eût pas les vices. Douze fcé-
lérats ayant confpiré contre fes jours, il leur
pardonna 8c les admit à fa table ; il pouftbit la
clémence jufqu’à fouffrir que les pauvres vinflent
le dépouiller dé fes plus riches ornemens; il avoit
le coeur droit, l’amerélevée, l’accueil prévenant;
cependant lorfqu’il fut excommunié, amis, cour-
tifans, officiers, tout s’enfuit loin de lu i; il ne
lui refta que quelques domeftiques, dont le courage
étonna leur fiècle; mais iis faifoient paffer
par le feu tout ce qu’il avoit touché, afin que
leurs mains n’en fuffent pas fouillées. Satisfait de
porter la couronne de France, il refufa, & celle
de l’Empire , 8t celle de l’Italie. Ce prince , digne
de naître dans un fiècle moins barbare, mourut
à Melun le 20 juillet 10 3 1 , dans la foixantième
année de fon âge. (M . d e S a c y . )
RO BER T , dit le bref, ( Hiftoire d*Allemagne. )
éledeur Palatin, X X V e empereur depuis Conrad I ,
né en 13 <>2 de Robert Tenace 8c de Béatrice de
Sicile, élu empereur en 14 0 1. On peut voir à
T article VlNCESLAS, par quellesviciffitudes, pa»
E e e e