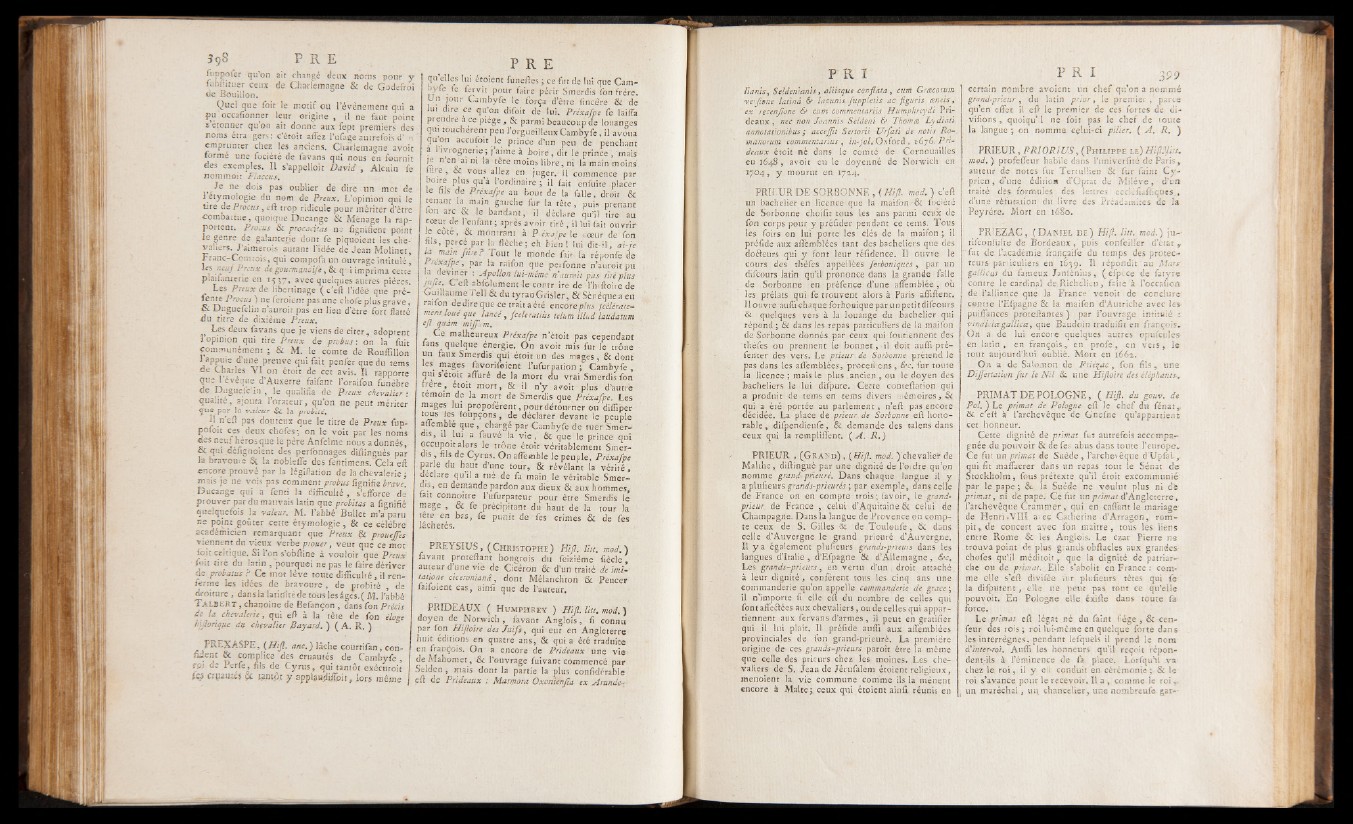
fuppofer qu’on ait changé «leux noms pour y
fubftituer ceux de Charlemagne & de Godefroi
de Bouillon.
Quel que foit le motif ou l’évènement qui a
pu'occafionncr leur origine , il ne faut point
s etonner qu’on ait donné aux fept premiers des
noms étra gers; c’étoit affez l’ufage autrefois d* n
emprunter chez les anciens. Charlemagne avoit
formé une fociété de favans qui nous en fournit
des exemples. Il s’appelloit David , Alcuin fe
nommoit Fiaccus.
ne dois pas oublier de dire un mot de
1 et^ mologie du nom de Preux. L’opinion qui le
dre de Procus , eft trop ridicule pour mériter d’être
combattue, quoique Ducange & Ménage la rapportent.
Procus 8c procacitas ne lignifient point
le genre de galanterie dont fe piquoient les ehe-
yahers. J ’aimerois autant l’idée de Jean Molinet,
Franc-Comtois, qui compofa un ouvrage intitulé
/leuf P fcux degourmanoife, & q-.i imprima cette
plaifanterie en 1-537,. avec quelques autres pièces.
Les Preux de libertinage ( c’eft l’idée que prélente
Procus ) ne feroient pas une chofe plus grave,
&. Duguefclin n’auroir pas eu lieu d’être fort flatté
du titre de dixième Preux.
Les deux favans que je viens de citer, adoptent
l’opinion qui tire Preux de probus : on la fuit
Communément ; & M. Te comte de Rouffillon
1 appuie d’une preuve qui fait penfer que du tems
de Charles V I on étoit de cet avis. Il rapporte
que l evêque d’Auxerre faifant l’oraifon funèbre
de Duguefc.iu , le qualifia de Preux chevalier :
qualité, ajouta l’orateur, qu’on ne peut mériter
que par la valeur & la probité.
U n’eft pas douteux que le titre de Preux fup-
pofoit ces deux chofes; on le voit par les noms
des neuf héros que le père Anfelme nous a donnés,
qui.défignoient des perfonnages diftingués par
la bravouie & la nobleffe des fentimens. Cela eft
encore prouvé par la légiflation de la chevalerie ;
mais je ne vois pas comment probus fignifie brave.
Ducange qui a fenti la difficulté, s’efforce de
prouver par du mauvais latin que probïtas a fignifié
quelquefois la valeur. M. l’abbé Bullet m’a paru
ne point goûter cette étymologie, & ce célèbre
académicien remarquant que Preux & proueffes
viennent du vieux verbe prouer, veut que ce mot
foit celtique. Si l’on s’obftine à vouloir que Preux
foit tiré du latin , pourquoi ne pas le faire dériver
de probatus ? Ce mot lève toute difficulté, il renferme
les. idées de bravoure , de probité , de
droiture, dans la latinité de tous les âges. ( M. l’abbé
T a l b e r t , chanoine de Befançon , dans fon Précis
de la chevalerie, qui eft à la tête de fon éloge
bijlorique dtj. chevalier Bayard, ) ( A . R. )
PREX ÂSPE , (Hijl. anc. ) lâche eourtifan , confident
& complice des cruautés de Cambyfe,
rpi de Perfe, fils de C yrus, qui tantôt exécutoit
fe 5 cruautés & tantôt y applaifoiffpit, lors même
qu’elles lui étoient funeftes ; ce fut de lui que Cam-
yfe fe fervic pour faire périr Smerdis fon frère.
Un jo u r Cambyfe le força d’être fincère & de
lui dire ce qu’on difoit de lui. Préxqfpe fe laiffa
prendre ace piège, & parmi beaucoup de louanges
qui touchèrent peu l’orgueilleux Cambyfe, il avoua
qu on accufoit le prince d’un peu de penchant
a ivrognerie; j aime à boire, dit le prince , 'mais
je n en ai ni la tête moins libre, ni la main moins
Ju re , & vous allez en juger. - 11 commence par
oire plusquà l’ordinaire; il fait enfuite placer
le fils de Préxafpe au bout de la falle, droit &
tenant la.main gauche fur la tête, puis prenant
fon arc & le bandant, il déclare qu’il tire au
coeur de l’enfant ; après avoir tiré , il lui fait ouvrir
le cote, & montrant à P éxajpe le «coeur de fon
fus, percé par la flèche; eh bien ! lui dit-il, ai-je
la main ju r e ? Tout le monde fair la réponfe de
Préxafpe , par la raifon que peifonne n’auroit pu
la deviner : Apollon lui-même n au mit pas' tiré plus
jufte. C’eftjjbfolument -le contr ire de Thiftoire de
vjrinlläiime J ell & du tyran Grisler, & Sénèque a eu
raifon de dire que ce trait a été encore plus /cèlêrate-
ment loué que lancé, fceleràtiùs telum illud laudatum
efl quant mijf /m.
Ce malheureux Préxafpe n’étoit pas cependant
fans quelque énergie, On avoit mis fur le trône
un faux Smerdis qiïi étoit un des mages, & dont
les mages favorifeient l’ufurpation ; Cambyfe ,
qui s étoit affuré de la mort du vrai Smerdis fon
frç re , étoit mort, & il n’y avoit plus d’autre
témoin de la mort de Smerdis que Préxafpe. Les
mages lui propofèrent, pour détourner ou diffiper
tous les foupçons, de déclarer devant le peuple
affembl-é que , chargé par Cambyfe de tuer S mer«
a is, il lui a fauve la vie , & que le prince qui
occupoit alors le trône étoit véritablement Smerdis
, fils de Cyrus. On affemble le peuple, Préxafpe
parle du haut d’une tour, & révélant la vérité ,
déclaré qu il a tue de fa main lé véritable Smerdis,
en demaade pa-rdon aux dieux & aux hommes,
fait connoître l’ufurpateur pour être Smerdis le
mage , & fe précipitant du haut de la tour la
rf re b2S> fo punit de fe s crimes & de fes
lâchetés.
P R E Y S IU S , ( C h r i s t o p h e ) Hiß. litt, mod.)
favant proteftant hongrois du feizième fiècle,
auteur d une vie de Cicéron & d’un traité de imitât
io ne ciceroniana, dont Mélanchton 8c JPeucer
faifoient cas, ainfi que de l’auteur.
PRIDE AUX ( Hum ph r e y ) Hiß. lut. mod. )
doyen de Norwich , favant Anglois, fi connu
par fon Hißoire des Ju ifs , qui eut en Angleterre
huit éditions en quatre ans, & qui a été traduite
en françois. On a encore de Prideaux une vie
de Mahomet , & l’ouvrage fuivant commencé par
Seiden , mais dont la partie la plus considérable
çft de Prideaux ; Marmara Oxoniénfia ex Arundc
FR ï
liants, Seldenianis, aliisque carßata, cum Gracorum
ve’fisne latinâ & lacunis fuppleùs ac figuris æneis,
ex recenfionc & cum commentants Humphrcydi Prideaux
, nec non Joannis Sêldeni & Thomce Lydiati.
annotationibus ,* accejjit Sertorii Urfati de- notis Ro-,
manorum comméntarius , in-jol, Oxford , 1676. Prideaux
étoit né dans le comté de Cornouailles
eu 16 48, avoir eu le doyenné de Norwich en
17 0 4 , y mourut en 1724.
PRIEUR DE SORBONNE , { Hiß. mod, ) c’eft
un bachelier en licence que la maifon^& fociété
de Sorbonne choifit tous les ans parmi ceux de
fon corps pour y préfider pendant ce tems. Tous
les foirs on lui porte les clés de la maifon ; il
préfide aux affemblées tant des bacheliers que des
do&eurs qui y font leur réfidence. Il ouvre le
cours des thèfes appellées forboniques , par un
difeours latin qu’il prononce dans la grande falle
de Sorbonne en préfençe d’une affemblée, où
les, prélats qui fe trouvent alors à Paris affiftenr.
Il ouvre -au fii chaque forboaiquepar un petit difeours
& quelques vers à la louange du bachelier qui
répond ; & dans les repas particuliers de la maifon
de Sorbonne donnés par ceux qui foutiennent des i
thèfes ou prennent le bonnet, il doit auffi pré- i
ferner des vers. Le prieur de Sorbonne prétend le
pas dans les affemblées, procédions, &c. fur toute
la licence ; mais le plus .ancien , ou le doyen des
bacheliers le lui difpute. : Cette conteftation qui
a produit de tems en tems divers •mémoires, &
qui a été portée au parlement, n’eft pas encore
décidée. La place de prieur de Sorbonne eft honorable,
difpendieufe, & demande des talens dans
ceux qui la rempliffent. ( A . R . )
PRIEUR , ( G r a n d ) , ( Hifl. mod. ) chevalier de
Malthe, diftingué par une dignité de l’otdre qu’on
nomme grand*prieuré. Dans chaque langue il y
a plufieurs grands-prieurés ; par exemple, dans celle
de France on en compte trois; favoir, le grand-
prieur. de France , celui d’Aquitaine & celui de
Champagne. Dans la langue de Provence on compte
ceux de S. Gilles v$c d e . Toulon f e , & dans
celle d’Auvergne le grand prieuré d’Auvergne.
Il y a également plufieurs grands-prieurs dans les
langues d’Italie , d’Efpagne & d’Allemagne, &c.
Les grands-prieurs, en vertu d’un droit attaché,
à leur dignité, confèrent tous les cinq ans une
commanderie qu’on appelle comrnanderie de grâce ;
il n’importe fi elle eft du nombre de celles qui
font affe&ées aux chevaliers, ou de celles qui appartiennent
aux fervans d’armes , il peut en gratifier
qui il lui plaît. Il préfide auffi aux affemblées
provinciales de fon grand-prieuré. La première
origine de ces grands-prieurs paroît être la même
que celle des prieurs chez les. moines. Les chevaliers
de S. Jean de Jérufalem étoient religieux,
menoient la vie commune comme ils la mènent
encore à Malte ceux qui étoient ainfi réunis en
P R I 399
certain nombre avoient un chef qu’on a nommé
grand-prieur , du latin prior, le premier,' parce
qu’en effet il eft le premier de ces fortes de di-
vifions , quoiqu’ l ne foit pas le chef de loute
la langue ; on nomme celui-ci pilier. ( A . R . )
P R IEU R , P R I O R ! U S > ( P h i l i p p e l e ) H iß .fu t ,
mod. ) profeffeur habile dans l’univerfité de Paris,
auteur de notes fur Tertulîien & fur faint C y -
prien, d’une édition d’Oprat de Mi lè v e , d’un
traité des formules des lettres eccléfiaftiques.,
d’une réfutation dti livre des Prèadamites de la
Peyrère. Mort en 1680.
PR IE ZA G , ( D a n i e l d e ) Hiß. lin. med.) ]u-~-
rifconfiilte de Bordeaux , puis confeiller d’état y
fut de L’académie françaife du temps des protecteurs
panicuiiers en 1639. Il répondit au Mars
galliciLS du fameux Janiénius, ( efpéce de fatyre
contre le cardinal de, Richelieu, faite à l’occafioiî
de l’alliance que la France venoit de conclure
centre l’Efpagné & la maifon d’Autriche avec les
puiffances proteftantes ) par l’ouvrage intitulé r
vindicicegailïctz, que Baudoin traduifir en françoisv
On a de lui encore quelques autres opufcules
en latin, en françois, en profe , en v e r s , le
tout aujourd’hui oublié. Mort en 1662.
Ou a de Salomon de Priéçac, fon fils , une
Dijfertation fur le N il & une Hißoire des éléphants•«
PRIMAT DE POLOGNE, ( Hiß. du gouv. de
Pol. ) Le primat de Pologne eft le chef du fénar,.
& c’eft à l’archevêque de Gnefne qu’appartient
cet honneur.
Cette dignité de primat fut autrefois accompagnée
du pouvoir & de fes abus dans toute l’europe*
Ce fut un primat de Suède , l’archevêque d'Upfal ,.
qui fit maffacrer dans un repas tout le Sénat de-
Stockholm, fous prétexte qu’il étoit excommunié’
par le pape ; ôc la Suède ne voulut plus ni dfe
primat, ni de pape. Ce fut un primat d’Angleterre,
l’archevêque Crammer , qui en caftant le mariage
de Henri .VIII avec Catherine d’Arragon, rompit,
de concert avec fon maître, tous les liens
entre Rome & les Anglois. Le czar Pierre ne
trouva point de plus grands obftacles aux grandes
chofes qu’il m é d ito itq u e la dignité de patriarche
ou de primat. Elle s’abolit en France : comme
elle s’eft divifée sur plufieurs têtes qui fe
la difputent, elle ne peut pas tont ce qu’elle
pouvoit. En Pologne elle éxifte dans toute fa
force.
Le primat eft légat né du faint fege , & cen-
feur des rois ; roi lui-même en quelque forte dans
les interrègnes, pendant lefquels il prend le nom
d'inter-roi. Auffi les honneurs qu’il reçoit répondent
ils à- l’éminence de fa place. Lorfquhl .va
chez le ro i, il y eii conduit en cérémonie; 8c le
roi s’avance pour le recevoir. Il a , comme le roi
un maréchal, un chancelier, une nombreufe gar--