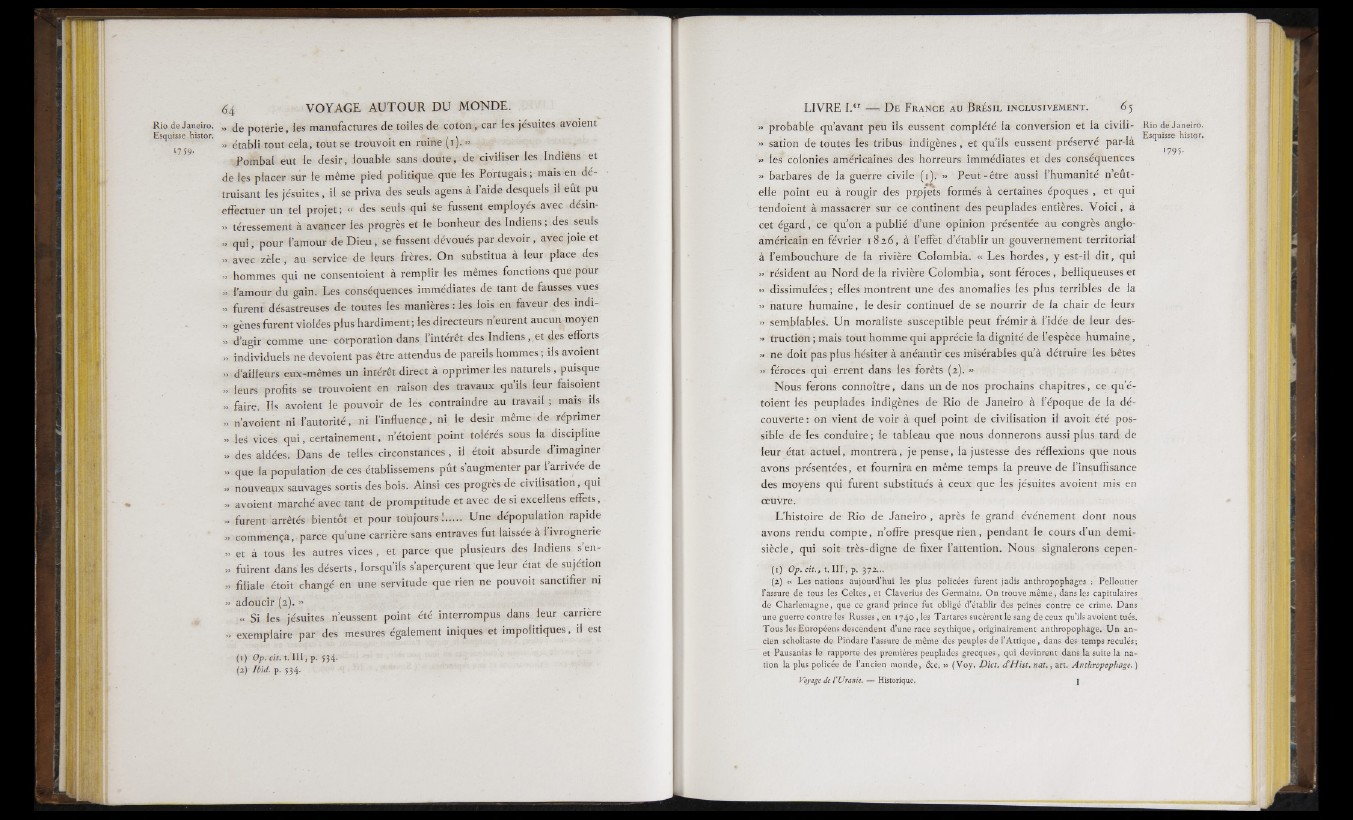
MbÊjS
» de poterie, les manufactures de toiles de coton, car les jésuites avoient
» établi tout cela, tout se trouvoit en ruine (i). »
Pombal eut le désir, louable sans doute, de civiliser les Indiens et
de les placer sur le même pied politique que les Portugais ; mais en détruisant
les jésuites , il se priva des seuls agens à 1 aide desquels il eut pu
effectuer un tel projet; « des seuls qui Se fussent employés avec désin-
» téressement à avancer les progrès et le bonheur des Indiens ; des seuls
» qui, pour l’amour de Dieu, se frissent dévoués par devoir, avec joie et
» avec zèle, au service de leurs frères. On substitua à leur place des
» hommes qui ne consentaient à remplir les mêmes fonctions que pour
» l’amour du gain. Les conséquences immédiates de tant de fausses vues
» furent désastreuses de toutes les manières : les lois en faveur des mdi-
» gènes furent violées plus hardiment; les directeurs n’eurent aucun moyen
» d’agir comme une corporation dans l’intérêt des Indiens ,. et des efforts
» individuels ne devoient pas être attendus de pareils hommes ; ils avoient
» d’ailleurs eux-mêmes un intérêt direct à opprimer les naturels , puisque
» leurs profits se trouvoient en raison des travaux quils leur faisoient
» faire. Ils avoient le pouvoir de les contraindre au travail ; mais ils
» n’avoient ni l’autorité, ni l’influenc.e, ni le désir même de réprimer
» les vices qui, certainement, n’étoient point tolérés sous la discipline
» des aidées. Dans de telles circonstances, il était absurde d imaginer
» que la population de ces étabiissemens pût s’augmenter par l’arrivée de
» nouveaux sauvages sortis des bois'. Ainsi ces progrès de civilisation, qui
» avoient marché avec tant de promptitude et avec de si exceilens effets,
» furent arrêtés bientôt et pour toujours !..... Une dépopulation rapide
» commença, parce qu’une carrière sans entraves fut laissée à 1 ivrognerie
» et à tous les autres vices, et parce que plusieurs des Indiens s’en-
» fuirent dans les déserts, lorsqu’ils s’aperçurent que leur état de sujétion
» filiale était changé en une servitude que rien ne pouvoit sanctifier ni
» adoucir (2). »
« Si les jésuites n’eussent point été interrompus dans leur carrière
» exemplaire par des mesures également iniques et impolitiques, il est
(1) Op. cit. t. I I I , p. 534.
(2) Ibid. p. 534.
» probable qu’avant peu ils eussent complété la conversion et la civili- Rio de Janeiro.
. r • 1. >-i i í I ' Esquisse histor. » sation de toutes les tribus indigènes, et qu ils eussent préservé par-la
» les colonies américaines des horreurs immédiates et des conséquences
» barbares de la guerre civile (1). » Peut-être aussi l’humanité n’eutelle
point eu à rougir des prpjets formés à certaines époques , et qui
tendoient à massacrer sur ce continent des peuplades entières. V oic i, à
cet égard, ce qu’on a publié d’une opinion présentée au congrès angloaméricain
en février 1826, à l’effet d’établir un gouvernement territorial
à l’embouchure de la rivière Colombia. « Les hordes, y est-il dit, qui
»-résident au Nord delà rivière Colombia, sont féroces, belliqueuses et
»> dissimulées; elles montrent une des anomalies les plus terribles de la
» nature humaine, le désir continuel de se nourrir de la chair de leurs
» semblables. Un moraliste susceptible peut frémir à l’idée de leur des-
»» traction ; mais tout homme qui apprécie la dignité de l’espèce humaine,
»» ne doit pas plus hésiter à anéantir ces misérables qu’à détruire les bêtes
»> féroces qui errent dans les forêts (2). >»
Nous ferons connoître, dans un de nos prochains chapitres, ce qu’étaient
les peuplades indigènes de Rio de Janeiro à l’époque de la découverte
: on vient de voir à quel point de civilisation il avoit été possible
de les conduire ; le tableau que nous donnerons aussi plus tard de
leur état actuel, montrera, je pense, la justesse des réflexions que nous
avons présentées, et fournira en même temps la preuve de l’insuffisance
des moyens qui furent substitués à ceux que les jésuites avoient mis en
oeùvre.
L ’histoire de Rio de Janeiro , après le grand événement dont nous
avons rendu compte, n’offre presque rien, pendant le cours d’un demi-
siècle, qui soit très-digne de fixer l’attention. Nous signalerons cepen-
(1) Op. cit., t. I I I , p. 372...
(2) « Les nations aujourd’hui les plus policées furent jadis anthropophages : Pelloutier
l’assure de tous les Celtes, et Claverius des Germains. On trouve même, dans les capitulaires
de Charlemagne, que ce grand prince fut obligé d’établir des peines contre ce crime. Dans
une guerre contre les Russes, en 1740, les Tartares sucèrent le sang de ceux qu’ils avoient tués.
Tous les Européens descendent d’une race scythique, originairement anthropophage. Un ancien
scholiaste de Piñdare l’assure de même des peuples de l’Attique, dans des temps reculés;
et Pausanias le rapporte des premières peuplades grecques , qui devinrent dans la suite la nation
la plus policée de l’ancien monde, &c. » (Voy. Dict, cfHist. nat., art. Anthropophage. )
Voyage de l’Uranie. — Historique. j