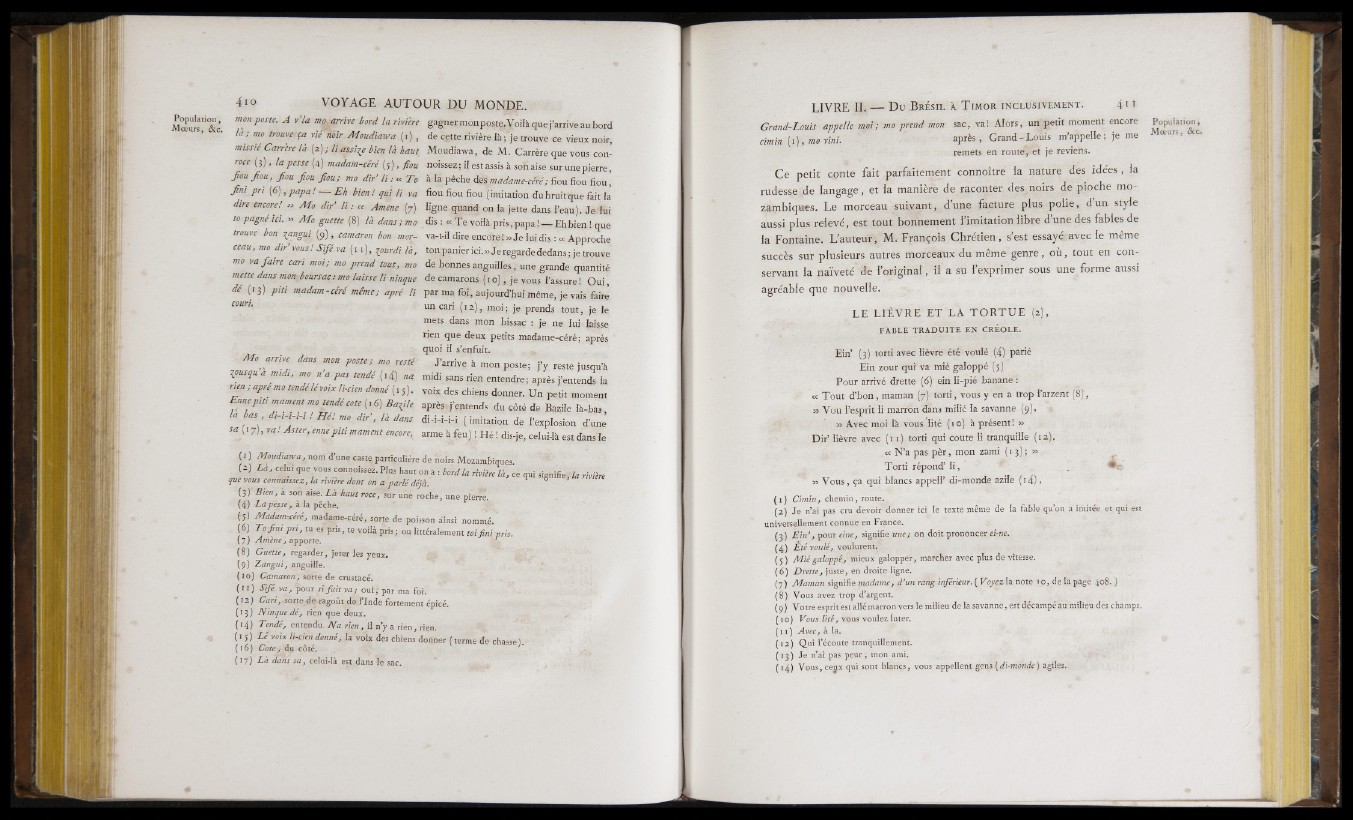
Moeuir'&c m°nP0Ste‘ A vla m£*rrt*t tord la rivière gagnermonposts. Voilà que j’arrive au bord
oeUrS’ C’ la; mo trouve (a v‘é'noir Moudiawa (i) , de cette rivière là ;'je trouve ce vieux noir,
mûsié Carrère là (2); li assise bien là haut Moudiawa, de M. Carrère que vous con-
roee (3 ), la pesse (4) madam-céré (5 ), fiou noissez ; il est assis à son aise sur une pierre,
fou fo u , fou fou fo u ; mo dir’ li : « To à la pêche des madame-cèré ; fiou fiou fiou,
fo i pn (6) , papa! — Eh bien ! qui li va fiou fiou fiou (imitation du bruit que fait la
dire encore! » Mo dir' li : c< Amene (7) ligne quand on la jette dans l’eau). Je lui
to pagne ici. » Mo guette (8) là dans ; mo dis : « Te voHà pris, papa ! — Eh bien ! que
trouve bon langui (9), camaron bon mor- va-t-il dire encore! » J e lui dis : « Approche
ceau, mo dir’ vous! Sifé va ( 1 1 ) , yurdi là, ton panier ici. « J e regarde dedans; je trouve
mo va faire cari moi; mo prend tout, mo de bonnes anguilles, une grande quantité
mette dans mon boursac: mo laisse li ninque de camarons (10 ) , je vous l’assure ! Oui,
dé (13) pki madam-céré même; apré li par ma foi, aujourd’hui même, je vais faire
un cari ( 12 ) , moi; je prends tout, je le
mets dans mon bissac : je ne lui laisse
rien que deux petits madame-céré; après
quoi il s’enfuit.
Mo arrive dans mon poste; mo resté J ’arrive à mon poste; j’y reste jusqu’à
lousqu a mi I, mo n a pas tende (i4) na midi sans rien entendre; après j’entends la
nen ; apre mo tendé lé voix li-cien donné (^). voix des chiens donner. Un petit moment
Ennepiti marnent mo tendé cote ( 1 6) Basile après j ’entends du côté de Bazile là-bas
la bas , di-i-i-1-1 ! Hé! mo dir , là dans di-i-i-i-i ( imitation de l’explosion d’une
Sü. {' 7>’ Va‘ Aster' ennePki mament enco"> arme à feu) ! Hé ! dis-je, celui-là est dans le
(1 ) Moudiawa, nom d’une caste particulière de noirs Mozambiques
(2) L à , celui que vous connoissez. Plus haut on a : bord la rivière Va, ce qui signifie, la rivière
que vous connaissez, la rrnere dont on a parlé défi.
(3) Bien, à son aise. L à haut roce, sur une roche, une pierre;
(4) -Lapesse , à la pêche.
(5) Madam-céré, madame-céré, sorte de poisson ainsi nomn^é.
(6) Ta f o i p r i, tu es pris, te voilà pris; ou littéralement toi foi-pris.
(7) Amène , apporte.
(8) Guette, regarder, jeter les yeux.
(9) Zangui, anguille.
(10) Camaron, sorte de crustacé.
( 1 1 ) Sifé va, pour si fa it va ; oui; par ma foi.
( 12 J Cari, -s6rte.de ragoût de l’Inde fortement épicé.
(13) Ninque d é , rien que deux.
(14) Tendé, entendu. N a rien, il n’y a rien, rien.
(15) L é voix li-cien donné, la voix des chiens donner (terme de chasse).
(16) Cote, du côté.
(17) La dans sa, celui-là est dans le sac.
Grand-Louis appelle moi; mo prend mon sac, va! Alors, un petit moment encore
cimin ( 1 ) , mo vini. $ après , G r a n d - Louis m’appelle ; je me
remets en route, et je reviens.
Ce petit conte fait parfaitement connoître la nature des idées, la
rudesse de langage, et la manière de raconter des noirs de pioche mo-
zambiques. Le morceau suivant, d’une facture plus polie, d’un style
aussi plus relevé, est tout bonnement l’imitation libre d’une des fables de
la Fontaine. L’auteur, M. François Chrétien, s’est essayé avec le même
succès sur plusieurs autres morceaux du même genre, où, tout en conservant
la naïveté de l’original, il a su l’exprimer sous une forme aussi
agréable que nouvelle.
L E L I È V R E E T L A T O R T U E (2),
FABLE TRADUITE EN CRÉOLE.
Ein’ (3) torti avec lièvre été voulé (4) parié
Ein zour qui va mié galoppé (j)
Pour arrivé drette (6) ein E-pié banane :
« Tout d’bon, maman (7) torti, vous y en a trop l’arzent (8),
» Vou l’esprit li marron dans milié la savanne (9).
» Avec moi là vous Îité (10) à présent! »
Dir’ lièvre avec ( 1 1 ) torti qui coûte li tranquille (12).
_ cc N’a pas p èr, mon zami ( 13 ) ; »
Torti répond’ li, W_
» Vous, ça qui blancs appel!’ di-monde azile ( 1 4)
( 1 ) Cimin, chemin, route,
(2) Je n’ai pas cru devoir donner ici le texte même de la fable qu’on a imitée, et qui est
universellement connue en France.
(3) E in ', pour eine, sigqifie une; on doit prononcer ei-ne.
(4) Eté voulé, voulurent.
(5) M ié galoppé, mieux galopper, marcher avec plus de vitesse.
(6) Drette, juste, en droite ligne. .
(y) Maman signifie madame, d’un rang inférieur. ( Voyez la note 10, de la page 408. )
(8) Vous avez trop d’argent.
(9 ) Votre esprit est allé marron vers le milieu de la savanne, est décampé au milieu des champs.
( 10) Vous lité, vous voulez Iuter.
( 11 ) Avec, à la.
(12) Qui l’écoute tranquillement.
(13) Je n’ai pas peur, mon ami.
( 14) Vous, ceux qui sont blancs, vous appellent gens ( di-monde) agiles.