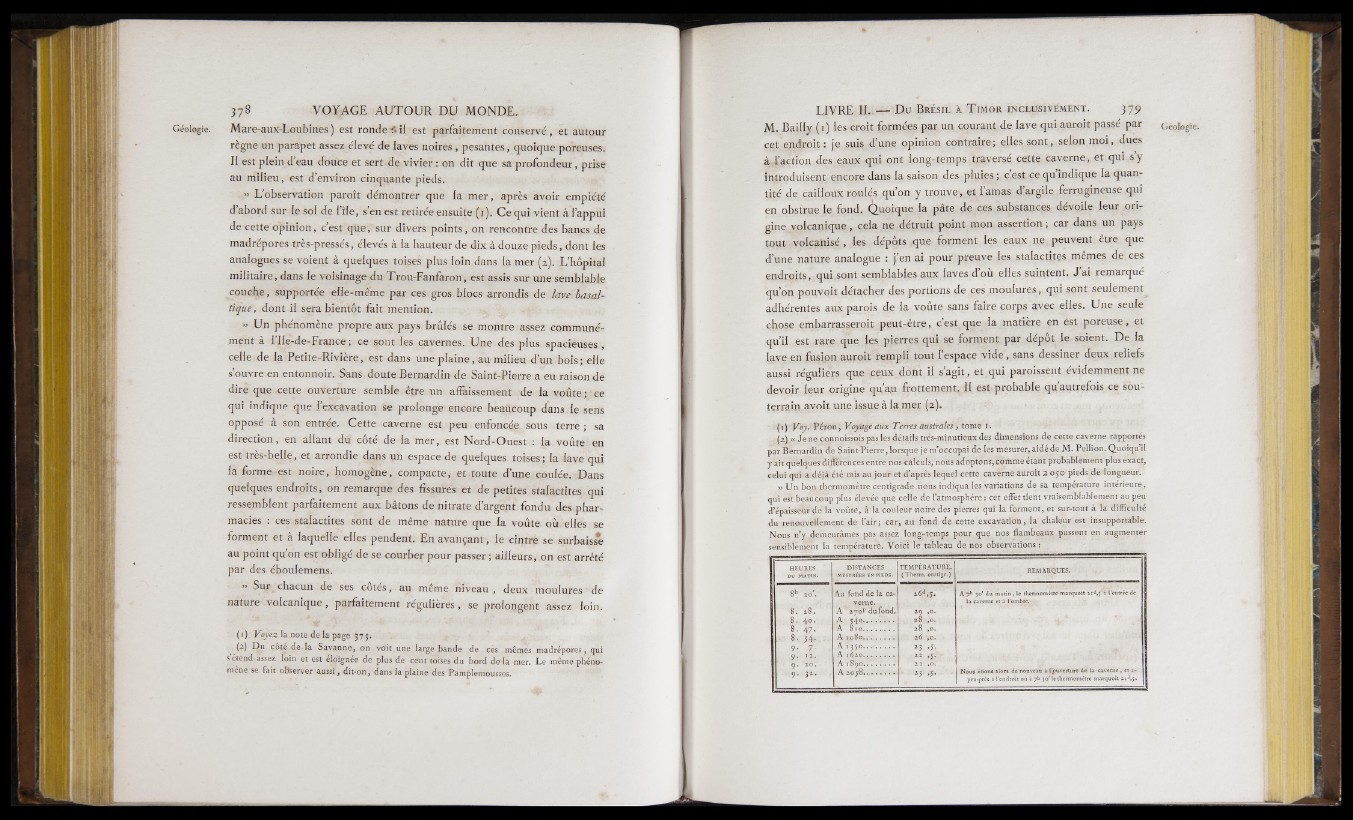
■logie. Mare-aux-Loubines) est rondep il est parfaitement conservé, et autour
règne un parapet assez élevé de laves noires, pesantes, quoique poreuses.
Il est plein d’eau douce et sert de vivier : on dit que sa profondeur, prise
au milieu, est d’environ cinquante pieds.
« L’observation paroît démontrer que la mer , après avoir empiété
d abord sur le sol de l’île, s’en est retirée ensuite (i). Ce qui vient à l’appui
de cette opinion, c’est que, sur divers points, on rencontre des bancs de
madrépores très-pressés, élevés à la hauteur de dix à douze pieds, dont les
analogues se voient à quelques toises plus loin dans la mer (2). L’hôpital
militaire, dans le voisinage-du Trou-Fanfaron, est assis sur une semblable
couche, supportée elle-même par ces gros blocs arrondis de lave basaltique,
dont il sera bientôt fait mention.
» Un phénomène propre aux pays brûlés se montre assez communément
a 1 Ile-de-France ; ce sont les cavernes. Une des plus spacieuses ,
celle de la Petite-Rivière, est dans une plaine, au milieu d’un bois ; elle
s’ouvre en entonnoir. Sans doute Bernardin de Saint-Pierre a eu raison de
dire que cette ouverture semble être un affaissement de la voûte; ce
qui indique que l’excavation se prolonge encore beaucoup dans le sens
opposé à son entrée. Cette caverne est peu enfoncée sous terre ; sa
direction, en allant du côté de la mer, est Nord-Ouest .: la voûte en
est très-belle, et arrondie dans un espace de quelques toises; la lave qui
la forme est noire, homogène, compacte, et toute d’une coulée. Dans
quelques endroits, on remarque des fissures et de petites stalactites qui
ressemblent parfaitement aux bâtons de nitrate d’argent fondu des pharmacies
: ces stalactites sont de même nature que la voûte où elles se
forment et à laquelle elles pendent. En avançant, le cintre se surbaisse
au point qu’on est obligé de se courber pour passer ; ailleurs, on est arrêté
par des éboulemens.
» Sur chacun de ses côtés, au même niveau, deux moulures ' de
nature volcanique, parfaitement regulieres, se prolongent assez loin.
( i ) Voyez la note de la page 375.
'éj L u cdté de la Savanne, on voit une large bande de ces mêmes madrépores, qui
s étend- assez loin et est éloignée de plus de cent toises du bord de la mer. Le même phénomène
se fait oBserver aussi, dit-on, dans la plaine des Pamplemousses.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 3 751
M. Bailly (1) les croit formées par un courant de lave qui auroit passé par
cet endroit : je suis d’une opinion contraire ; elles sont, selon moi, dues
à l’action des eaux qui ont long-temps traversé cette caverne, et qui s’y
introduisent encore dans la saison des pluies ; c’est ce qu’indique la quantité
de cailloux roulés qu’on y trouve, et I amas d argile ferrugineuse qui
en obstrue le fond. Quoique la pâte de ces substances dévoile leur origine
volcanique, cela ne détruit point mon assertion ; car dans un pays
tout volcanisé, les dépôts que forment les eaux ne peuvent être que
d’une nature analogue : j’en ai pour preuve les stalactites memes de ces
endroits, qui sont semblables aux laves d’où elles suintent. J ’ai remarqué
qu’on pouvoit détacher des portions de ces moulures, qui sont seulement
adhérentes aux parois de la voûte sans faire corps avec elles. Une seule
chose embarrasseroit peut-être, c est que la matière en èst poreuse, et
qu’il est rare que les pierres qui se forment par dépôt le soient. De la
lave en fusion auroit rempli tout l’espace vide, sans dessiner deux reliefs
aussi réguliers que ceux dont il s’agit, et qui paroissent évidemment ne
devoir leur origine qu’au frottement. Il est probable qu’autrefois ce souterrain
avoit une issue à la mer (2).
(1) Voy> Péron, Voyage aux Terres australes, tome i.
(2.) « Je ne çonnoissois pas les détails très-minutieux des dimensions de cette caverne rapportés
par Bernardin de Saint-Pierre, lorsque je m’occupai de les mésurer, aidé de M. Pellion. Quoiqu il
y ait quelques différences entre nos calculs, nous adoptons, comme étant probablémeftt plus exact,
celui qui a déjà été mis au joui\et d’après lequel cette caverne auroit 2 050 pieds de longueur.
33 Un bon thermomètre centigrade nous indiqua les variations de sa température intérieure,
qui est beaucoup plus élevée que celle de l’atmosphère : cet effet tient vraisemblablement au peu
d’épaisseur de la voûte, à la couleur noire des pierres qui la forment, et sur-tout à la difficulté
du renouvellement de l’air; car, au fond de cette excavation, ia chaleur est insupportable.
Nous n’y demeurâmes pas assez long-temps pour que nos flambeaux pussent en augmenter
sensiblement la température. Voici le tableau de nos observations:
HEUJRES *
DU MATIN.
DISTANCES
MESURÉES EN PIEDS.
TEMPÉRATURE.
( Thcrm. ccntigr. ) REMARQUES.
8 l* 20V A u fon d d e la cav
e rn e .
2 6 ^ ,5 . A 30' du matin, le thermomètre marquoit l'entrée de
la caverne et à l’ombre.
8 . 2 8 . A 2 7 0E du fond. 20 ,0.
8 . 4 ° . A 5 4 0 ------ 2 8 ,0.
8 . 4 7 . A 8 1 0 . . . . . . . ' . . 2 8 ,0 .
8 . 5 4 - A 1.0 80................... 2 6 jO.
9 . 7 . A 1 3 5 0 . . . . . . . . 2 3 >ïr
9 . 1 2 . A 1 ¿ 2 0 . . . . . . . . . M a . 22
9. 2 0 . A 1 8 9 0 . . ' . . . . . . 2 2 , 0 .
• >s- Nous étions alors de nouveau à l’ouverture de la caverne , et àpeu
près à l’endroit où à 7b 30* le thermomètre marquoit a i d, j .