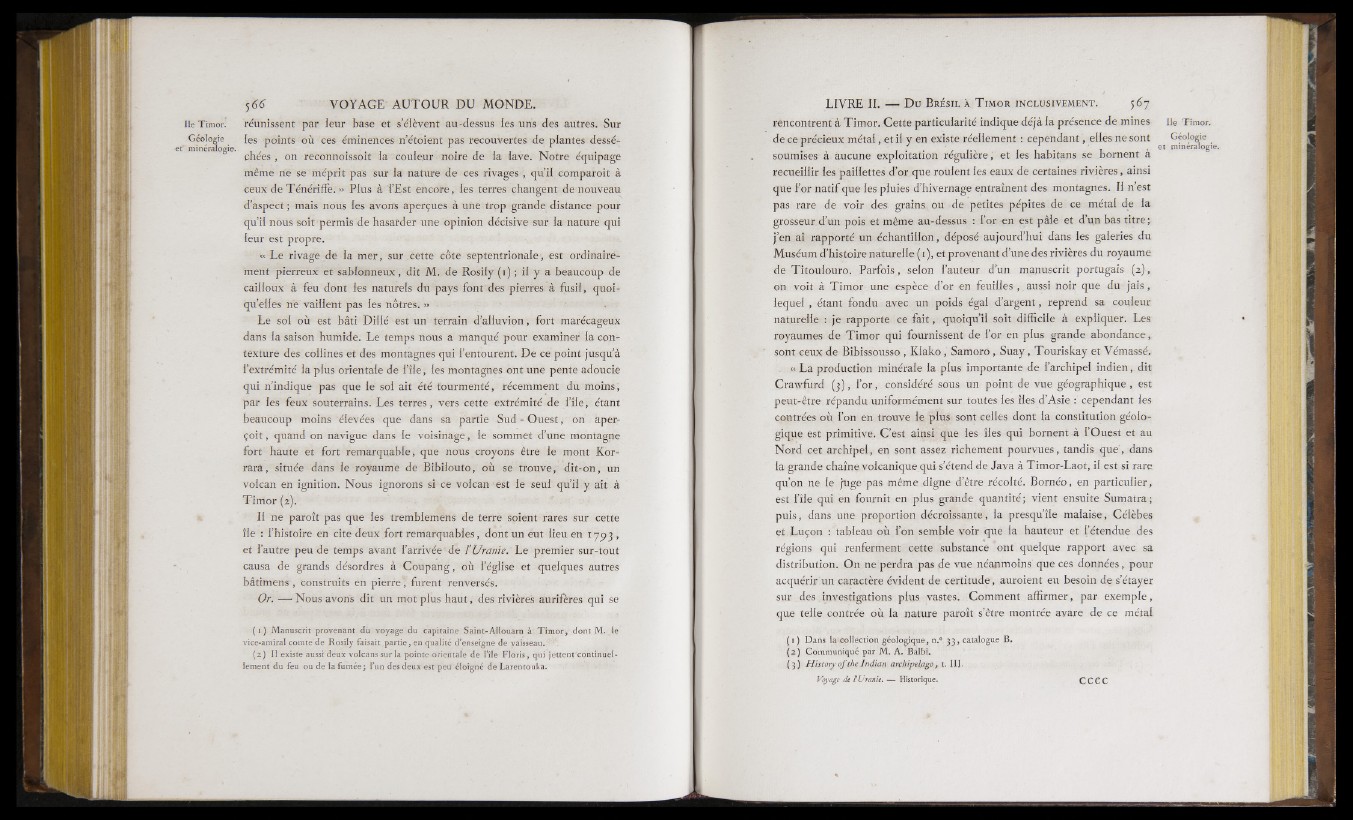
Géologie
et minéralogie.
réunissent par leur buse et s’élèvent au-dessus les uns des autres. Sur
les points où ces éminences n’étoient pas recouvertes de piantes desséchées
, on reconnoissoit la couleur noire de la lave. Notre équipage
même né se méprit pas sur la nature de ces rivages , qu’il comparoit à
ceux de Ténériffe. » Plus à l’Est encore, les terres changent de nouveau
d’aspect ; mais nous les avons aperçues à une trop grande distance pour
qu’il nous soit permis de hasarder une opinion décisive sur la nature qui
leur est propre.
« Le rivage de la mer, sur cette côte septentrionale, est ordinairement
pierreux et sablonneux, dit M. de Rosiiy ( i ) ; il y a beaucoup de
cailloux à feu dont les naturels du pays font des pierres à fusil, quoiqu’elles
ne vaillent pas les nôtres. » . - ; .
Le sol où est bâti Dillé est un terrain d’alluvion, fort marécageux
dans la saison humide. Le temps nous a manqué pour examiner la con-
texture des collines et des montagnes qui l’entourent. De ce point jusqu’à
l’extrémité la plus orientale de l’île, les montagnes ont une pente adoucie
qui n’indique pas que le sol ait été tourmenté, récemment du moins,
par les feux souterrains. Les terres, vers cette extrémité de l’île, étant
beaucoup moins élevées que dans sa partie Sud-Ouest, on aperçoit
, quand on navigue dans le voisinage, le sommet d’une montagne
fort haute et fort remarquable, que nous croyons être le mont Kor-
rarâ, située dans le royaume de Bibilouto, où se trouve, dit-on, un
volcan en ignition. Nous ignorons si ce volcan est le seul qu’il y ait à
Timor (2).
Il ne paroît pas que les tremblemens de terre soient rares sur cette
île : l’histoire en cite deux fort remarquables, dont un eut lieu en 1 7^3 ,
et l’autre peu de temps avant l’arrivée de l’Uranie, Le premier sur-tout
causa de grands désordres à Coupang, où l’église et quelques autres
bâtimens , construits en pierre , furent renversés.
Or. — Nous avons dit un mot plus haut, des rivières aurifères qui se
( 1 ) Manuscrit provenant du voyage du capitaine Saint-AIIouarn à Timor-, dont M. le
vice-amiral comte de Rosiiy faisait partie, en qualité d’enseigne de vaisseau.
(2.) II existe aussi deux volcans sur la pointe orientale de l’île Floris, qui jettent'continuel-
lement du feu ou de la fumée; fun des deux est peu éloigné de Larentouka.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 567
rencontrent à Timor. Cette particularité indique déjà la présence de mines
de ce précieux métal, et il y en existe réellement : cependant, elles ne sont
soumises à aucune exploitation régulière, et les habitans se bornent à
recueillir les paillettes d’or que roulent les eaux de certaines rivières, ainsi
que l’or natif que les pluies d’hivernage entraînent des montagnes. Il n’est
pas rare de voir des. grains ou de petites pépites de ce métal de la
grosseur d’un pois et même au-dessus : l’or un est pâle et d’un bas titre ;
j’en ai rapporté un échantillon, déposé aujourd’hui dans les galeries du
Muséum d’histoire naturelle (1), et provenant d’une des rivières du royaume
de Titoulouro. Parfois, selon l’auteur d’un manuscrit portugais (2) ,
on voit à Timor une espèce d’or en feuilles , aussi noir que du jais ,
lequel , étant fondu avec un poids égal d’argent, reprend sa couleur
naturelle : je rapporte ce fait, quoiqu’il soit difficile à expliquer. Les
royaumes de Timor qui fournissent de l’or en plus grande abondance,
sont ceux de Bibissousso , Kiako , Samoro , Suay, Touriskay et Vémassé.
« La production minérale la plus importante de l’archipel indien, dit
Crawfurd (?), l’or, considéré sous un point de vue géographique, est
peut-être répandu uniformément sur toutes les îles d’Asie : cependant les
contrées où l’on en trouve le plus sont celles dont la constitution géologique
est primitive. C’est ainsi que les îles qui bornent à l’Ouest et au
Nord cet archipel, en sont assez richement pourvues, tandis que, dans
la grande chaîne volcanique qui s’étend de Jaya à Timor-Laot, il est si rare
qu’on ne le juge pas même digne d’être récolté. Bornéo, en particulier,
est l’île qui en fournit en plus grande quantité ; vient ensuite Sumatra ;
puis, dans une proportion décroissante, la presqu’île malaise, Célèbes
et Luçon : tableau où l’on semble voir que la hauteur et l’étendue des
régions qui renferment cette substance ont quelque rapport avec sa
distribution. On ne perdra pas de vue néanmoins que ces données, pour
acquérir un caractère évident de certitude, auroient eu besoin de s’étayer
sur des investigations plus vastes. Comment affirmer, par exemple,
que telle contrée où la nature paroît s’être montrée avare de ce métal
( 1 ) Dans Ia!collection géologique, n.° 3 3 , catalogue B.
(2 ) Communiqué par M. A. Balbi.
{ 3 ) fjistory o f tlie In^'ian arçhipelago, t. IIJ.
Voyage de l Uranie. — Historique. CCC C
Géologie
et minéralogie.