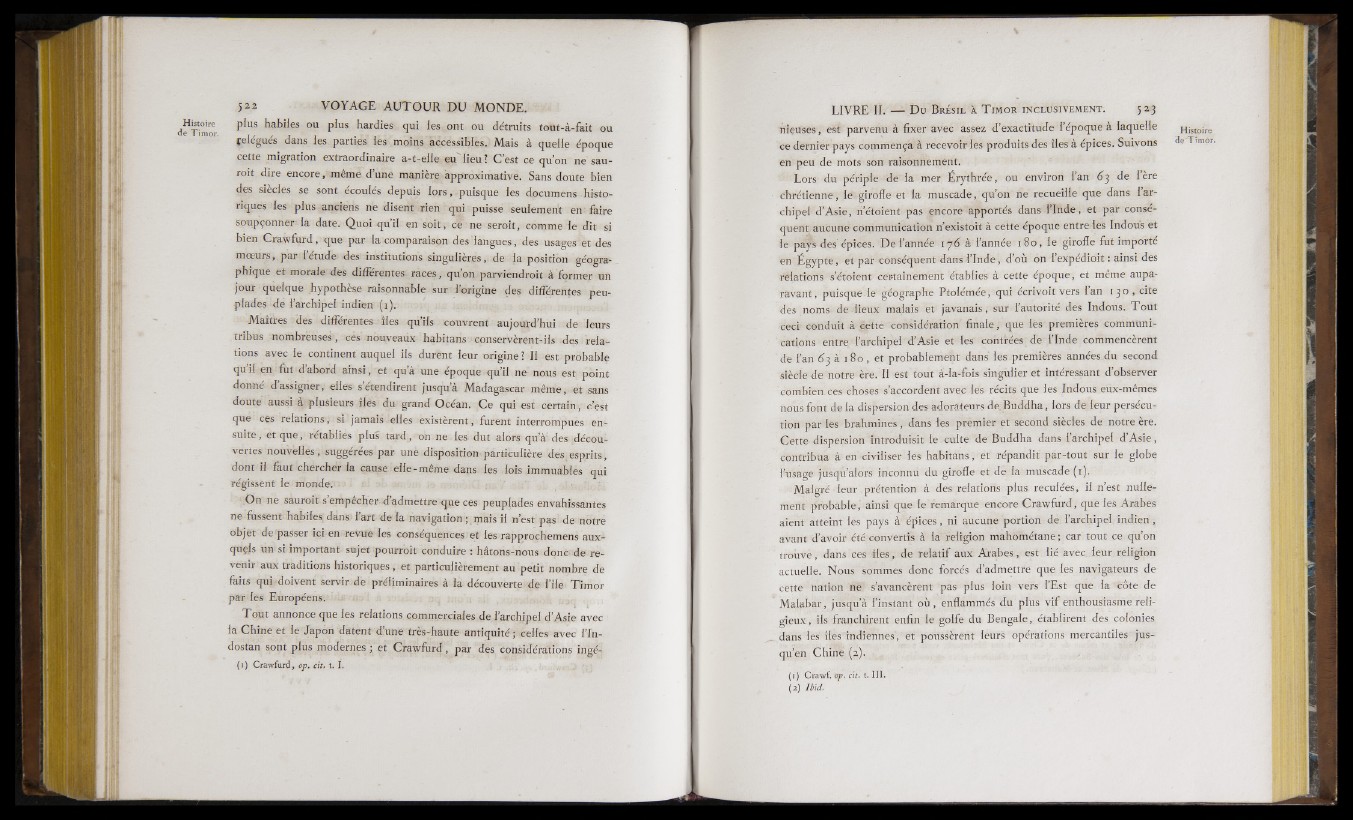
plus habiles ou plus hardies qui les ont ou détruits tout-à-fait ou
(elegues dans les parties les moins accessibles. Mais à quelle époque
cette migration extraordinaire a-t-elle eu lieu! C’est ce qu’on ne sau-
roit dire encore, même d’une manière approximative. Sans doute bien
des siècles se sont écoules depuis lors, puisque les documens historiques
les plus anciens ne disent rien qui puisse seulement en faire
soupçonner la date. Quoi qu’il en soit, ce ne seroit, comme le dit si
bien Crawfurd, que par la comparaison des langues, des usages et des
moeurs,.par Iétude, des institutions singulières, de la position géographique
et morale des différentes races, qu’on parviendroit à former un
jour quelque hypothèse raisonnable sur l’origine des différentes peuplades
de l’archipel indien (1).
Maîtres des différentes îles qu’ils couvrent aujourd’hui de leurs
tribus nombreuses;, ces nouveaux habitans conservèrent-ils des relations
avec le continent auquel ils durent leur origine? II est probable
qu’il en fut d’abord ainsi, et qu’à une époque qu’il ne nous est point
donné d’assigner, elles s’étendirent jusqu’à Madagascar même, et sans
doute aussi à plusieurs îles du grand Océan. Ce qui est certain, c’est
que ces relations; si jamais elles existèrent, furent interrompues ensuite,
et que, rétablies plus tard , on ne les dut alors qu’à'des découvertes
nouvelles, suggérées par une disposition particulière des^sprits,
dont il faut chercher la cause elle-même dans les lois immuables qui
régissent le monde.; ■
On ne sauroit s empecher d admettre que ces peuplades envahissantes
ne fussent habiles dans l’art de la navigation ; mais il n’est pas de notre
objet de passer ici en revue les conséquences et les rapprochemens auxquels
un si important sujet pourroit conduire : hâtons-nous donc de revenir
aux traditions historiques , et particulièrement au petit nombre de
faits qui.doivent servir.de préliminaires à la découverte de l’île Timor
par les Européens. ..........
Tout annonce que les relations commerciales de l’archipel d’Asie avec
la Chine et le Japon datent d’une très-haute antiquité ; celles avec l’In-
dostan sont plus modernes ; et Crawfurd, par des considérations ingé-
(1) Crawfurd, op. cit. t. I.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c lu s i v e m e n t . 5 2 3
nieuses, est parvenu à fixer avec assez d’exactitude l’époque à laquelle
ce dernier pays commença à recevoir les produits des îles a epices. Suivons
en peu de mots son raisonnement.
Lors du périple de la mer Érythrée, ou environ I an 63 de 1 ere
chrétienne, le girofle et la muscade, qu’on ne recueille que dans l’archipel
d’Asie, n’étoient pas encore apportés dans l’Inde, et par conséquent
aucune communication n’existait à cette époque entre les Indous et
le pays des épices. De l’année 17b à l’année 180, le girofle fut importé
en Égypte, et par conséquent dans l’Inde, d’où on l’expédioit : ainsi des
relations s’étoient certainement établies à cette époque, et même auparavant,
puisque le géographe Ptolémée, qui écrivoit vers lan 130 , cite
des noms de lieux malais et javanais, sur l’autorité des Indous. Tout
ceci conduit à cette considération finale, que les premières communications
entre l’archipel d’Asie et les contrées de l’Inde commencèrent
de l’an 63 à 180 , et probablement dans les premières années du second
siècle de notre ère. Il est tout à-la-fois singulier et intéressant d’observer
combien ces choses s’accordent avec les récits que les Indous eux-mêmes
nous font de la dispersion des adorateurs de.Buddha, lors de leur persécution
par les brahmines, dans les premier et second siècles de notre ère.
Cette dispersion introduisit le culte de Buddha dans 1 archipel d Asie,
contribua à en civiliser les habitans, et répandit par-tout sur le globe
l’usage jusqu’alors inconnü du girofle et de la muscade (1).
Malgré leur prétention à des relations plus reculées, il n’est nullement
probable, ainsi que le remarque encore Crawfurd, que les Arabes
aient atteint les pays à épices, ni aucune portion de l’archipel indien,
avant d’avoir été convertis à la religion mahométane; car tout ce qu’on
trouve, dans ces îles, de relatif aux Arabes, est lié avec leur religion
actuelle. Nous sommes donc forcés d’admettre que les navigateurs de
cette nation ne s’avancèrent pas plus loin vers l’Est que la côte de
Malabar, jusqu’à l’instant où , enflammés du plus v if enthousiasme religieux
, ils franchirent enfin le golfe du Bengale, établirent des colonies
dans les îles indiennes , et poussèrent leurs opérations mercantiles jusqu’en
Chine (2).
(1) Crawf. op. cit. t. III.
(2) Ibid.