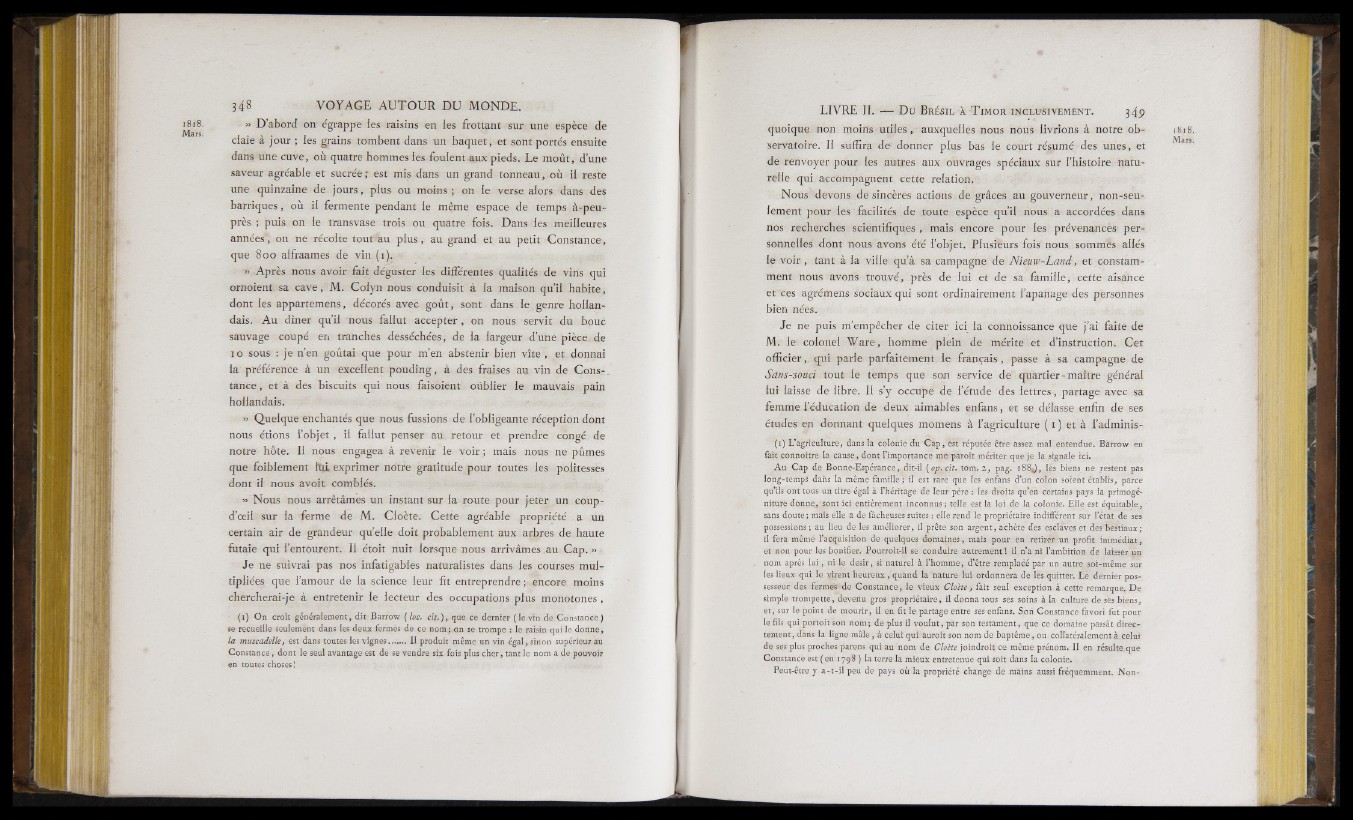
1818.
Mars.
» D’abord on égrappe les raisins en les frottant sur une espèce de
claie à jour ; les grains tombent dans un baquet, et sont portés ensuite
dans une cuve, où quatre hommes les foulent aux pieds. Le moût, d’une
saveur agréable et sucrée; est mis dans un grand tonneau, où il reste
une quinzaine de jours, plus ou moins ; on le verse alors dans des
barriques, où il fermente pendant le même espace de temps à-peu-
près ; puis on le transvase trois ou quatre fois. Dans les meilleures
années, on ne récolte tout au plus, au grand et au petit Constance,
que 8 oo alfraames de vin (i).
» Après nous avoir fait déguster les différentes qualités de vins qui
ornoient sa cave, M. Colyn nous conduisit à la maison qu’il habite,
dont les appartemens, décorés avec goût, sont dans le,genre hollandais.
Au dîner qu’il nous fallut accepter , on nous servit du bouc
sauvage coupé en tranches desséchées, de la largeur d’une pièce de
i o sous : je n’en goûtai que pour m’en abstenir bien vite , et donnai
la préférence à un excellent pouding, à des fraises au vin de Constance
, et à des biscuits qui nous faisoient oublier le mauvais pain
hollandais.
» Quelque enchantés que nous fussions de l’obligeante réception dont
nous étions l’objet , il fallut penser au retour et prendre congé de
notre hôte. II nous engagea à revenir le voir ; mais nous ne pûmes
que foiblement frii exprimer notre gratitude pour toutes les politesses
dont il nous avoit comblés.
» Nous nous arrêtâmes un instant sur la route pour jeter un coup-
d’oeil sur la ferme de M. Cloète. Cette agréable propriété a un
certain air de grandeur qu’elle doit probablement aux arbres de haute
futaie qui l’entourent. Il étoit nuit lorsque nous arrivâmes au Cap. » |
Je ne suivrai pas nos infatigables naturalistes dans les courses multipliées
que l’amour de la science leur lit entreprendre ; encore moins
chercherai-je à entretenir le lecteur des occupations plus monotones ,
(i) On croit généralement, dit Barrow (loc, cit.), que ce dernier (levin de Constance)
se recueille seulement dans les deux fermes de ce nom; on se trompe : le raisin qui le donne,
la muscadelle, est dans toutes les vignes II produit même un vin égal, sinon supérieur au
Constance, dont ie seul avantage est de se vendre six fois plus cher, tant le nom a de pouvoir
en toutes choses !
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 349
quoique non moins utiles, auxquelles nous nous livrions à notre observatoire.
II suffira de donner plus bas le court résumé des unes, et
de renvoyer pour les autres aux ouvrages spéciaux sur l’histoire naturelle
qui accompagnent cette relation.
Nous devons de sincères actions de grâces au gouverneur, non-seulement
pour les facilités de toute espèce qu’il nous a accordées dans
nos recherches scientifiques , mais encore pour les prévenances personnelles
dont nous avons été l’objet. Plusièurs fois nous sommes allés
le voir, tant à la ville qu’à sa campagne de Nieuw-Land, et constamment
nous avons trouvé, près de lui et de sa famille, cette aisance
et ces agrémens sociaux qui sont ordinairement l’apanage des personnes
bien nées.
Je ne puis m’empêcher de citer ici la connoissance que j’ai faite de
M. ie colonel Ware, homme plein de mérite et d’instruction. Cet
officier, qui parle parfaitement le français, passe à sa campagne de
Sans-souci tout le temps que son service de quartier-maître général
lui laisse de libre. Il s’y occupe de l’étude des lettres, partage avec sa
femme l’éducation de deux aimables enfans, et se délasse enfin de ses
études en donnant quelques momens à l’agriculture ( 1 ) et à i’adminis-
(i) L’agriculture, dans la colonie du Cap, èst réputée être assez mal entendue. Barrow en
fait connoître la cause, dont l’importance me paroît mériter que je la signale ici.
Au Cap de Bonne-Espérance, dit-il (op. cit. tom. 2 , pag. 18 8 J , les biens ne restent pas
Iong-temp$ dans la même Famille; il est rare que les enfans d’un colon soient établis, parce
qu’ils ont tous un titre égal à l’héritage de leur père : les droits qu’en certains pays la primogé-
nitùre donne,, sont ici entièrement inconnus-; telle est la loi de la colonie. Elle est équitable,
sans doute; mais elle a de fâcheuses suites : elle rend le propriétaire indifférent sur l’état de ses
possessions ; au lieu de les améliorer, il prête son argent, achète des esclaves et des bestiaux;
il fera même' l’acquisition de quelques domaines, mais pour en retirer un profit immédiat,
et non pour les bonifier. Pourroit-il se conduire autrement ! il n’a ni l’ambition de laisser un
nom après lu i, ni le désir, si naturel à l’homme, d’être remplacé par un autre soi-même sur
les lieux qui le virent heureux:, quand la nature-lui ordonnera de les quitter. Le dernier possesseur
des fermes de Constance, le vieux Cloète, fait seul exception à cette remarque. De
simple trompette, devenu gros propriétaire, il donna tous ses soins à la culture de ses biens,
et, sur le point de mourir, il en fit le partage entre ses enfans. Son Constance favori fut pour
le fils qui portoit son nom; de plus il voulut, par son testament, que ce domaine passât directement,
dans la ligne mâle, à celui qui auroit son nom de baptême, ou collatéralement à celui
de ses plus proches parens qui au nom de Cloète joindroit ce même prénom. II en résulte que
Constance est (en 1798 ) la terre la mieux entretenue qui soit dans la colonie.
Peut-être y a-t-il peu de pays où la propriété change de mains aussi fréquemment. Non-
18.18.
Mars.