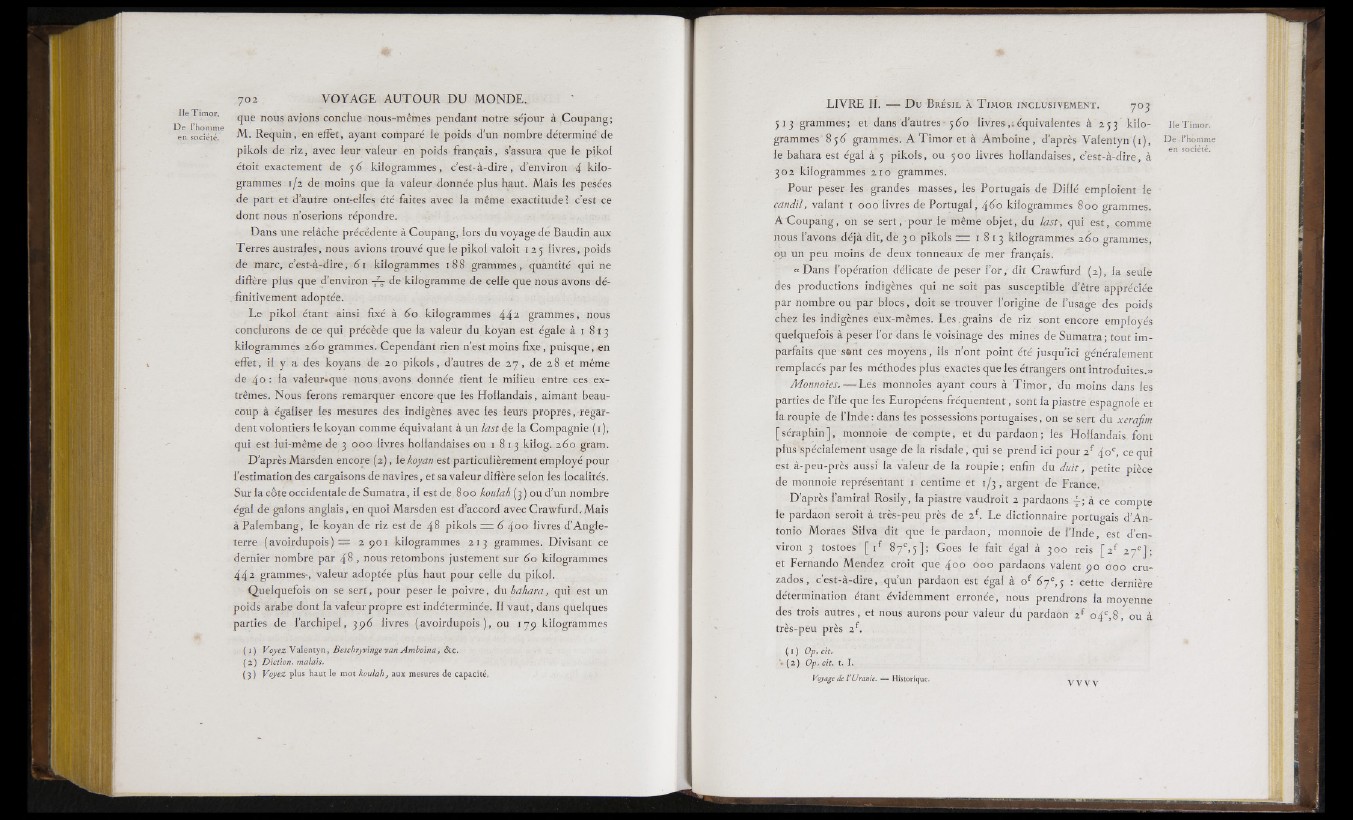
De l’homme
en. société.
que nous avions conclue nous-mêmes pendant notre séjour à Coupang;
M. Requin, en effet, ayant comparé le poids d’un nombre déterminé de
pikols de riz, avec leur valeur en poids français, s’assura que le pikol
étoit exactement de 56 kilogrammes, c’est-à-dire, d’environ 4 kilogrammes
1/2 de moins que la valeur donnée plus haut. Mais les pesées
de part et d’autre ont-elles été faites avec la même exactitude? c’est ce
dont nous n’oserions répondre.
Dans une relâche précédente à Coupang, lors du voyage de Baudin aux
Terres australes, nous avions trouvé que le pikol valoit 12 5 livres, poids
de marc, c’est-à-dire, 6 1 kilogrammes 1 8 8 grammes, quantité qui ne
diffère plus que d’environ de kilogramme de celle que nous avons dé-
. finitivement adoptée.
Le pikol étant ainsi fixé à 60 kilogrammes 442 grammes, nous
conclurons de ce qui précède que la valeur du koyan est égale à 1 813
kilogrammes 260 grammes. Cependant rien n’est moins fixe , puisque, en
effet, il y a des koyans de 20 pikols, d’autres de 2 7 , de 28 et même
de 40 : la valeur.que nous, avons donnée tient le milieu entre ces extrêmes.
Nous ferons remarquer encore que les Hollandais, aimant beaucoup
à égaliser les mesures des indigènes avec les leurs propres, -regardent
volontiers le koyan comme équivalant à un lastde la Compagnie (1),
qui est lui-même de 3 000 livres hollandaises ou 1 8 13 kilog.. 260 gram.
D’après Marsden encore (2), le koyan est particulièrement employé pour
l’estimation des cargaisons de navires, et O 7 sa valeur diffère selon les localités.
Sur la côte occidentale de Sumatra, il est de, 800 koulah (3) ou d’un nombre
égal de galons anglais, en quoi Marsden est d’accord avec Crawfurd,Mais
à Palembang, le koyan de riz est de 48 pikols = 6 4 oo livres d’Angleterre
( avoirdupois ) = 29 0 1 kilogrammes 2 13 grammes. Divisant ce
dernier nombre par 48 , nous retombons justement sur 60 kilogrammes
442 grammes-, valeur adoptée plus haut pour celle du pikol.
Quelquefois on se sert, pour peser le poivre, du hahara, qui est un
poids arabe dont la valeur propre est indéterminée. Il vaut, dans quelques
parties de l’archipel, 396 livres (avoirdupois), ou 179 kilogrammes
( 1) Voyez Valentyn, Beschryvinge van Amboina, &c.
(2) Diction, malais.
(3) Voyez plus haut le mot koulah, aux mesures de capacité,
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 703
5 13 grammes; et dans d’autres- 360 livres,:équivalentes à 253 kilogrammes'
856 grammés. A Timor et à Amboine, d’après Valentyn (1),
le bahara est égal à y pikols, ou y00 livres hollandaises, c’est-à-dire, à
302 kilogrammes 2 10 grammes.
Pour peser les grandes masses, les Portugais de Dillé emploient le
çandil, valant 1 000 livres de Portugal, 460 kilogrammes 800 grammes.
A Coupang, on se sert, pour le même objet, du last-, qui est, comme
nous l’avons déjà dit, de 30 pikols — 1 81 3 kilogrammes 260 grammes,
ou un peu moins de deux tonneaux de mer français.
« Dans l’opération délicate de peser l’o r, dit Crawfurd (2), la seule
des productions indigènes qui ne soit pas susceptible d’être appréciée
par nombre ou par blocs, doit se trouver l’origine de l’usage des poids
chez les indigènes eux-mêmes. Les.grains de riz sont encore employés
quelquefois à peser l’or dans lè voisinage des mines de Sumatra; tout imparfaits
que sùnt ces moyens, ils n’ont point été jusqu’ici généralement
remplacés par les méthodes plus exactes que les étrangers ont introduites.»
Monnoies.—~Les monnoies ayant cours à Timor, du moins dans les
parties de l’île que les Européens fréquentent , sont la piastre espagnole et
la roupie de l’Inde : dans les possessions portugaises, on se sert du xerafim
[séraphin], monnoie de compte, et du pardaon; les Hollandais font
plus spécialement usage de la risdale , qui se prend ici pour 2f 4oc, ce qui
est à-peu-près aussi la valeur de la roupie; enfin du duit, petite pièce
de monnoie représentant 1 centime et 1/3 , argent de France.
D’après l’amiral Rosily, la piastre vaudrait 2 pardaons 4 ; à ce compte
le pardaon serait à très-peu près de 2f. Le dictionnaire portugais d’An-
tonio Moraes Sîlva dit que le.pardaon, monnoie de l’Inde, est d’environ
3 tostoes [ i f 87e,y]; Goes le fait égal à 300 reis [ 2 f 2,7e] ;
et Fernando Mendez croit que 400 000 pardaons valent 90 600 cru-
zados, c’est-à-dire, qu’un pardaon est égal à of 07e,y : cette dernière
détermination étant évidemment erronée, nous prendrons la moyenne
des trois autres, et nous aurons pour valeur du pardaon 2f 04e,8, ou à
très-peu près 2f.
(. i ) Op. cit.
* (2) Op. cit. t. I.
Voyage de VUranie. — Historique. y y y y
D e . l’homme
en société.