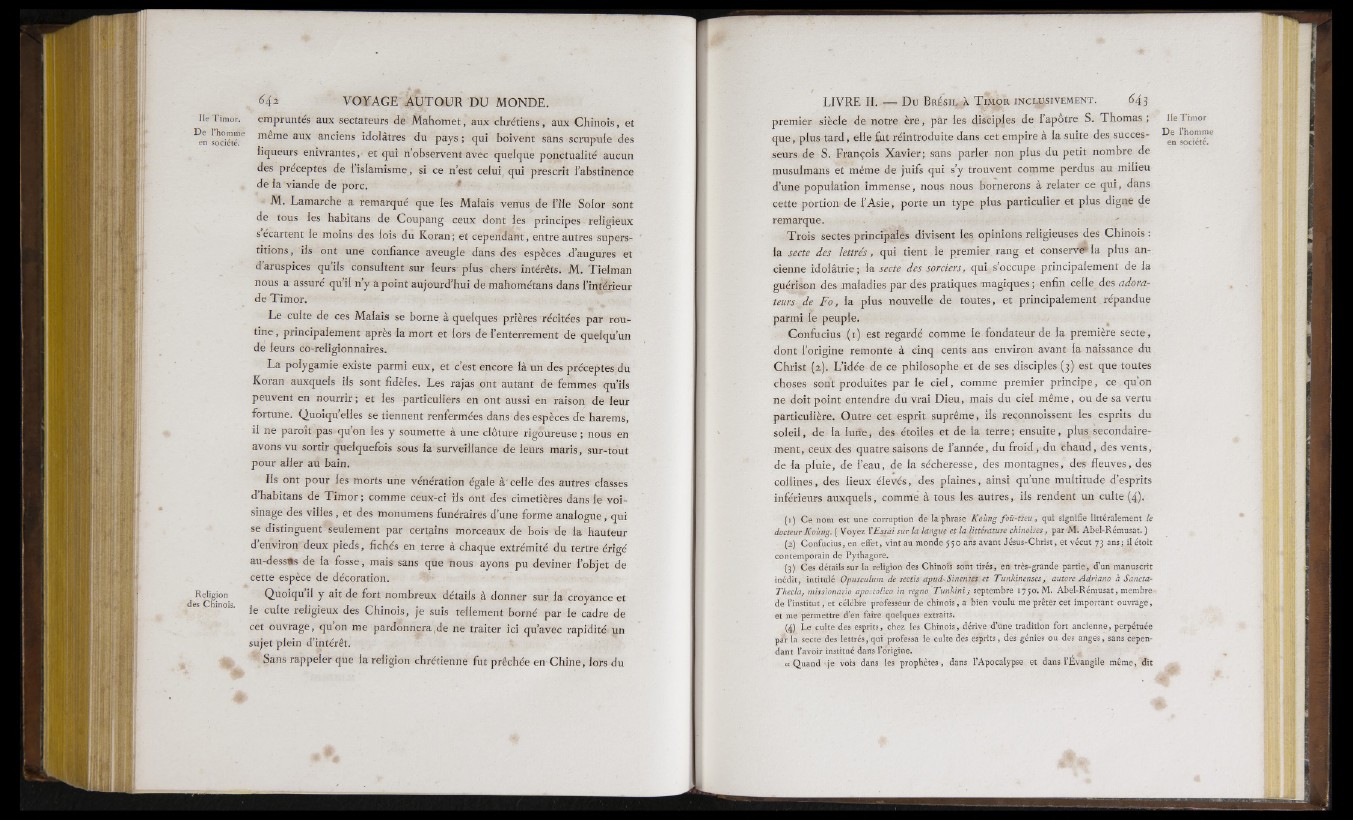
De l’homme
en société.
Religion
des Chinois.
empruntés aux sectateurs de Mahomet, aux chrétiens, aux Chinois, et
meme aux anciens idolâtres du pays; qui boivent sans scrupule des
liqueurs enivrantes,- et qui n’observent avec quelque ponctualité aucun
des préceptes de 1 islamisme, si ce n’est celui qui prescrit l’abstinence
de la viande de porc.
M. Lamarche a remarqué que les Malais venus de l’île Solor sont
de tous les habitans de Coupang ceux: dont les principes religieux
s écartent le moins des lois du Koran; et cependant, entre autres superstitions,
ils ont une confiance aveugle dans des espèces d’augures et
daruspices quils consultent sur leurs-plus chers intérêts. M. Tieiman
nous a assuré qu il n y a point aujourd’hui de mahométans dans l’intérieur
de Timor.
Le culte de ces Malais se borne à quelques prières récitées par routine
, principalement après la mort et lors de l’enterrement de quelqu’un
de leurs co-religionnaires.
La polygamie existe parmi eux, et c’est encore là un des préceptes du
Koran auxquels ils sont fidèles. Les rajas ont autant de femmes qu’ils
peuvent en nourrir ; et les particuliers en ont aussi en raison de leur
fortune. Quoiqu’elles se tiennent renfermées dans des espèces de harems,
il ne paroit pas qu on les y soumette à une clôture rigoureuse ; nous en
avons vu sortir quelquefois sous la surveillance de leurs maris, sur-tout
pour aller au bain.
Ils ont pour les morts une vénération égale à'celle des autres classes
d’habitans de Timor ; comme ceux-ci ils ont des cimetières dans le voisinage
des villes, et des monumens funéraires d’une forme analogue, qui
se distinguent seulement par certains morceaux de bois de la hauteur
d’environ deux pieds, fichés en terre à chaque extrémité du tertre érigé
au-dessiïs de la fosse, mais sans que nous ayons pu deviner l’objet de
cette espèce de décoration.
Quoiqu’il y ait de fort nombreux détails à donner sur la croyance et
le culte religieux des Chinois, je suis tellement borné par le cadre de
cet ouvrage, quon me pardonnera ,de ne traiter ici qu’avec rapidité un
sujet plein d’intérêt.
Sans rappeler que la religion chrétienne fut préchée en Chine, lors du
LIVRE II. — Du B r é s i l ,À T im o r i n c l u s i v e m e n t . 64 3
premier siècle de notre ère, par les disciples de 1 apotre S. Thomas ;
que, plus tard, elle fut réintroduite dans cet empire à la suite des successeurs
de S. François Xavier; sans parier non plus du petit nombre de
musulmans et même de juifs qui s’y trouvent comme perdus au milieu
d’une population immense, nous nous bornerons à relater ce qui, dans
cette portion de l’Asie, porte un type plus particulier et plus digne de
remarque.
Trois sectes principales divisent les opinions religieuses des Chinois :
la secte des lettrés, qui tient le premier rang et conservé» la plus ancienne
idolâtrie ; la secte des sorciers, qui s’occupe principalement de la
guérison des maladies par des pratiques magiques ; enfin celle des adorateurs
de F o , la plus nouvelle de toutes, et principalement répandue
parmi le peuple.
Confucius (1) est regardé comme le fondateur de la première secte,
dont l’origine remonte à cinq cents ans environ avant la naissance du
Christ (2). L’idée de ce philosophe et de ses disciples (3) est que toutes
choses sont produites par le ciel, comme premier principe, ce qu’on
ne doit point entendre du vrai Dieu, mais du ciel même, ou de sa vertu
particulière. Outre cet esprit suprême, ils reeonnoissent les esprits du
soleil, de la lune, des étoiles et de la terre; ensuite, plus secondairement,
ceux des quatre saisons de l’année, du froid , du chaud, des vents,
de la pluie, de l’eau, de la sécheresse, des montagnes, des fleuves, des
collines, des lieux élevés, des plaines, ainsi qu’une multitude d’esprits
inférieurs auxquels, comme à tous les autres, ils rendent un culte (4).
(1) Ce nom est une corruption de la phrase Koùng foü-tseu, qui signifie littéralement le
docteur Koung. ( Voyez I*Essai sur la langue et la littérature chinoises, par M. Abel-Rémusat. )
(2) Confucius, en effet, vint au monde 550 ans avant Jésus-Christ, et vécut 73 ans ; il étoit
contemporain de Pythagore.
(3) Ces détails sur la religion des Chinois sont tirés, en très-grande partie, d’un manuscrit
inédit, intitulé Opusculum de sectis apud^Sinenses et Tunkinenses, autore Adriano a Sancta-
Thecla, missionario apostolico in regno Tunkini ; septembre 1750. M. Abel-Rémusat, membre-
de l’institut, et célèbre professeur de chinois, a bien voulu me prêter cet important ouvrage,
et me permettre d’en faire quelques extraits.
(4) Le culte des esprits, chez les Chinois, dérive d’une tradition fort ancienne, perpétuée
par la secte des lettrés, qui professa le culte dés esprits, des génies ou des anges, sans cependant
l’avoir institué dans l’origine.
« Quand'je vois dans les prophètes, dans l’Apocalypse et dans l’Évangile même, dit
De l’homme
en société.