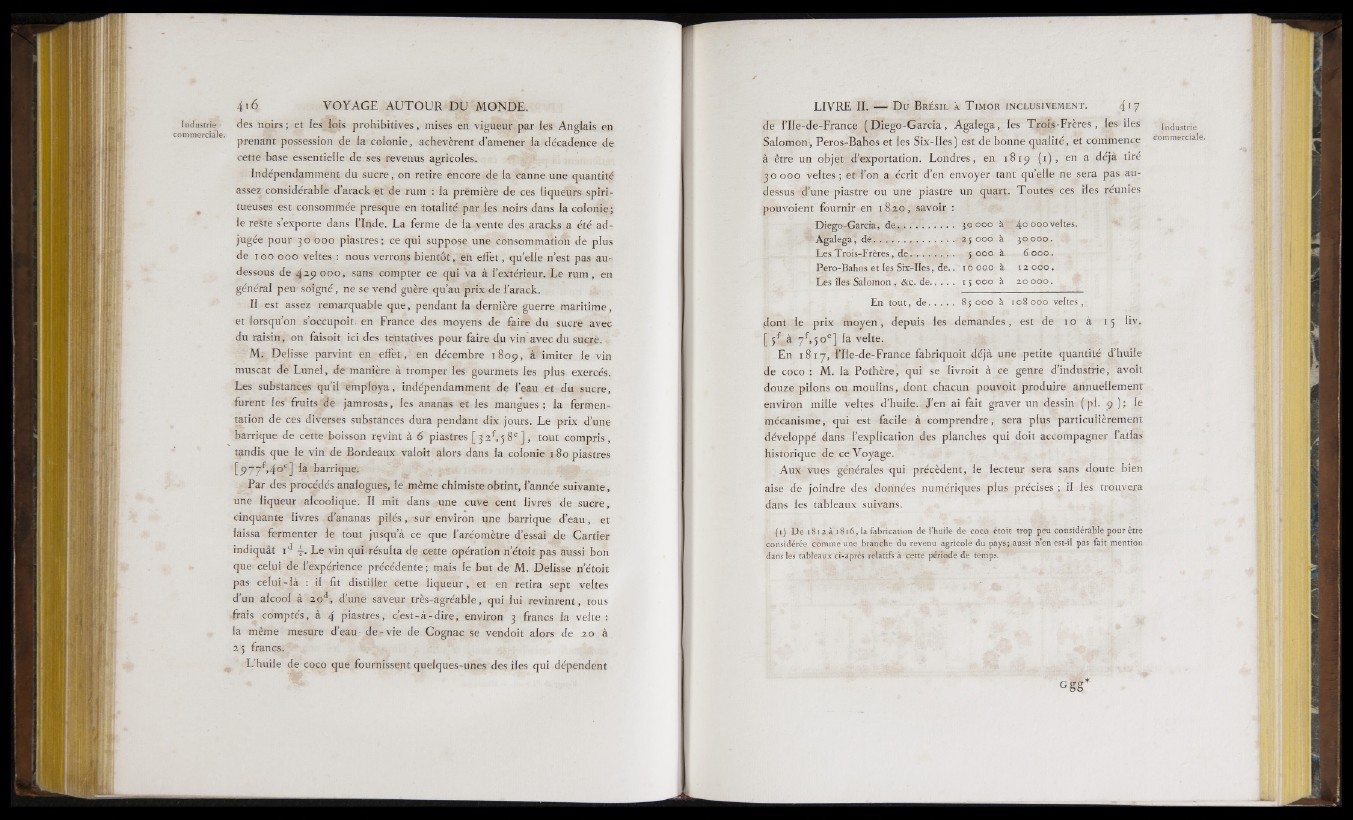
des noirs; et les lois prohibitives, mises en vigueur par les Anglais en
prenant possession de la colonie, achevèrent d’amener la décadence de
cette base essentielle de ses revenus agricoles.
Indépendamment du sucre, on retire encore de la canne une quantité
assez considérable d’arack et de ram : la première de ces liqueurs spiri-
tueuses est consommée presque en totalité par les noirs dans la colonie ;
le reSte s’exporte dans l’Inde. La ferme de la vente des aracks a été adjugée
pour 30 0 0 0 piastres; ce qui suppose une consommation de plus
de 100 000 veltes : nous verrons bientôt, en effet, qu’elle n’est pas au-
dessous de 429 000 , sans compter ce qui va à l’extérieur. Le rum , en
général peu soigné, ne se vend guère qu’au prix de l’arack.
Il est assez remarquable que, pendant la dernière guerre maritime,
et lorsqu’on s’occupoit. en France des moyens de faire du sucre avec
du raisin, on faisoit ici des tentatives pour faire du vin avec du sucre.
M. Delisse parvint en effet, en décembre 18 0 9 , à imiter le vin
muscat de Lunel, de manière à tromper les gourmets les plus exercés.
Les substances qu’il employa, indépendamment de l’eau et - du sucre,
furent les fruits de jamrosas, les ananas et les mangues ; la fermentation
de ces diverses substances dura pendant dix jours. Le prix d’une
barrique de cette boisson revint à 6 piastres [ 3 21,5 80 ] , tout .compris,
tandis que le vin de Bordeaux valoit alors dans la colonie 180 piastres
[ 9 ? 7 >4°c] la barrique.
Par des procédés analogues, le même chimiste obtint, l’année suivante,
une liqueur alcoolique. Il mit dans une cuve cent livres de sucre,
cinquante livres d’ananas pilés, sur environ une barrique d’eau, et
laissa fermenter le tout jusqu’à ce que l’aréomètre d’essai de Cartier
indiquât 1 d Le vin qui résulta de cette opération n’étoit pas aussi bon
que celui de l’expérience précédente ; mais le but de M. Delisse n’étoit
pas celui - là : il fit distiller cette liqueur, et en retira sept veltes
d’un alcool à 20^, d’une saveur très-agréable, qui lui revinrent, tous
frais comptés, à 4 piastres, c’est-à-dire, environ 3 francs la velte :
la même mesure d’eau de-vie de Cognac se vendoit alors de 20 à
2 5 francs.
L huile de coco que fournissent quelques-unes des îles qui dépendent
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c lu s i v e m e n t . 4 1 7
de l’Ile-de-France ( Diego-Garcia, Agalega, les Trois-Frères , les îles
Salomon, Peros-Bahos et les Six-Iles) est de bonne qualité, et commence
à être un objet d’exportation. Londres, en 18 19 (1) , en a déjà tiré
30000 veltes; et l’on a écrit d’en envoyer tant qu’elle ne sera pas au-
dessus d’une piastre ou une piastre un quart. Toutes ces îles réunies
pouvoient fournir en 1 820, savoir :
Diego-Garcia, d e . ; , ...................... 30 0 0 0 à ' 4 ° 000 veltes.
Agalega, d e 2 5 0 0 0 à 30 0 0 0 .
Les Trois-Frères, dei ^ . , . . . . 50 0 0 à 6 0 0 0 .
Pero-Bahos et les Six-Iles, d e .. 10 000 à 1 2 0 0 0 .
Les îles Salomon , &c. de 15 000 à 20 0 0 0. ^
En tout, d e...............850 00 à 10 8 0 0 0 veltes,
fiont le prix moyen, depuis les demandes, est de 10 à 15 liv.
[ j f_ à 7^50°] la velte.
En 18 17 , l'Ile-de-France fabriquoit déjà une petite quantité d’huile
de coco : M. la Pothère, qui se livroit à ce genre d’industrie, avoit
douze pilons ou moulins, dont chacun pouvoit produire annuellement
environ mille veltes d’huile. J ’en ai fait graver un dessin (pl. 9 ); le
mécanisme, qui est facile à comprendre, sera plus particulièrement
développé dans l’explication des planches qui doit accompagner l’atlas
historique de ce Voyage.
Aux vuçs générales qui précèdent, le lecteur sera sans doute bien
aise de joindre des données numériques plus précises ; il les trouvera
dans les tableaux suivans.
(1) De 1812 à 1816, la fabrication de l’huile de coco étoit trop peu considérable pour être
considérée comme une branche du revenu agricole du pays; aussi n’en est-il pas fait mention
dans les tableaux ci-après relatifs à cette période de temps."* JP
c g g *