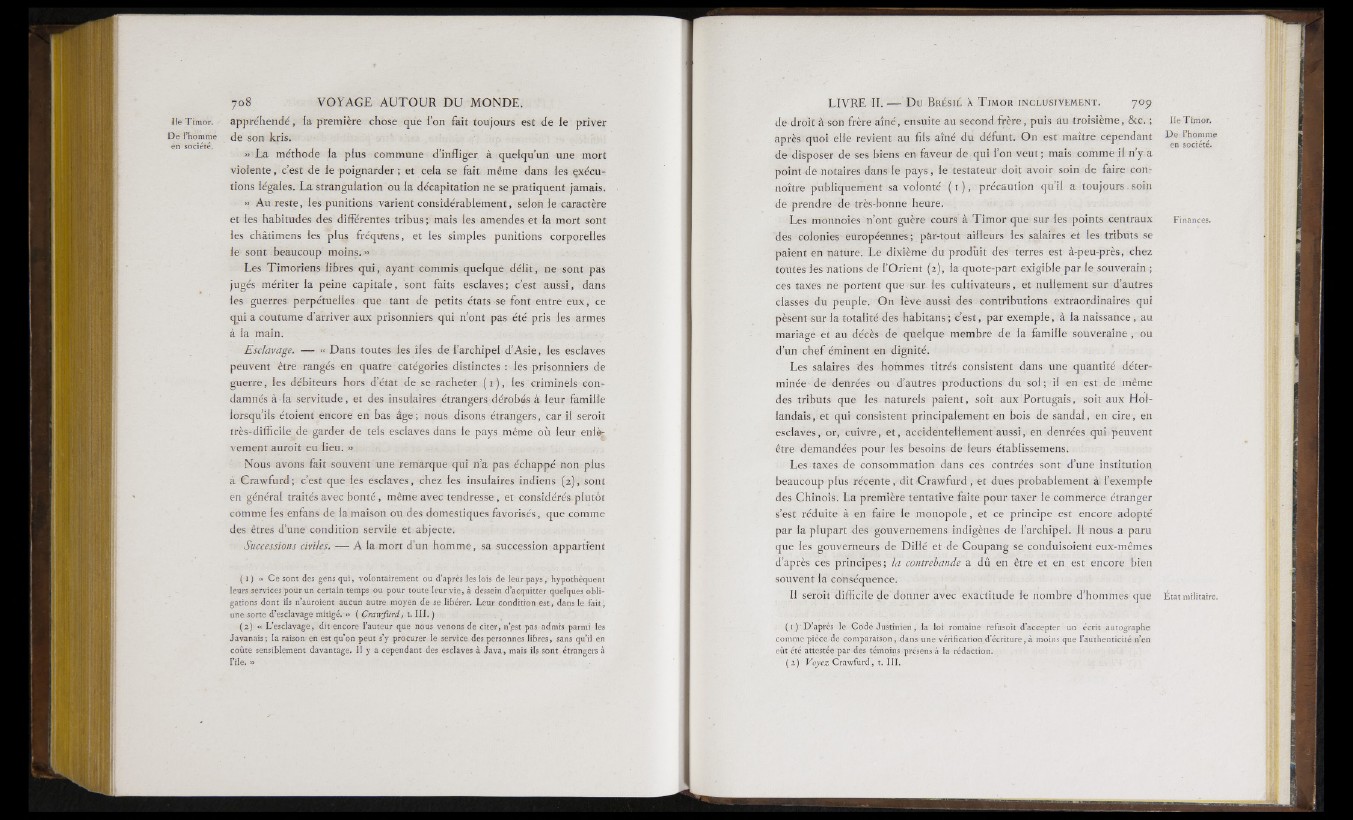
De l’homme
én société.
appréhendé, la première chose que i’on fait toujours est de ie priver
de son kris.
» La méthode la plus commune d’infliger à quelqu’un une mort
violente, c’est de le poignarder ; et cela se fait même dans les exécutions
légales. La strangulation ou la décapitation ne se pratiquent jamais.
» Au reste, les punitions varient considérablement, selon le caractère
et les habitudes des différentes tribus ; mais les amendes et la mort sont
les châtimens les plus fréqtrens, et les simples punitions corporelles
le sont beaucoup moins.»
Les Timoriens libres qui, ayant commis quelque délit, ne sont pas
jugés mériter la peine capitale, sont faits esclaves; c’est aussi, dans
les guerres perpétuelles que tant de petits états se font entre eux, ce
qui a coutume d’arriver aux prisonniers qui n’ont pas été pris les armes
à la main.
Esclavage. — « Dans toutes les îles de l’archipel d’Asie, les esclaves
peuvent être rangés en quatre catégories distinctes : les prisonniers de
guerre, les débiteurs hors d’état de se racheter ( 1 ) , les criminels condamnés
à la servitude, et des insulaires étrangers dérobés à leur famille
lorsqu’ils étoient encore en bas âge; nous disons étrangers, car il seroit
très-difficile de garder de tels esclaves dans le pays même où leur enlèvement
auroit eu lieu. »
Nous avons fait souvent une remarque qui n’a pas échappé non plus
à Crawfurd; c’est que les esclaves, chez les insulaires indiens (2), sont
en général traités avec bonté, même avec tendresse , et considérés plutôt
comme les enfans de la maison ou des domestiques favorisés, que comme
des êtres d’une condition servile et:abjecte:
Successions civiles. -r— A la mort d’un homme, sa succession appartient
( 1 ) « Ce sont des gens qui, volontairement ou d’après les lois de leur pays, hypothèquent
leurs services pour un certain temps ou pour toute leur vie, à dessein d’acquitter quelques obligations
dont ils n’auroient aucun autre moyen de se libérer. Leur condition est, dans le fait;
une sorte d’esclavage mitigé. » ( Crawfurd, t. III. )
(2) « L’esclavage, dit encore fauteur que nous venons de citer, n’est pas admis parmi les
Javanais; la raison en est qu’on peut s’y procurer le service des personnes libres, sans qu’il en
coûte sensiblement davantage. 11 y a cependant des esclaves à Java, mais ils sont étrangers à
l’île. »
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 7 0 9
de droit à son frère aîné, ensuite au second frère, puis au troisième, &c. ;
après quoi elle revient au fils aîné du défunt. On est maître cependant
de disposer de ses biens en faveur de qui i’on veut; mais comme il n’y a
point de notaires dans le pays, le testateur doit avoir soin de faire con-
noître publiquement sa volonté ( 1 ), précaution qu’il a toujours soin
de prendre de très-bonne heure.
Les monnoies n’ont guère cours à Timor que sur les points centraux
des colonies européennes; pàr-tout ailleurs les salaires et les tributs se
paient en nature. Le dixième du produit des terres est à-peu-près, chez
toutes les nations de l’Orient (2), la quote-part exigible par le souverain ;
ces taxes ne portent que sur les cultivateurs, et nullement sur d’autres
classes du peuple. On lève aussi des contributions extraordinaires qui
pèsent sur la totalité des habitans ; c’est, par exemple, à la naissance, au
mariage et au décès de quelque membre de la famille souveraine , ou
d'un chef éminent en dignité.
Les salaires des hommes titrés consistent dans une quantité déterminée
de denrées ou d’autres productions du sol; il en est de même
des tributs que les naturels paient, soit aux Portugais, soit aux Hollandais
, et qui consistent principalement en bois de sandal, en cire, en
esclaves, or, cuivre, et, accidentellement aussi, en denrées qui peuvent
être demandées pour les besoins de leurs établissemens.
Les taxes de consommation dans ces contrées sont d’une institution
beaucoup plus récente, dit Grawfurd , et dues probablement à l’exemple
des Chinois. La première tentative faite pour taxer le commerce étranger
s’est réduite à en faire le monopole, et ce principe est encore adopté
par la plupart des gouvernemens indigènes de l’archipel. Il nous a para
que les gouverneurs de Dilié et de Coupang se conduisoient eux-mêmes
d’après ces principes; la contrebande a dû en être et en est encore bien
souvent la conséquence.
Il seroit difficile de donner avec exactitude le nombre d’hommes que
( 1 ) D ’après le Code Justinien, la loi romaine refüsoit d’accepter un écrit autographe
comme pièce de comparaison, dans une vérification d’écriture, à moins que l’authenticité n’en
eut été attestée par des témoins présens à la rédaction.
(2) Voyez Crawfurd, t. III.
De l’homme
en société.
Finances.
État militaire.