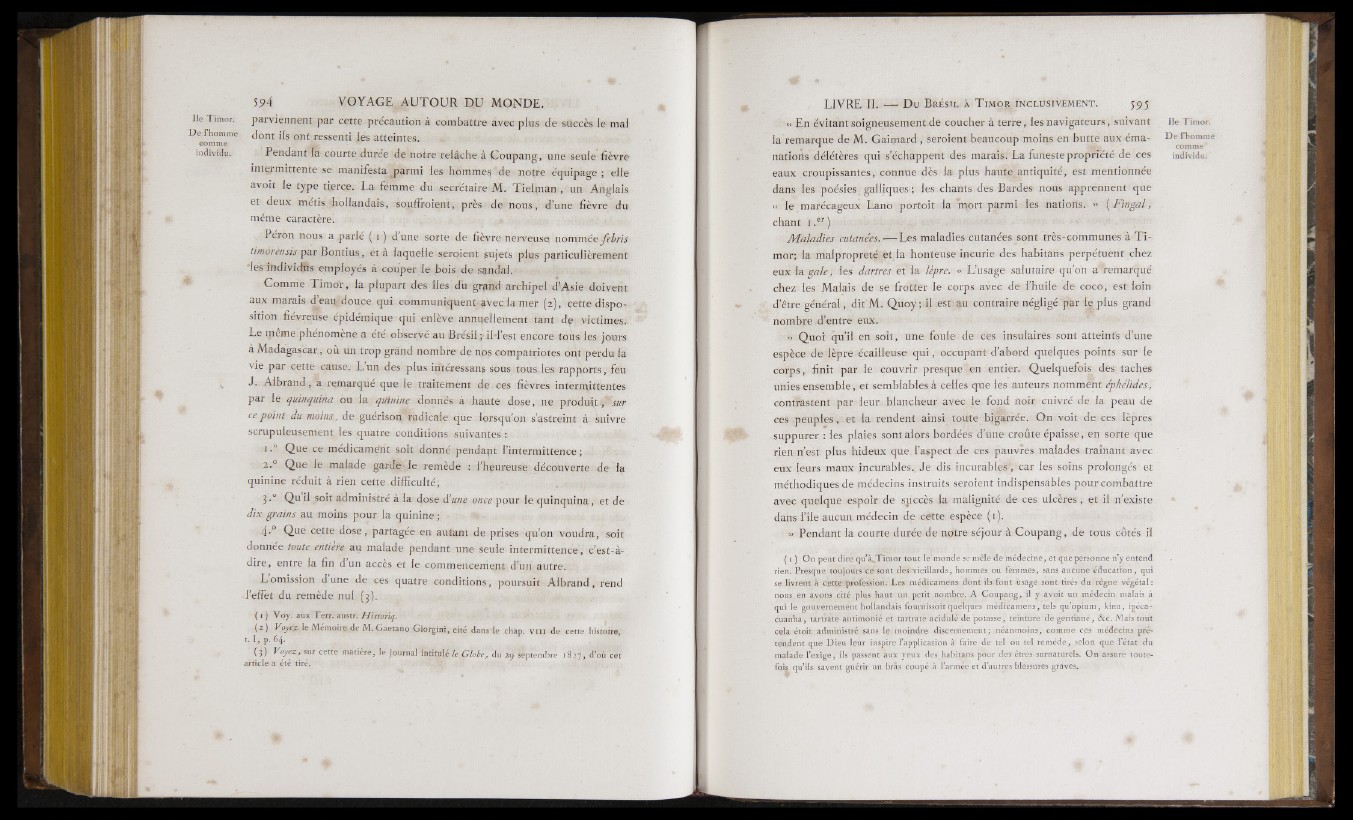
De Thonime
somme
individu.
parviennent par cette précaution à combattre avec plus de succès ie mal
dont ils ont ressenti les atteintes.
Pendant la courte durée de notre relâche à Coupang, une seule fièvre
inteimittente se manifesta parmi les hommes -de notre équipage ; elle
avoit le type tierce. La- femme du secrétaire M. Tieiman , un Anglais
et deux métis hollandais, souffroient, près de nous, d’une fièvre du
même caractère.
Peron nous a parle ( i ) dune sorte de fièvre nerveuse nommée febris
timorensis par Bontius, et a laquelle seroient sujets plus particulièrement
•les individus employés à couper le bois de sandal.
Comme Timor, la plupart des îles du grand archipel d'Asie doivent
aux marais Teaur douce qui communiquent avec la mer (2), çette disposition
fiévreuse épidémique qui enlève annuellement tant dp victimes.
Le même phénomène a été observé au Brésil,;-il lest encore tous les jours
a Madagascar, ou un trop grand nombre de nos compatriotes ont perdu la
vie par cette cause. L’un des plus intéressang sous tous les rapports, feu
J . Aibrand, a remarque que le traitement de ces fièvres intermittentes
par le quinquina ou la quinine donnés à haute dose, ne produit$>sur
ce point du moins, de guérison radicale que lorsqu’on s’astreint à suivre
scrupuleusement les quatre conditions suivantes :
1.° Que ce médicament soit donné pendant l’intermittence;
2. Que le malade garde le remède : l’heureuse découverte de la
quinine réduit à rien cette.difficulté;
3 '° Qu soit administre à la dose d’une once pour ie quinquina, et de
dix grains au moins pour la quinine ; ■
4 -° Que cette dose, partagée en autant de prises qu’on voudra, soit
donnée toute entiere au malade pendant une seule intermittence, c’est-à-
dire, entre la fin dun accès et le commencement d’un autre.
Lomission dune de ces quatre conditions, poursuit Aibrand, rend
• l’effet du remède nul (3).
( 1 ) Vôy. aux Terr. austr. Historiq,
(2) Voyez le Mémoire de M. Gaetano Giorgini, cité dans le chap. v in de cette histoire,
1 . 1 , p . 6 4 .
(3) Voyez, sur cette matière, le journal intitulé le Globe, du 29 septembre 1827, d’où cet
article a été tiré.
« En évitant soigneusement de coucher à terre, les navigateurs, suivant
la remarque de M. Gaimard , seroient beaucoup moins en butte auxéma-
natioiis délétères qui s’échappent des marais. La funeste propriété de ces
eaux croupissantes, connue dès la plus hautesantiquité, est mentionnée
dans les poésies galliques ; les chants des Bardes nous apprennent que
» le marécageux Lano portoit la mort parmi les nations. « ( Fingai,
chant i . er)
Maladies cutanées. — Les maladies cutanées sont très-communes à T i mor;
la malpropreté et la honteuse incurie des habitans perpétuent chez
eux la gale; les dartres et la lèpre-. » L’usage salutaire qu’on a remarqué
chez les Malais de se frotter le corps avec de l’huile de coco, est. loin
d’être générai, dit'M. Quoy ; il .est.au contraire négligé par leplus grand
nombre d’entre eux.
S Quoi qu’il en soit, une foule de ces insulaires sont atteints d’une
espèce de lèpre écailleuse qui, occupant d’abord quelques points sur le
corps, finit par le couvrir presque en entier. Quelquefois des taches
unies ensemble, et semblables à celles que les auteurs nomment éphélides,
contrastent par leur blancheur avec Je fond noir cuivré de la peau de
ces peuples,'et la rendent ainsi toute bigarrée. On voit de ces lèpres
suppurer : les plaies sont alors bordées d’une croûte épaisse, en sorte que
rien n’est plus hideux que l’aspect de ces pauvres malades tramant avec
eux leurs maux incurables. Je dis incurables y car les soins prolongés et
méthodiques de médecins instruits seroient indispensables pour combattre
avec quelque espoir de succès la malignité de ces ulcères, et il n’existe
dans l’île aucun médecin de cette espèce ( 1 ).
» Pendant la courte durée de notre séjour à Coupang, de tous côtés il
( i ) On peut dire qu’àrTimor tout le"monde se mêle de médecine, et que personne n’y entend
rien. Presque toujours ce sont dès vieillards, hommes ou femmes, sans aucune éducation, qui
se livrent à cette profession. Les médicamens dont ils font usage,sont tirés du règne végétal:
nous en avons cité plus haut un petit nombre. A Coupang, il y avoit un médecin malais à
qui le gouvernement hollandais fournissoit quelques médicamens, tels qu’opium, kina, ipéca-
cuanha, tartrate antimonié et tartrate acidulé de potasse, teinture de gentiane, &c. Mais tout
cela étoit administré sans le moindre discernement; néanmoins, comme ces médecins prétendent
que Dieu leur inspire l’application à faire de tel ou tel remède., selon que l’état du
malade l’exige, ils passent aux yeux des- habitans pour des êtres surnaturels. On assure toutefois
qu’ils savent guérir un bras coupé à l’armée et d’autres blessures graves^
De l’homme
comme
individu.