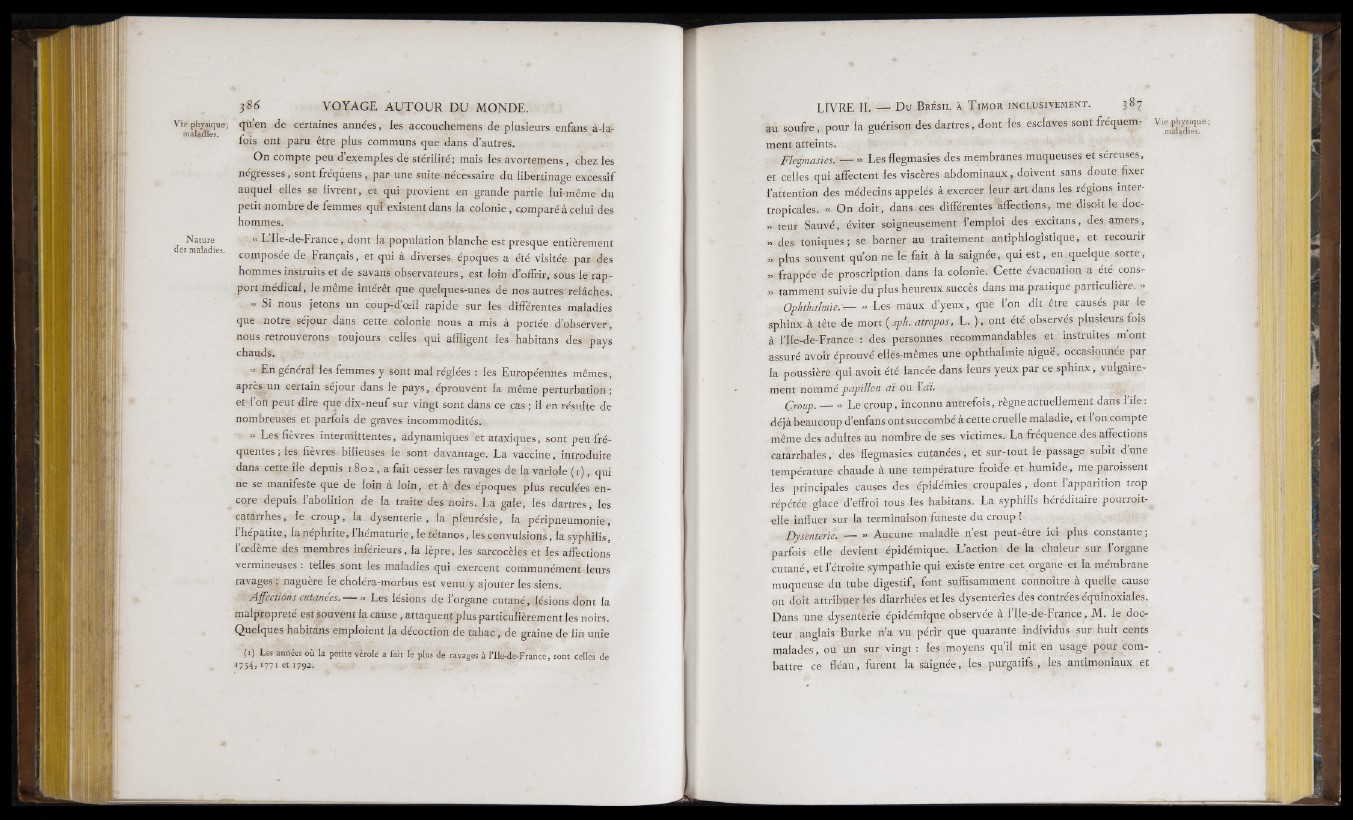
Vie physique;
maladies.
Nature
des maladies.
quen de certaines années, les accouchemens de plusieurs enfans à-lafois
ont paru être plus communs que dans d’autres.
On compte peu d’exemples de stérilité; mais les avortemens, chez les
négresses, sont fréqüens,. par une suite nécessaire du libertinage excessif
auquel elles se livrent, et qui provient en grande partie lui-même du
petit nombre de femmes qui existent dans la colonie, comparé à celui des
hommes.
« L Ile-de-France, dont la population blanche est presque entièrement
composée de Français, et qui à diverses époques a été visitée par des
hommes instruits et de savans observateurs, est loin d’offrir, sous le rapport
médical, le même intérêt que quelques-unes de nos autres relâches.
» Si nous jetons un coup-doeil rapide sur les différentes maladies
que notre séjour dans cette colonie nous a mis à portée d’observer,
nous retrouverons toujours celles qui affligent les habitans des pays
chauds.
” général les femmes y sont mal réglées : les Européennes mêmes,
après un certain séjour dans le pays, éprouvent la même perturbation;
et l’on peut dire que dix-neuf sur vingt sont dans ce cas ; il en résulte de
nombreuses et parfois de graves incommodités.
» Les fièvres intermittentes, adynamiques et ataxiques, sont peu fréquentes
; les fièvres bilieuses le sont davantage. La vaccine, introduite
dans cette île depuis 1802, a fait cesser les ravages de la variole (1) ., qui
ne se manifeste que de loin a loin, et à des époques plus reculées encore
depuis 1 abolition de la traite des noirs. La gale, les dartres, les
catarrhes, le croup, la dysenterie, la pleurésie, la péripneumonie,
1 hepatite, la nephrite, 1 hématurie, le tétanos, les convulsions, la syphilis,
l’oedème des membres inférieurs, la lèpre, les sarcocèles et les affections
vermineuses : telles sont les maladies qui exercent communément leurs
ravages ; naguère le choiéra-morbus est venu y ajouter les siens.
Affections cutanées. — » Les lésions de l’organe cutané, lésions dont la
malpropreté est souvent la cause, attaquent plus particulièrement les noirs.
Quelques habitans emploient la décoction de tabac, de graine de lin unie
(1) Les années où la petite vérole a fait le plus de ravages à I’IIe-de-Francë, sont celles de
i7?4>>771 « i792-
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r i n c l u s i v e m e n t . 387
au soufre, pour la guérison des dartres, dont les esclaves sont fréquem-
ment atteints.
Flegmasies. — » Les ffegmasies des membranes muqueuses et séreuses,
et celles qui affectent les viscères abdominauxdoivent sans doute, fixer
l’attention des médecins appelés à exercer leur art dans les régions intertropicales.
« On doit, dans ces différentes affections, me disoit le doc-
» teur Sauvé, éviter soigneusement l’emploi des excitans, des amers,
» des toniques; se borner au traitement antîphlagistique, et recourir
» plus souvent qu’on ne le fait à la saignée, qui est, en. quel que sorte,
» frappée de proscription dans la colonie. Cette évacuation a été cons-
» tamment suivie du plus heureux succès dans ma pratique particulière. »
Ophthalmie.— » Les maux d’yeux, que l’on dit être causés par le
sphinx à tête de mort ( sph. átropos, L. ) , ont été observés plusieurs fois
à l’Ile-de-France : des personnes recommandables et instruites m’ont
assuré avoir éprouvé elles-mêmes une ophthabnie aiguë, occasionnée par
la poussière qui avoit été lancée dans leurs yeux par ce sphinx, vulgairement
nommé papillon ai ou Y ai.
Croup. —¡ » Le croup, inconnu autrefois, règne actuellement dans 1 île :
déjà beaucoup d’enfans ontsuccombé à cette cruelle maladie, et 1 on compte
même des adultes au nombre de ses victimes. La fréquence des affections
catarrhales, des flegmasies cutanées, et sur-tout le passage subit d une
température chaude à une température froide et humide, me paroissent
les principales causes des épidémies croupales, dont 1 apparition trop
répétée glace d’effroi tous les habitans. La syphilis héréditaire pourroit-
elle influer sur la terminaison funeste du croupi
Dysenterie. — » Aucune maladie n’est peut-être ici plus constante ;
parfois elle devient épidémique. L ’action de'la chaleur sur l’organe
cutané, et l’étroite sympathie qui existe entre cet organe et la membrane
muqueuse du tube digestif, font suffisamment connoître à quelle cause
on doit attribuer les diarrhées et les dysenteries des contrées équinoxiales.
Dans une dysenterie épidémique observée à l’Ile-de-France, M. le docteur
anglais Burke n’a vu périr que quarante individus sur huit cents
malades, ou un sur vingt : les moyens qu’il mit en usage pour com- _
battre ce fléau, furent la saignée, les purgatifs , les antimoniaux et