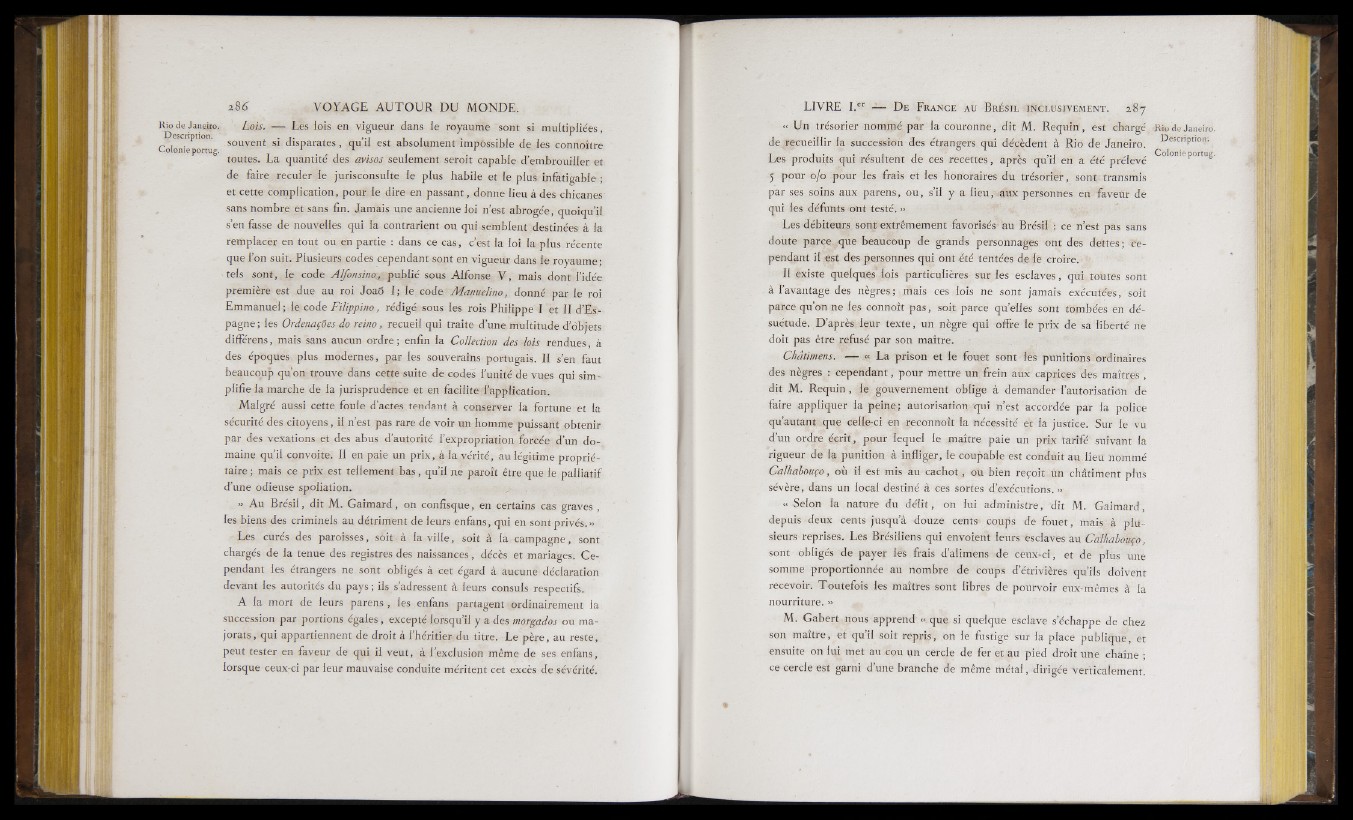
Colonie portug.
Lois. — Les lois en vigueur dans le royaume sont si multipliées,
souvent si disparates, qu’il est absolument impossible de les connoître
toutes. La quantité des avisos seulement seroit capable d’embrouiller et
de faire reculer le jurisconsulte le plus habile et le plus infatigable ;
et cette complication, pour le dire en passant, donne lieu à des chicanes
sans nombre et sans fin. Jamais une ancienne loi n’est abrogée, quoiqu’il
s’en fasse de nouvelles qui la contrarient ou qui semblent destinées à la
remplacer en tout ou en partie : dans ce cas, c’est la loi la plus récente
que l’on suit. Plusieurs codes cependant sont en vigueur dans le royaume ;
tels sont, le code Alfonsino, publié sous Alfonse V , mais dont l’idée
première est due au roi Joaô I; le code Manuelino, donné par le roi
Emmanuel ; le code Filippino, rédigé sous les rois Philippe I et II d’Espagne
; les Ordenaçoes do reino, recueil qui traite d’une multitude d’objets
différens, mais sans aucun ordre ; enfin la Collection des lois rendues, à
des époques plus modernes, par les souverains portugais. Il s’en faut
beaucoup qu’on trouve dans cette suite de codes l’unité de vues qui simplifie
la marche de la jurisprudence et en facilite l’application.
Malgré aussi cette foule d’actes tendant à conserver la fortune et la
sécurité des citoyens, il n’est pas rare de voir un homme puissant obtenir
par des vexations et des abus d’autorité l’expropriation forcée d’un domaine
qu’il convoite. Il en paie un prix, à la vérité, au légitime propriétaire
; mais ce prix est tellement bas, qu’il ne paroît être que le palliatif
d’une odieuse spoliation.
« Au Brésil, dit M. Gaimard, on confisque, en certains cas graves ,
les biens des criminels au détriment de leurs enfans, qui en sont privés.»
Les curés des paroisses, soit à la ville, soit à la campagne, sont
chargés de la tenue des registres des naissances, décès et mariages; Cependant
les étrangers ne sont obligés à cet égard à aucune déclaration
devant les autorités du pays; ils s adressent à leurs consuls respectifs.
A la mort de leurs parens , les enfans partagent ordinairement la
succession par portions égales, excepté lorsqu’il y a des morgados ou majorais,
qui appartiennent de droit à l’héritier du titre. Le père, au reste,
peut tester en faveur de qui il veut, à l’exclusion même de ses enfans,
lorsque ceux-ci par leur mauvaise conduite méritent cet excès de sévérité.
LIVRE I.er — De F r a n c e a u B r é s i l in c l u s iv e m e n t . 2 8 7
« Un trésorier nommé par la couronne, dit M. Requin, est chargé
de recueillir la succession des étrangers qui décèdent à Rio de Janeiro.
Les produits qui résultent de ces recettes, après qu’il en a été prélevé
5 pour 0/0 pour les frais et les honoraires du trésorier, sont transmis
par ses soins aux parens, ou, s’il y a lieu, aux personnes en faveur de
qui les défunts ont testé. »
Les débiteurs sont extrêmement favorisés au Brésil : ce n’est pas sans
doute parce que beaucoup de grands personnages ont des dettes ; cependant
il est des personnes qui ont été tentées de le croire.
Il existe quelques lois particulières sur les esclaves, qui toutes sont
à l’avantage des nègres; mais ces lois ne sont jamais exécutées, soit
parce qu’on ne les connoît pas, soit parce quelles sont tombées en désuétude.
D’après leur texte, un nègre qui offre le prix de sa liberté ne
doit pas être refusé par son maître.
Châtimens. — « La prison et le fouet sont les punitions ordinaires
des nègres : cependant, pour mettre un frein aux caprices des maîtres ,
dit M. Requin, le gouvernement oblige à demander l'autorisation de
faire appliquer la peine; autorisation qui n’est accordée par la police
qu’autant que celle-ci en reconnoît la nécessité et la justice. Sur le vu
d’un ordre écrit, pour lequel le maître paie un prix tarifé suivant la
rigueur de la punition à infliger, le coupable est conduit au lieu nommé
Calhabouço, où il est mis au cachot, ou bien reçoit un châtiment plus
sévère, dans un local destiné à ces sortes d’exécutions.»
« Selon la nature du délit, on lui administre, dit M. Gaimard,
depuis deux cents jusqu’à douze cents coups de fouet, mais à plusieurs
reprises. Les Brésiliens qui envoient leurs esclaves au Calhabouço,
sont obligés de payer les frais d’alimens de ceux-ci, et de plus une
somme proportionnée au nombre de coups d’étrivières qu’ils doivent
recevoir. Toutefois les maîtres sont libres de pourvoir eux-mêmes à la
nourriture. »
M. Gabert nous apprend « que si quelque esclave s’échappe de chez
son maître, et qu’il soit repris, on le fustige sur la place publique, et
ensuite on lui met au cou un cercle de fer et au pied droit une chaîne ;
ce cercle est garni d’une branche de même métal, dirigée verticalement.
Coionie portug.