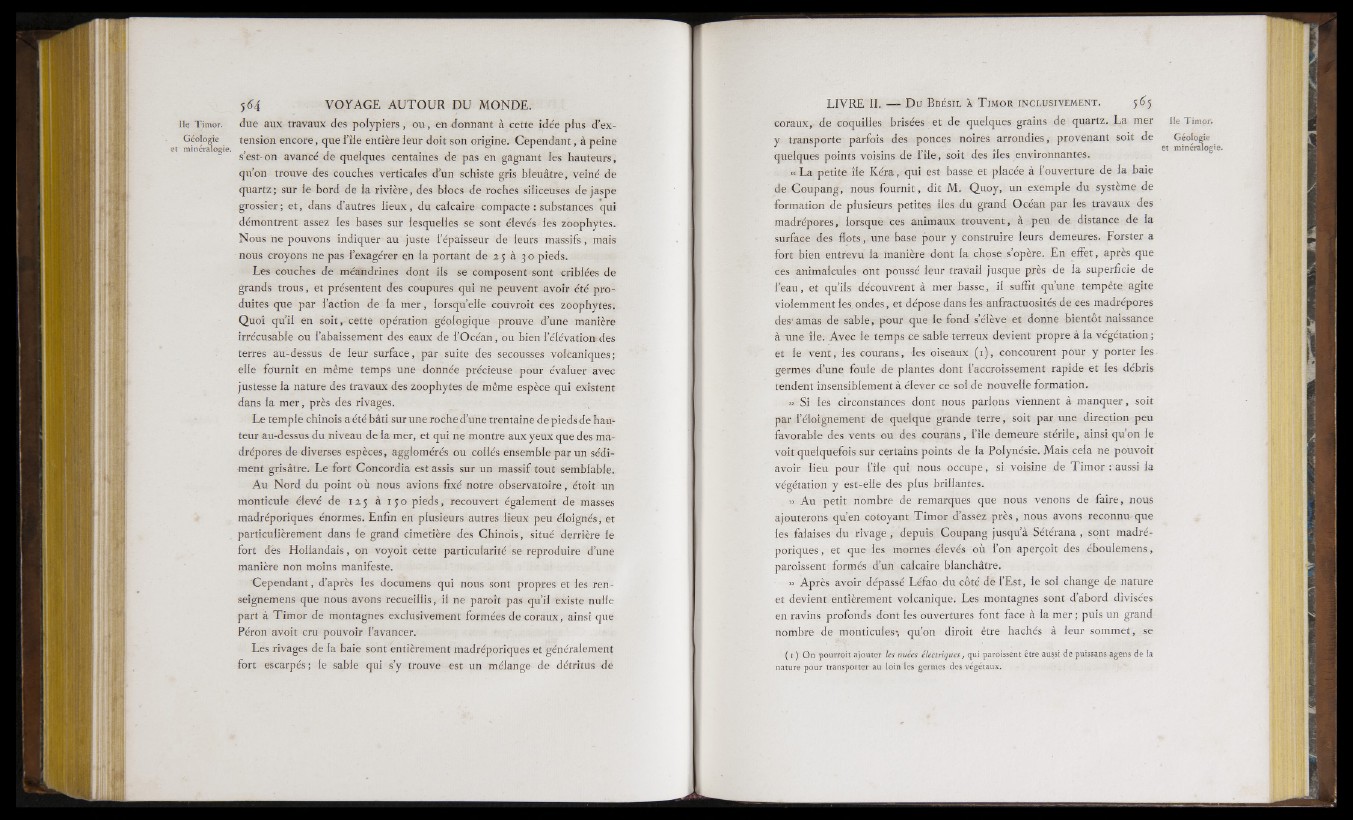
lie Timor. due aux travaux des polypiers, ou, en donnant à cette idée plus d’ex-
Géologie tension encore, que l’île entière leur doit son origine. Cependant, à peine
et minéralogie. , / r
s est-on avancé de quelques centaines de pas en gagnant les hauteurs,
qu’on trouve des couches verticales d’un schiste gris bleuâtre, veiné de
quartz; sur le bord de la rivière, des blocs de roches siliceuses de jaspe
grossier; et, dans d’autres lieux, du calcaire compacte : substances qui
démontrent assez les bases sur lesquelles se sont élevés les zoophytes.
Nous ne pouvons indiquer au juste l’épaisseur de leurs massifs, mais
nous croyons ne pas l’exagérer en la portant de 25 à 30 pieds.
Les couches de méandrines dont ils se composent sont criblées de
grands trous, et présentent des coupures qui ne peuvent avoir été produites
que par l’action de la mer, lorsqu’elle couvrait ces zoophytes.
Quoi qu’il en soit, cette opération géologique prouve d’une manière
irrécusable ou l’abaissement des eaux de l’Océan, ou bien l’élévation des
terres au-dessus de leur surface, par suite des secousses volcaniques ;
elle fournit en même temps une donnée précieuse pour évaluer avec
justesse la nature des travaux des zoophytes de même espèce qui existent
dans la mer, près des rivages.
Le temple chinois a été bâti sur une roche d’une trentaine de pieds de hauteur
au-dessus du niveau de la mer, et qui ne montre aux yeux que des madrépores
de diverses espèces, agglomérés ou collés ensemble par un sédiment
grisâtre. Le fort Concordia est assis sur un massif tout semblable.
Au Nord du point où nous avions fixé notre observatoire, étoit un
monticule élevé de 12 5 à 1 5 o pieds, recouvert également de masses
madréporiques énormes. Enfin en plusieurs autres lieux peu éloignés, et
particulièrement dans le grand cimetière des Chinois, situé derrière le
fort dés Hollandais, on voyoit cette particularité se reproduire d’une
manière non moins manifeste.
Cependant, d’après les documens qui nous sont propres et les ren -
seignemens que nous avons recueillis, il ne paroît pas qu’il existe nulle
part à Timor de montagnes exclusivement formées de coraux, ainsi que
Péron avoit cru pouvoir l’avancer.
Les rivages de la baie sont entièrement madréporiques et généralement
fort escarpés ; le sable qui s’y trouve est un mélange de détritus de
LIVRE II. — Du B b é s i l a T im o r in c l u s iv e m e n t . 565
coraux, de coquilles brisées et de quelques grains de quartz. La mer
y transporte parfois des ponces noires arrondies, provenant soit de
quelques points voisins de l’île , soit des îles environnantes.
« La petite île Kéra, qui est basse et placée à l’ouverture de la baie
de Coupang, nous fournit , dit M. Quoy, un exemple du système de
formation de plusieurs petites îles du grand Océan par les travaux des
madrépores, lorsque ces animaux trouvent, à peu de distance de la
surface des flots, une base pour y construire leurs demeures. Forster a
fort bien entrevu la manière dont la chose s’opère. En effet, après que
ces animalcules ont poussé leur travail jusque près de la superficie de
l’eau, et qu’ils découvrent à mer basse, il suffit qu’une tempête agite
violemment les, ondes, et dépose dans les anfractuosités de ces madrépores
des1 amas de sable, pour que le fond s’élève et donne bientôt naissance
à une île. Avec le temps ce sable terreux devient propre à la végétation ;
et le vent, les, courans, les oiseaux (1), concourent pour y porter les
germes d’une foule de plantes dont l’accroissement rapide et les débris
tendent insensiblement à élever ce sol de nouvelle formation.
» Si les circonstances dont nous parlons viennent à manquer, soit
par ¡’éloignement de quelque grande terre, soit par une direction peu
favorable des vents ou des courans, l’île demeure stérile, ainsi qu’on le
voit quelquefois sur certains points de la Polynésie. Mais cela ne pouvoit
avoir lieu pour l’île qui nous occupe, si voisine de Timor ¡ aussi la
végétation y est-elle des plus brillantes.
» Au petit nombre de remarques que nous venons de faire, nous
ajouterons qu’en cotoyant Timor d’assez près, nous avons reconnu que
les falaises du rivage , depuis Coupang jusqu’à Sétérana , sont madréporiques
, et que les mornes élevés où l’on aperçoit des éboulemens,
paraissent formés d’un calcaire blanchâtre.
» Après avoir dépassé Léfao du côté de l’Est, le sol change de nature
et devient entièrement volcanique. Les montagnes sont d’abord divisées
en ravins profonds dont les ouvertures font face à la mer ; puis un grand
nombre de monticules-, qu’on dirait être hachés à leur sommet, se
( i ) On pourroit ajouter les nuées électriques, qui paroissent être aussi de puissans agens de la
nature pour transporter au loin les germes des végétaux.
Géologie
; minéralogie.