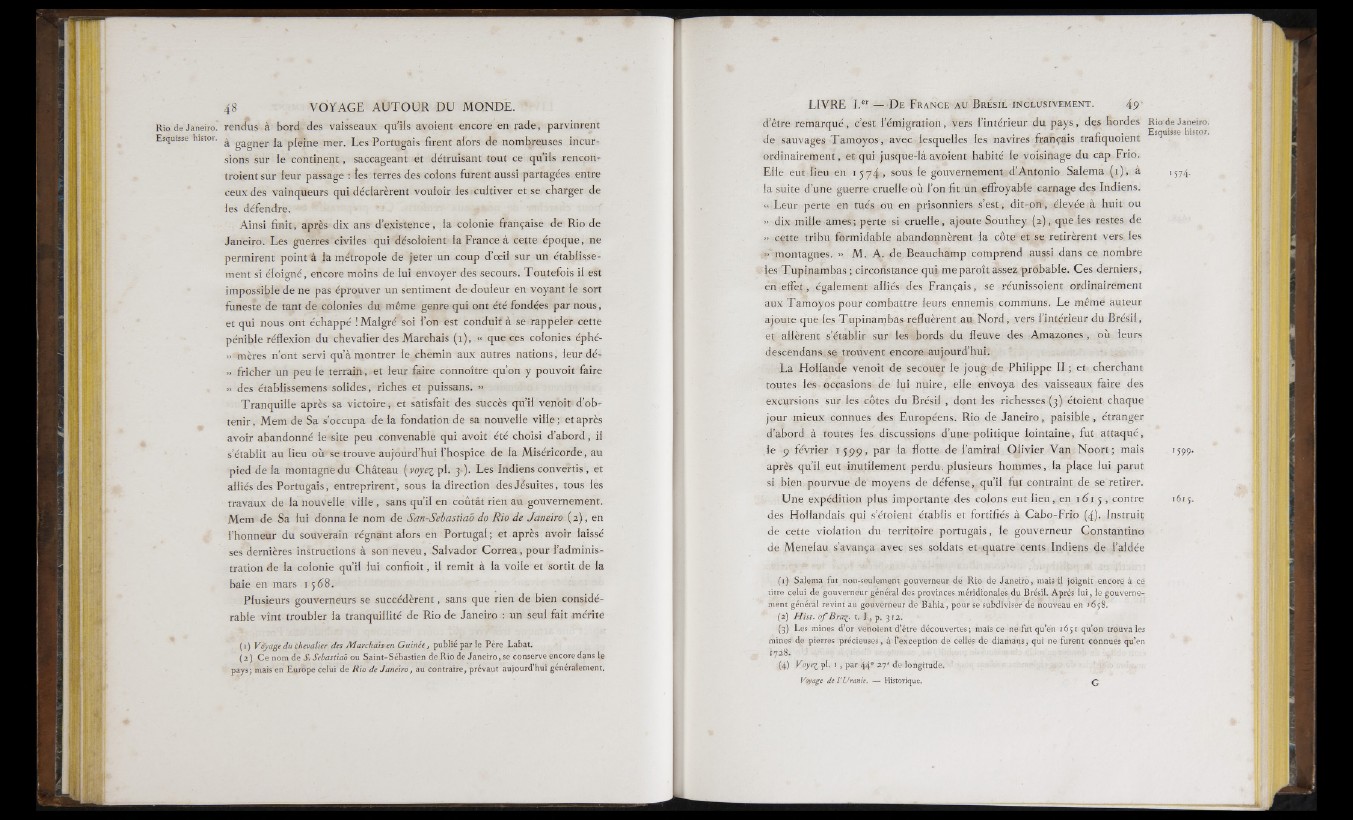
rendus à bord des vaisseaux qu’ils avoient encore en rade, parvinrent
à gagner la pleine mer. Les Portugais firent alors de nombreuses incursions
sur ie continent, saccageant et détruisant tout ce qu’ils rencon-
troient sur leur passage : îes terres des colons furent aussi partagées entre
ceux des vainqueurs qui déclarèrent vouloir les ! cultiver et se charger de
les défendre.
Ainsi finit, après dix ans d’existence, la colonie française de Rio de
Janeiro. Les guerres civiles qui désoloient la France à cette époque, ne
permirent point à la métropole de jeter un coup d’oeil sur un établissement
si éloigné, encore moins de lui envoyer des secours. Toutefois il est
impossible de ne pas éprouver un sentiment de douleur en voyant le sort
funeste de tant de colonies du même genre qui ont été fondées par nous,
et qui nous ont échappé ! Malgré soi l’on est conduit à se rappeler cette
pénible réflexion du chevalier des Marchais (i), « que ces colonies éphé-
« mères n’ont servi qu’à montrer le chemin aux autres nations, leur dé-
» fricher un peu le terrain, et leur faire connoître qu’on y pouvoit faire
» des établissemens solides, riches et puissans. »
Tranquille après sa victoire, et satisfait des succès qu’il venoit d’obtenir,
Mem de Sa s’occupa de la fondatiôn de sa nouvelle ville; et après
avoir abandonné le site peu convenable qui avoit été choisi d’abord, il
s’établit au lieu où se trouve aujourd’hui l’hospice de la Miséricorde, au
pied delà montagne du Château ( voyez pl. 3-). Les Indiens convertis, et
alliés des Portugais, entreprirent, sous la direction des Jésuites, tous les
travaux de la nouvelle v ille, sans qu’il en coûtât rien au gouvernement.
Mem de Sa lui donna le nom de San-Sebastiaô do Rio de Janeiro (2), en
l’honneur du souverain régnant alors en Portugal ; et après avoir laissé
ses dernières instructions à son neveu, Salvador Correa, pour l’administration
de la colonie qu’il lui confioit, il remit à la voile et sortit de la
baie en mars 1568.
Plusieurs gouverneurs se succédèrent, sans que rien de bien considérable
vînt troubler la tranquillité de Rio de Janeiro : un seul fait mérite
(1) Vâyage du chevalier des Marchai?en Guinee, publie par le Père Labat.
(2) Ce nom de S. Sehastiao ou Saint-Sébastien de Rio de Janeiro, se conserve encore dans le
pays; mais en Europe celui de Rio de Janeiro, au contraire, prévaut aujourd’hui généralement.
LIVRE I.er — D e F r a n c e a u B r é s i l in c lu s i v e m e n t . 4p '
d’être remarqué, c’est l’émigration, vers l’intérieur du pays, des hordes
de sauvages Tamoyos, avec lesquelles les navires français trafiquoient
ordinairement, et qui jusque-là avoient habité le voisinage du cap Frio.
Elle eut lieu en 1 5 74 , sous le gouvernement d’Antonio Salema (1), à
la suite d’une guerre cruelle où l’on fit un effroyable carnage des Indiens.
« Leur perte en tués ou en prisonniers s’est, dit-on, élevée à huit ou
» dix mille ames; perte si cruelle , ajoute Southey (2), que les restes de
t> cette tribu formidable abandonnèrent la côte et se retirèrent vers les
« montagnes. » M. A. de Beauchamp comprend aussi dans ce nombre
les Tupinambas ; circonstance qui me paroît assez probable. Ces derniers,
en effet, , également alliés des Français, se réunissoient ordinairement
aux Tamoyos pour combattre leurs ennemis communs. Le même auteur
ajoute que les Tupinambas refluèrent au Nord, vers l’intérieur du Brésil,
et allèrent s’établir sur les bords du fleuve des Amazones , où leurs
descendans.se trouvent encore aujourd’hui.
La Hollande venoit de secouer le joug de Philippe II ; et cherchant
toutes les occasions de lui nuire, elle envoya des vaisseaux faire des
excursions sur les côtes du Brésil , dont les richesses (3) étoient chaque
jour mieux connues des Européens. Rio de Janeiro, paisible, étranger
d’abord à toutes les discussions d’une-politique lointaine, fut attaqué,
le p février 15 p p , par la flotte de l’amiral Olivier Van Noort; mais
après qu’il eut inutilement perdu, plusieurs hommes, la place lui parut
si bien pourvue de moyens de défense, qu’il fut contraint de se retirer.
Une expédition plus importante des colons eut lieu, en 16 1 y, contre
des Hollandais qui s’étoient établis et fortifiés à Cabo-Frio (4). Instruit
de cette violation du territoire portugais, le gouverneur Constantino
de Menelau s’avança avec ses soldats et quatre cents Indiens de l’aidée
(1) Salema fut non-seulement gouverneur de Rio de Janeiro > mais il joignit encore à ce
titre celui de gouverneur général des provinces méridionales du Brésil. Après lui, le gouvernement
général revint au gouvernèur de Bahia, pour se subdiviser de' nouveau en 1658.
(2) Mist. o f Braç. t. I , p. 312.
(3) Les mines d’or verioient d’être découvertes; mais ce ne fut qu’en 1651 qu’on trouva les
mines de pierres précieuses , à l’exception de celles de diamans, qui ne furent connues qu’en
1728.
(4) p ï* 1 j Par 44° 2 7 ' d e lo n g i t u d e .
Voyage de l’Uranie. — Historique. r
Rio de Janeiro.
Esquisse histor.
1 574-
1 599-