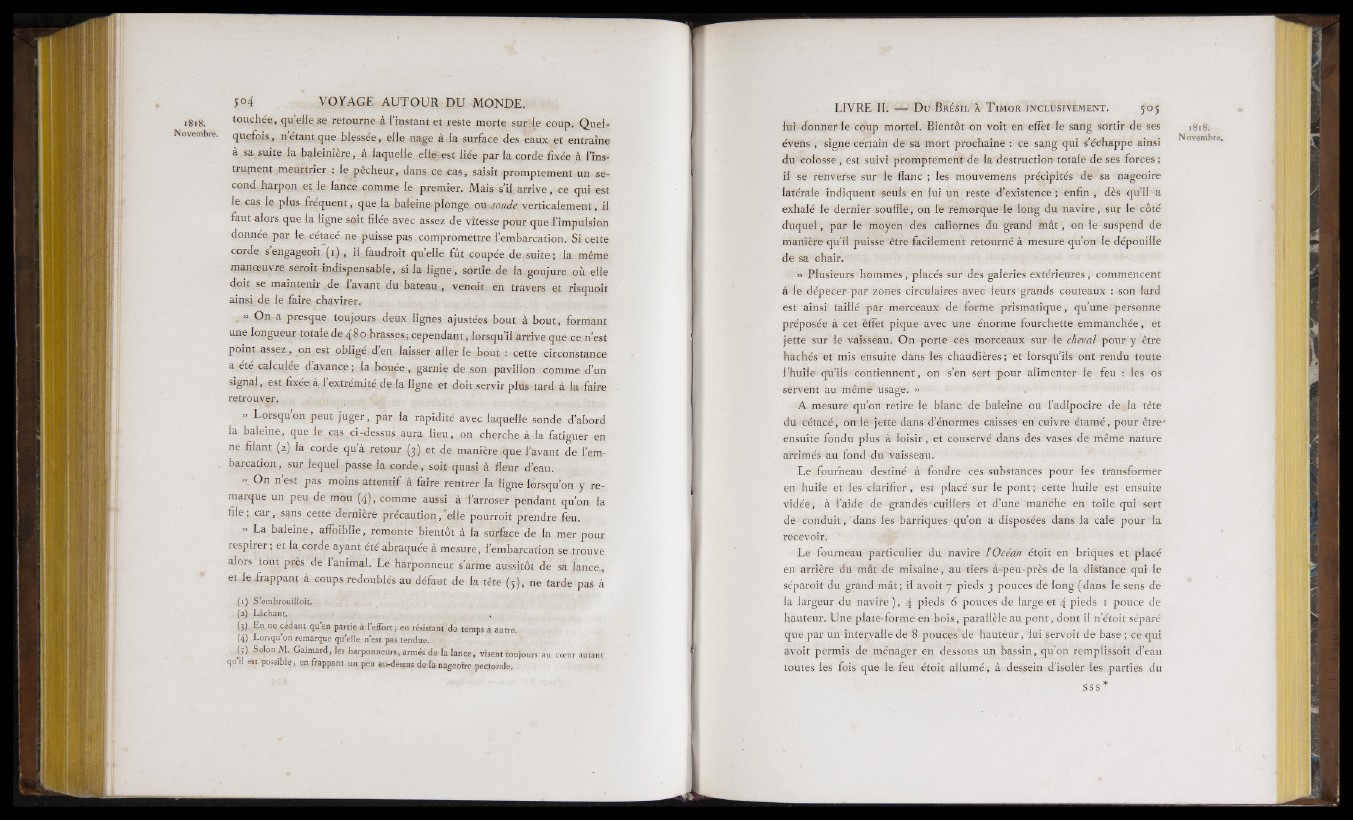
touchée, quelle se retourne à l’instant et reste morte sur le coup. Quelquefois,
n étant que blessée, elle nage à la surface des eaux, et entraîne
a sa suite la biffeiniere, a laquelle elle est liée par la corde fixée à l’instrument
meurtrier : le pecheur, dans ce cas, saisit promptement un second
harpon et le lance comme le premier. Mais s’il arrive, ce qui est
le cas le plus fréquent, que la baleine plonge ou sonde verticalement, il
faut alors que la ligne soit filée avec assez de vitesse pour que l’impulsion
donnée par le. cétacé ne puisse pas compromettre l’embarcation. Si cette
corde sengageoit (1) , il faudroit qu’elle fût coupée de,suite; la même
manoeuvre seroit indispensable, si la ligne, sortie de la goujure où elle
doit se maintenir de lavant du bateau , venoit en travers et risquoit
ainsi de le faire chavirer,
g » On a presque toujours deux lignes ajustées bout à bout, formant
une longueur totale de 480 brasses,; cependant , lorsqu’il arrive que ce n’est
point assez , on est oblige d en laisser aller le bout : cette circonstance
a été calculée d avance ; la bouée, garnie de son pavillon comme d’un
signal, est fixee a 1 extremite de la ligne et doit servir plus tard à la faire
retrouver.
Lorsqu on peut juger, par la rapidité avec laquelle sonde d’abord
la baleine, que le cas ci-dessus aura lieu, on cherche à la fatiguer en
ne filant (2) la corde quà retour (3) et de manière que l’avant de l’embarcation,
sur lequel passe la corde, soit quasi à fleur d’eau.
H On n est pas moins attentif à faire rentrer la ligne lorsqu’on y remarque
un peu de mou (4), comme aussi à l’arroser pendant qu’on la
file, car, sans cette dernière précaution, elle pourrait prendre feu.
» La baleine, affoiblie, remonte bientôt à la surface de la mer pour
respirer; et la corde ayant étéabraquée à mesure, l’embarcation se trouve
alors tout près de 1 animal. Le harponneur s’arme aussitôt de sa lance.,
et le frappant à coups redoublés au défaut de la tête (5), ne tarde pas à
(1) S ’embrouilloit.
(2) Lâchant. ,
(3) 5 n ne cédant quen partie à lefFort; en résistant de temps à autre.
(4) Lorsqu’on remarque qu’elle n’est pas tendue.
(5) SeIon M- Gaimard, les harponneùrs, armés de la lance, visent toujours au coeur autant
qu il est possible, en frappant un peu au-dessus de la nageoire pectorale.
LIVRE II. — Du B r é s i l ’ À T im o r in c l u s iv e m e n t . 5 0 5
lui donner le coup mortel. Bientôt on voit en effet le sang sortir de ses 1818.
évens , signe certain de sa mort prochaine : ce sang qui s’échappe ainsi Novem!:
du colosse, est suivi promptement de la destruction totale de ses forces ;
il se renverse sur le flanc ; les mouvemens précipités de sa nageoire
latérale indiquent seuls en lui un reste d’existence ; enfin , dès qu’il a
exhalé le dernier souffle, on le remorque le long du navire, sur le côté
duquel, par le moyen des caliornes du grand mât , on le suspend de
manière qu’il puisse être facilement retourné à mesure qu’on le dépouille
de sa chair.
« Plusieurs hommes, placés sur des galeries extérieures, commencent
à le dépecer par zones circulaires avec leurs grands couteaux : son lard
est ainsi taillé par morceaux de forme prismatique, qu’une personne
préposée à cet ëffèt pique avec une énorme fourchette emmanchée, et
jette sur le vaisseau. On porte ces morceaux sur le cheval pour y être
hachés et mis ensuite dans les chaudières ; et lorsqu’ils ont rendu toute
l’huile qu’ils contiennent, on s’en sert pour alimenter le feu : les os
servent au même usage. » - ' ,
A mesure qu’on retire le blanc de baleine ou l’adipocire de - la tête
du cétacé, on le jette dans d’énormes caisses en cuivre étamé, pour êtrë'
ensuite fondu plus à loisir, et conservé dans des vases de même nature
arrimés au fond du vaisseau.
Le fourneau destiné à fondre ces substances pour les transformer
en huile et les clarifier, est placé sur le pont ; cette huile est ensuite
vidée, à l’aide de grandesJcuillers et d’une manche en toile qui sert
de conduit, dans les barriques qu’on a disposées dans la cale pour la
recevoir.
Le fourneau particulier du navire lOcéan étoit en briques et placé
en arrière du mât de misaine, au tiers à-peu-près de la distance qui le
séparait du grand mât; il avoit 7 pieds 3 pouces de long (dans le sens de
la largeur du navife ), 4 pieds 6 pouces de large et 4 pieds 1 pouce de
hauteur. Une plate-forme en bois, parallèle au pont, dont il n’étoit séparé
que par un intervalle de 8 pouces de hauteur, lui servoit de base ; ce qui
avoit permis de ménager en dessous un bassin , qu’on remplissoit d’eau
toutes les fois que le feu étoit allumé , à dessein d’isoler les parties du
s s s *