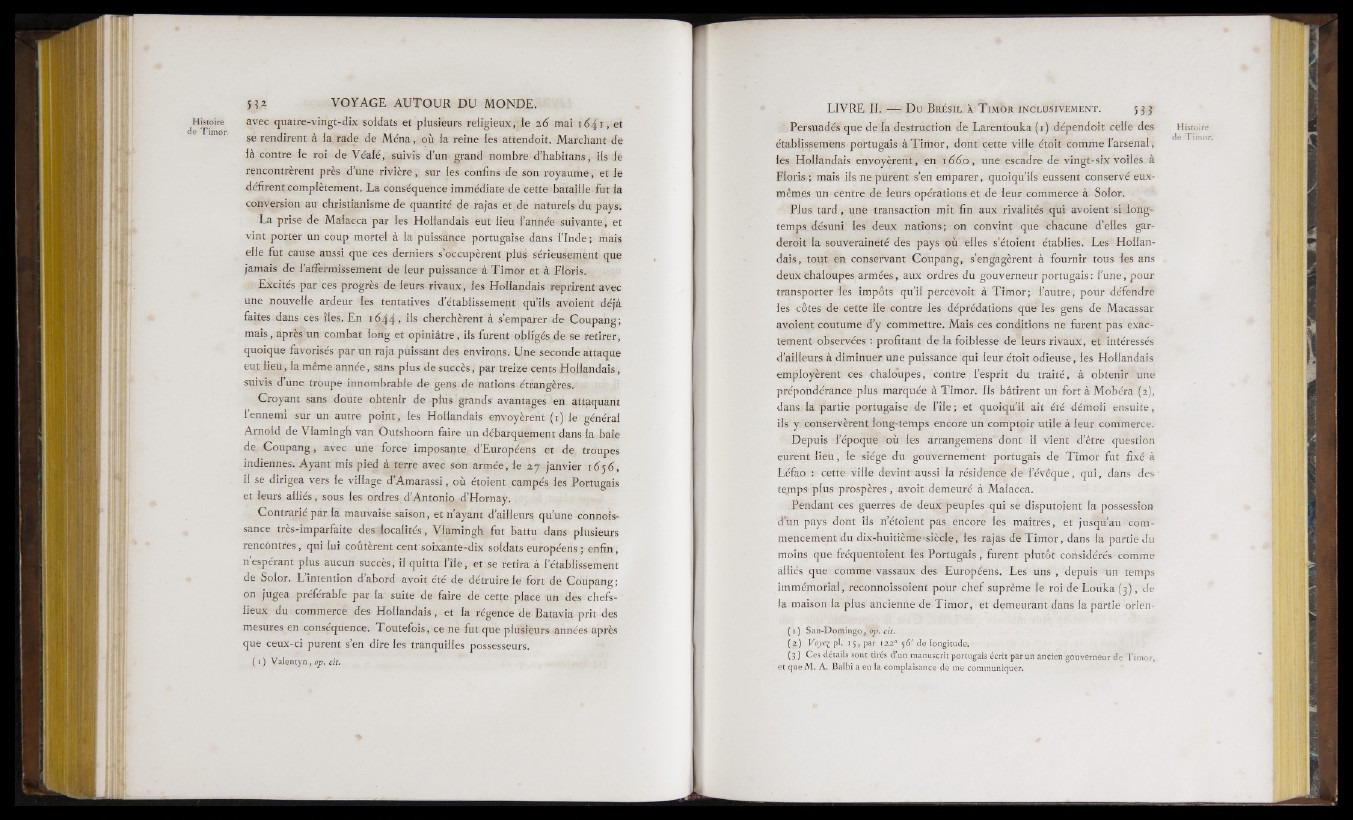
avec quatre-vingt-dix soldats et plusieurs religieux, le 2.6 mai 16 4 .1, et
sé rendirent à la rade de Mena, où la reine les attendoit. Marchant de
là contre le roi de Véalé, suivis d’un grand nombre d’habitans, ils le
rencontrèrent près d’une rivière, sur les confins de son royaume, et le
défirent complètement. La conséquence immédiate de cette bataille fut la
conversion au christianisme de quantité de rajas et de naturels du pays.
La prise de Malacca par les Hollandais eut lieu l’année suivante, et
vint porter un coup mortel à la puissance portugaise dans l’Inde ; mais
elle fut cause aussi que ces derniers s’occupèrent plus sérieusement que
jamais de l’affermissement de leur puissance à Timor et à Floris.
Excités par ces progrès de leurs rivaux, les Hollandais reprirent avec
une nouvelle ardeur les tentatives d’établissement qu’ils avoient déjà
faites dans ces îles. En 1644» Us cherchèrent à s’emparer de Coupang;
mais, après un combat long et opiniâtre, ils furent obligés de se retirer,
quoique favorisés par un raja puissant des environs. Une seconde attaque
eut lieu, la même année, sans plus de succès, par treize cents Hollandais,
suivis d une troupe innombrable de gens de nations étrangères.
Croyant sans doute obtenir de plus grands avantages en attaquant
l’ennemi sur un autre point, les Hollandais envoyèrent (1) le général
Arnold de Vlamingh van Outshoorn faire un débarquement dans la baie
de Coupang, avec une force imposante d’Européens et de troupes
indiennes. Ayant mis pied à terre avec son armée, le 27 janvier if>jé>,
il se dirigea vers le village d’Amarassi, où étoient campés les Portugais
et leurs alliés, sous les ordres d’Antonio d’Hornay.
Contrarié par la mauvaise saison, et n’ayant d’ailleurs qu’une connois-
sance très-imparfaite des localités, Vlamingh fut battu dans plusieurs
rencontres, qui lui coûtèrent cent soixante-dix soldats européens ; enfin,
n esperant plus aucun succès, il quitta 1 île , et se retira à l’établissement
de Solor. L’intention d’abord avoit été de détruire le fort de Coupang;
on jugea préférable par la suite de faire de cette place un des chefs-
üeux du commerce des Hollandais, et la régence de Batavia prit des
mesures en conséquence. Toutefois, ce ne fut que plusieurs années après
que ceux-ci purent s’en dire les tranquilles possesseurs.
( 1) Valentyn, op. cit.
Persuadés que de la destruction de Larentouka (1) dépendoit celle des
établissemens portugais à Timor, dont cette ville étoit comme l’arsenal,
les Hollandais envoyèrent, en 166.0, une escadre de vingt-six voiles à
Floris ; mais iis ne purent s’en emparer, quoiqu’ils eussent conservé eux-
même.s un centre de leurs opérations et de leur commerce à Solor.
Plus tard, une transaction mit fin aux rivalités qui avoient si longtemps
désuni les deux nations; on convint que chacune d’elles gar-
deroit la souveraineté des pays où elles s’étoient établies. Les Hollandais
, tout en conservant Coupang, s’engagèrent à fournir tous les ans
deux chaloupes armées, aux ordres du gouverneur portugais : l’une, pour
transporter les impôts qu’il percevoit à Timor; l’autre, pour défendre
les côtes de cette île contre les déprédations que les gens de Macassar
avoient coutume d’y commettre. Mais ces conditions ne furent pas exactement
observées : profitant de la foiblesse de leurs rivaux, et intéressés
d’ailleurs à diminuer une puissance qui leur étoit odieuse, les Hollandais
employèrent ces chaloupes, contre l’esprit du traité, à obtenir une
prépondérance plus marquée à Timor. Ils bâtirent un fort à Mobéra (2),
dans la partie portugaise de l’île ; et quoiqu’il ait été démoli ensuite,
ils y conservèrent long-temps encore un comptoir utile à leur commerce.
Depuis l’époque où les arrangemens dont il vient d’être question
eurent lieu, le siège du gouvernement portugais de Timor fut fixé à
Léfao :: cette ville devint aussi la résidence de l’évêque, qui, dans des
temps plus prospères, avoit demeuré à Malacca.
Pendant ces guerres de deux peuples qui se disputaient la possession
dun pays dont ils-n’étoient pas encore les maîtres, et jusqu’au commencement
du dix-huitième*siècle, les rajas de Timor, dans la partie du
moins que fréquentoient les Portugais, furent plutôt considérés comme
alliés que comme vassaux des Européens. Les uns , depuis un temps
immémorial, reconnoissoient pour chef suprême le roi de Louka (3), de
la maison la plus ancienne de Timor, et demeurant dans la partie orien-
( i ) San-Domingo, op. cit.
(2 ) Voyei pl. 15 , par 1220 56' de longitude.
(3 ) Ces détails sont tirés d?un manuscrit portugais écrit par un ancien gouverneur de Timor,
et que M. A. Balbi a eu îa complaisance de me communiquer.