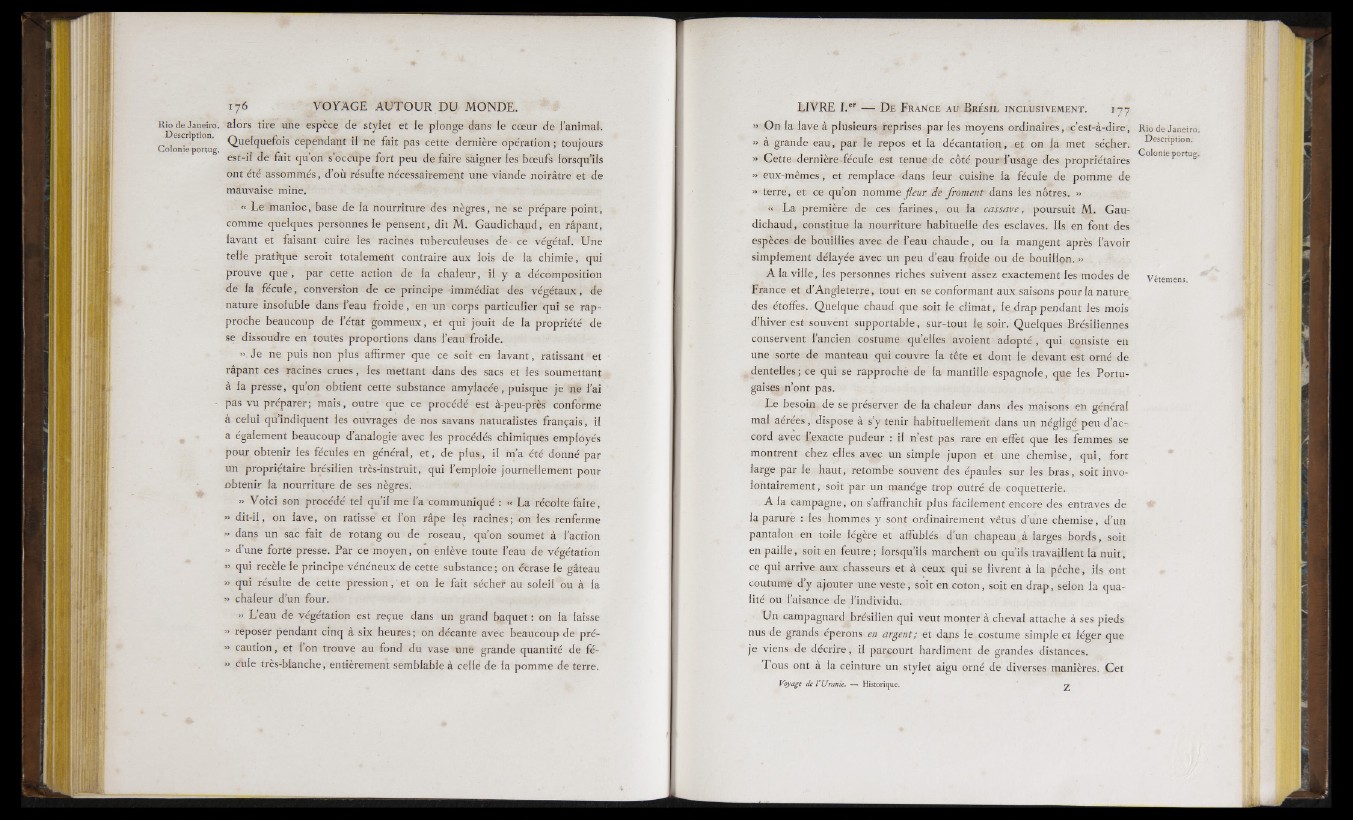
Colonie poitug.
alors tire une espèce de stylet et le plonge dans le coeur de l’animal.
Quelquefois cependant il ne fait pas cette dernière opération ; toujours
est-il de fait qu’on s’occupe fort peu de faire saigner les boeufs lorsqu'ils
ont été assommés, d’où résulte nécessairement une viande noirâtre et de
mauvaise mine.
« Le manioc, base de la nourriture des nègres, ne se prépare point,
comme quelques personnes le pensent, dit M. Gaudichaud, en râpant,
lavant et faisant cuire l’es racines tuberculeuses de ce végétal. Une
telle pratique seroit totalement contraire aux lois de la chimie, qui
prouve que, par cette action de la chaleur, il y a décomposition
de la fécule, conversion de ce principe immédiat des végétaux, de
nature insoluble dans l’eau froide, en un corps particulier qui se rapproche
beaucoup de l’état gommeux, et qui' jouit de la propriété de
se dissoudre en toutes proportions dans l’eau froide.
» Je ne puis non plus affirmer que ce soit en- lavant, ratissant et
râpant ces racines crues, les mettant dans des sacs et les soumettant
à la presse, qu’on obtient cette substance amylacée, puisque je ne l’ai
pas vu préparer; mais, outre que ce procédé est à-peu-près conforme
à celui qu’indiquent les ouvrages de nos savans naturalistes français, il
a également beaucoup d’analogie avec les procédés chimiques employés
pour obtenir les fécules en général, et, de plus, il m’a été donné par
un propriétaire brésilien très-instruit, qui l’emploie journellement pour
obtenir la nourriture de ses nègres.
» Voici son procédé tel qu’il me l’a communiqué : « La récolte faite,
>• dit-il, on lave, on ratissé et l’on râpe les racines; on les renferme
» dans un sac fait de rotang ou de roseau, qu’on soumet à l’action
» d’une forte presse. Par ce moyen, on ènlève toute l’eau de végétation
« qui recèle le principe vénéneux de cette substance ; on écrase le gâteau
» qui résulte de cette pression, et on le fait sécher au soleil ou à la
» chaleur d’un four.
» L ’eau de végétation est reçue dans un grand baquet : on la laisse
” reposer pendant cinq à six heures ; on décante avëc beaucoup de pré-
» caution, et l’on trouve au fond du vase une grande quantité de fé-
>> cuie tres-blanche, entièrement semblable à celle de la pomme de terre.
LIVRE I . cr — D e F r a n c e a u B r é s i l in c l u s iv e m e n t . 1 7 7
» On la lave à plusieurs reprises par les moyens ordinaires, c’est-à-dire, Rio de Janeiro.
» à grande eau, par le repos et la décantation, et on la met sécher. nptIon'
» Cette dernière fécule est tenue de côté pour l’usage des propriétaires eporug.
» eux-mêmes, et remplace dans leur cuisine la fécule de pomme de
>• terre, et ce qu’on nomme fleur de froment dans les nôtres. »
« La première de ces farines, ou la cassave, poursuit M. Gaudichaud,
constitue la nourriture habituelle des esclaves. Ils en font des
espèces de bouillies avec de l’eau chaude, ou la mangent après l’avoir
simplement délayée avec un peu d’eau froide ou de bouillon. »
A la ville, les personnes riches suivent assez exactement les modes de vêtemens
France et d’Angleterre, tout en se conformant aux saisons pour la nature
des étoffes. Quelque chaud que soit le climat, le drap pendant les mois
d’hiver est souvent supportable, sur-tout le soir. Quelques Brésiliennes
conservent 1 ancien costume qu’elles avoient adopté , qui consiste en
une sorte de manteau qui couvre la téte et dont le devant est orné de
dentelles ; ce qui se rapproche de la mantille espagnole, que les Portugaises
n’ont pas.
Le besoin de se préserver de la chaleur dans des maisons en général
mal aerees, dispose à s’y tenir habituellement dans un négligé peu d’accord
avec 1 exacte pudeur : il n’est pas rare en effet que les femmes se
montrent chez elles avec un simple jupon et une chemise, qui, fort
large par le haut, retombe souvent des épaules sur les bras, soit involontairement,
soit par un manège trop outré de coquetterie.
A la campagne, on s’affranchit plus facilement encore des entraves de
la parure : les hommes y sont ordinairement vêtus d’une chemise, d’un
pantalon en toile légère et affublés d’un chapeau à larges bords, soit
en paille, soit en feutre ; lorsqu’ils marchent ou qu’ils travaillent la nuit,
ce qui arrive aux chasseurs et à ceux qui se livrent à la pêche, ils ont
coutume d’y ajouter une veste, soit en coton, soit en drap, selon ja qualité
ou l’aisance de l’individu.
Un campagnard brésilien qui veut monter à cheval attache à ses pieds
nus de grands éperons en argent; et dans le costume simple et léger que
je viens de décrire, il parcourt hardiment de grandes distances.
Tous ont à la ceinture un stylet aigu orné de diverses manières. Cet
Voyage de l’Uranie. — Historique. 7