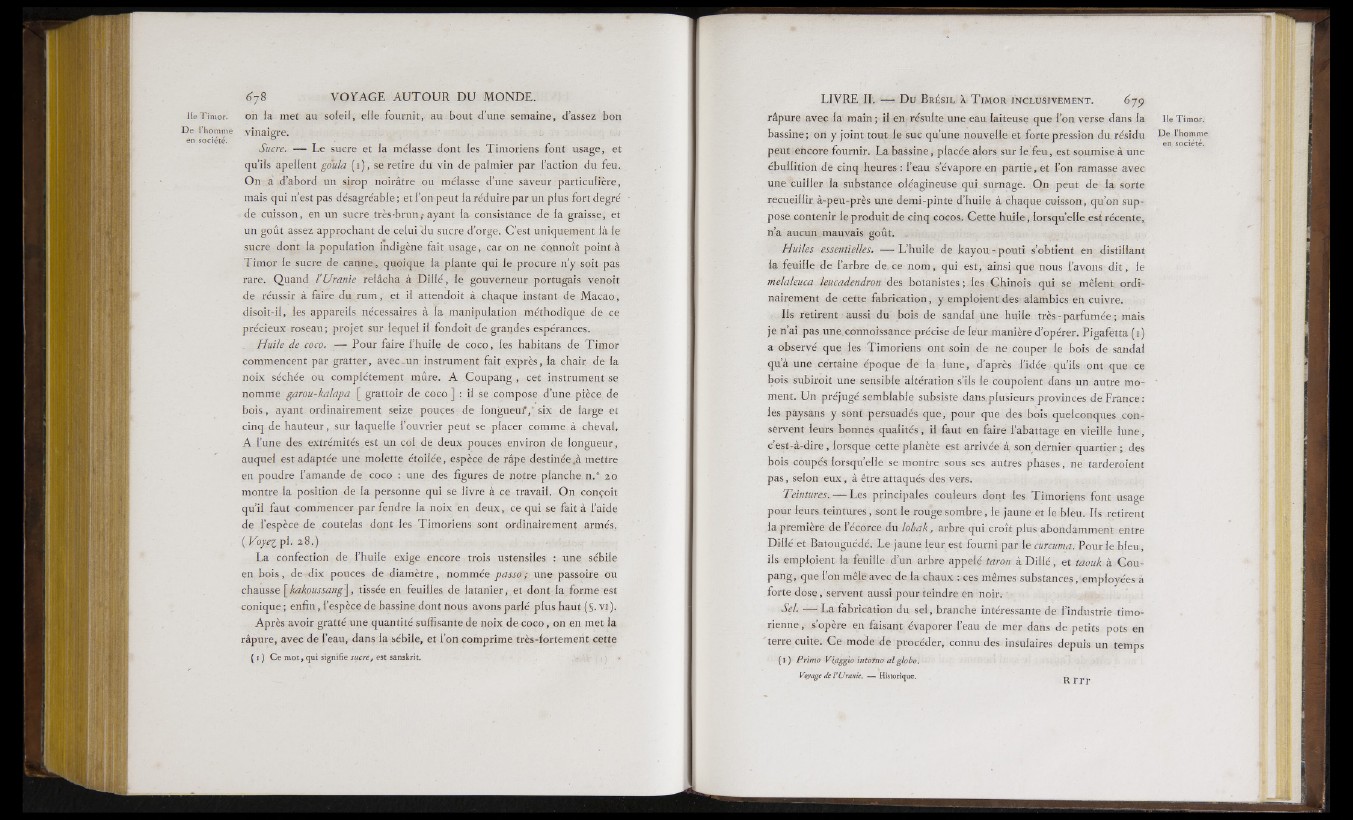
De l’homme
en société.
on la. met au soleil, elle fournit, au bout d’une semaine, d’assez bon
vinaigOre.
Sucre. — Le sucre et la mélasse dont les Timoriens font usage, et
qu’ils apellent gaula (i), se retire du vin de palmier par l’action du feu.
On a d’abord un sirop noirâtre ou mélasse d’une saveur particulière,
mais qui n’est pas désagréable ; et l’on peut la réduire par un plus fort degré
de cuisson, en un sucre très-brun,-ayant la consistance de la graisse, et
un goût assez approchant de celui du sucre d’orge. C’est uniquement ici le
sucre dont la population indigène fait usage, car on ne cqnnoît pointa
Timor le sucre de canne, quoique la plante qui le procure n’y soit pas
rare. Quand l’Uranie relâcha à Dillé, le gouverneur portugais venoit
de réussir à faire du rum, et il attendoit à chaque instant de Macao,
disoit-il, les appareils nécessaires à la manipulation méthodique de ce
précieux roseau; projet sur lequel il fondoit de grandes espérances.
Huile de coco. — Pour faire l’huile de coco, les habitans de Timor
commencent par gratter, avec-un instrument fait exprès, la chair de la
noix séchée ou complètement mûre. A Coupang , cet instrument se
nomme garou-kalapa [ grattoir de coco ] : il se compose d’une pièce de
bois, ayant ordinairement seize pouces- de longueuf,' six de large et
cinq de hauteur, sur laquelle l’ouvrier peut se placer comme à cheval.
A l’une des extrémités est un col de deux pouces environ de longueur,
auquel est adaptée une molette étoilée, espèce de râpe destinée ,à mettre
en poudre l’amande de coco : une des figures de notre planche, n.° 20
montre la position de la personne qui se livre à ce travail. On conçoit
qu’il faut commencer par fendre la noix en deux, ce qui se fait à l’aide
de l’espèce de coutelas dont les Timoriens sont ordinairement armés,
( Voyez pl. 28,)
La confection de l’huile exige encore trois ustensiles : une sébile
en bois, de dix pouces de diamètre, nommée passo ; une passoire ou
chausse \_kakoussang\ , tissée en feuilles de latanier, et dont la forme est
conique ; enfin, l’espèce de bassine dont nous avons parlé plus haut (§. vi).
Après avoir gratté une quantité suffisante de noix de coco, on en met la
râpure, avec de l’eau, dans la sébile, et l’on comprime très-fortement cette
( i ) Ce mot, qui signifie sucre, est sanskrit.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 679
râpure avec la main ; il en résulte une eau laiteuse que l’on verse dans la
bassine; ori y joint tout le suc qu’une nouvelle et forte pression du résidu
peut encore fournir. La bassine, placée alors sur le feu, est soumise à une
ébullition de cinq heures : l’eau s’évapore en partie, et l’on ramasse avec
une cuiller la substance oléagineuse qui surnage. On peut de la sorte
recueillir à-peu-près une demi-pinte d’huile à chaque cuisson, qu’on suppose,
contenir le produit de cinq cocos. Cette huile, lorsqu’elle est récente,
n’a aucun mauvais goût. ,
Huiles essentielles. — L’huile de kayou-pouti s’obtient en distillant
la feuille de l’arbre de ce nom, qui est, ainsi que nous l’avons dit, le
mêlaieuca leucadendron des botanistes ; les, Chinois qui se mêlent ordinairement
de cette fabrication, y emploient des alambics en cuivre.
Us retirent aussi du bois de sandal une huile très-parfumée ; mais
je n’ai pas une, connaissance précise de leur manière d’opérer. Pigafetta (1)
a observé que les Timoriens ont soin de ne couper le bois de sandal
qu’à une certaine époque de la lune, d’après l’idée qu’ils ont que ce
bois subiroit une sensible altération s’ils le coupoient dans un autre moment.
Un préjugé semblable subsiste dans plusieurs provinces de France:
les paysans y sont persuadés que, pour que des bois quelconques con-
sërvent leurs bonnes qualités, il faut en faire l’abattage en vieille lune,
c’est-à-dire, lorsque cette planète est arrivée à son dernier quartier ; des
bois coupés lorsqu’elle se montre sous ses autres phases, ne tarderoient
pas, selon eux, à être attaqués des vers.
Teintures.— Les principales couleurs dont les Timoriens font usage
pour leurs teintures, sont le rouge sombre, le jaune et le bleu. Us retirent
la première de 1 ecorce du lobak , arbre qui croît plus abondamment entre
Dillé et Batouguédé. Le jaune leur est fourni par le curcuma. Pour le bleu,
ils emploient la feuille d’un arbre appelé taron à Dillé, et taouk à Coupang,
que l’on mêle avec de la chaux : ces mêmes substances, employées à
forte dose > servent aussi pour teindre en noir.
Sel. —: La fabrication du sel, branche intéressante de l’industrie timo-
rienne, s’opère en faisant évaporer l’eau de mer dans de petits pots en
terre cuite. Ce mode de procéder, connu des insulaires depuis un temps
( 1) Primo Viaggio intofno al globo.
De l’homme
en société.