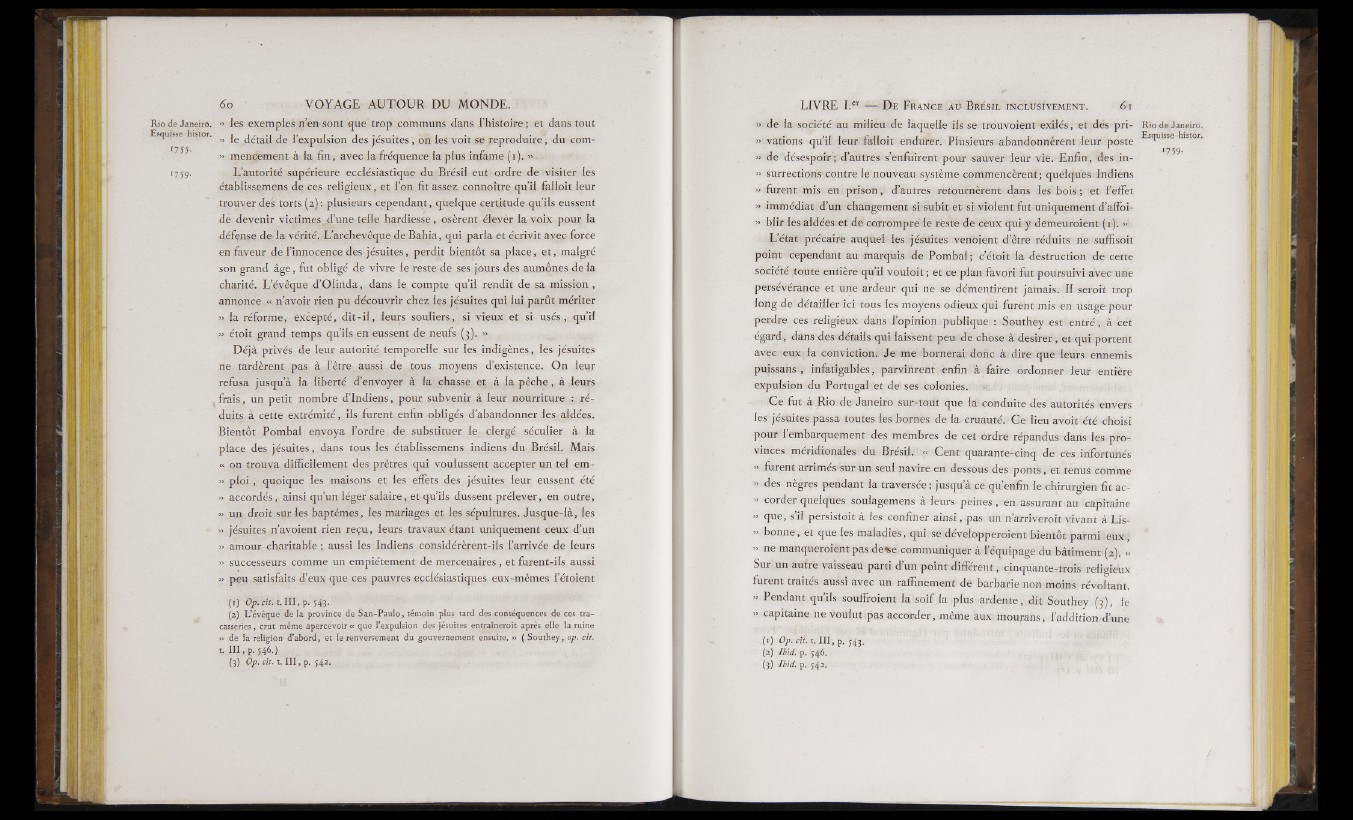
Rio de Janeiro.
Esquisse histor.
*7Î 5‘
17 59*
» les exemples n’en sont que trop communs dans l’histoire ; et dans tout
» le détail de l’expulsion des jésuites, on les voit se reproduire, du com-
» mencement à la fin, avec la fréquence la plus infâme (i). »
L ’autorité supérieure ecclésiastique du Brésil eut ordre de visiter les
établissemens de ces religieux, et l’on fit assez connoître qu’il falloit leur
trouver des torts (2) : plusieurs cependant, quelque certitude qu’ils eussent
de devenir victimes d’une telle hardiesse, osèrent éievèr la voix pour la
défense de la vérité. L’archevêque de Bahia, qui parla et écrivit avec force
en faveur de l’innocence des jésuites, perdit bientôt sa place, et, malgré
son grand âge, fut obligé de vivre le reste de ses jours des aumônes de ia
charité. L ’évêque d’Olinda, dans le compte qu’il rendit de sa mission ,
annonce n’avoir rien pu découvrir chez les jésuites qui lui parût mériter
» la réforme, excepté, dit-il, leurs souliers, si vieux et si usés, qu’il
» étoit grand temps qu’ils en eussent de neufs (3). »
Déjà privés de leur autorité temporelle sur les indigènes, les jésuites
ne tardèrent pas à l’être aussi de tous moyens d’existence. On leur
refusa jusqu’à ia liberté d’envoyer à la chasse et à la pêche, à leurs
frais, un petit nombre d’indiens, pour subvenir à leur nourriture : réduits
à cette extrémité, ils furent enfin obligés d’abandonner les aidées.
Bientôt Pombal envoya l’ordre de substituer le clergé séculier à la
place des jésuites, dans tous les établissemens indiens du Brésil. Mais
« on trouva difficilement des prêtres qui voulussent accepter un tel em-
» ploi , quoique les maisons et les effets des jésuites leur eussent été
» accordés, ainsi qu’un léger salaire, et qu’ils dussent prélever, en outre,
» un droit sur les baptêmes, les mariages et les sépultures. Jusque-là, les
» jésuites n’avoient rien reçu, leurs travaux étant uniquement ceux d’un
» amour charitable ; aussi les Indiens considérèrent-ils l’arrivée de leurs
» successeurs comme un empiétement de mercenaires, et furent-ils aussi
» peu satisfaits d’eux que ces pauvres ecclésiastiques eux-mêmes l’étoient
(1) Op. cit. t. I I I , p. 543-
(2) L’évêque de la province de San-Paulo, témoin plus tard des conséquences de ces tracasseries
, crut même apercevoir « que l’expulsion des jésuites entraînerait après elle la ruine
» de la religion d’abord, et le renversement du gouvernement ensuite. » ( Southey, op. cit.
t. I I I , p. 546.)
(3) Op. cit. t. I I I , p. y42*
LIVRE I.eï — De F r a n c e a u B r é s i l in c lu s i v e m e n t . 6 1
» de la société au milieu de laquelle ils se trouvoient exilés, et des pri- Rio de Janeiro.
» vations qu’il leur falloit endurer. Plusieurs abandonnèrent leur poste s<Iuisse istor-
» dT e désespoir; d>’ aIu tres sy’ enfru -i• rent pour sauver leur vie. Enfin, des in- *7 59*
» surrections contre le nouveau système commencèrent ; quelques Indiens
» furent mis en prison, d’autres retournèrent dans les bois ; et l’effet
» immédiat d’un changement si subit et si violent fut uniquement d’affoi-
» blir les aidées et de corrompre le reste de ceux qui y demeuroient (1). »
L’état précaire auquel les jésuites venoient d’être réduits ne suffisoit
point cependant au marquis de Pombal; c’étoit la destruction de cette
société toute entière qu’il vouloit ; et ce plan favori fut poursuivi avec une
persévérance et une ardeur qui ne se démentirent jamais. Il seroit trop
long de détailler ici tous les moyens odieux qui furent mis en usage pour
perdre ces religieux dans l’opinion publique : Southey est entré, à cet
égard, dans des détails qui laissent peu de chose à desirer , et qui portent
avec eux ia conviction. Je me bornerai donc à dire que leurs ennemis
puissansi, infatigables, parvinrent enfin à faire ordonner leur entière
expulsion du Portugal et de’ ses colonies. M|
Ce fut à Rio de Janeiro sur-tout que la conduite des autorités envers
les jésuites passa toutes les bornes de la cruauté. Ce lieu avoit été choisi
pour l’embarquement des membres de cet ordre répandus; dans les; provinces
méridionales du Brésil. « Cent quarante-cinq de ces infortunés
» furent arrimés sur un seul navire en dessous des ponts, et tenus comme
». des nègres pendant la traversée; jusqu’à ce qu’enfin le chirurgien fit ac-
» corder quelques soulagemens à leurs peines , en assurant au capitaine
« que, s’il persistoit à les confiner ainsi, pas un n’arriveroit vivant à Lis-
» bonne, et que les maladies, qui se développeraient bientôt parmi eux,
» ne manqueraient pas de«e communiquer à l’équipage du bâtiment (2). »
Sur un autre vaisseau parti d’un point différent, cinquante-trois religieux
furent traités aussi avec un raffinement de barbarie non moins révoltant.
» Pendant qu’ils souffraient la soif la plus ardente, dit Southey (3), le
» capitaine ne voulut pas accorder, même aux mourans, l’addition d’une
(1) Op. cit. t. I I I , p. 543.
(2) Ibid. p. 546.
(3) Ibid. p. 542.