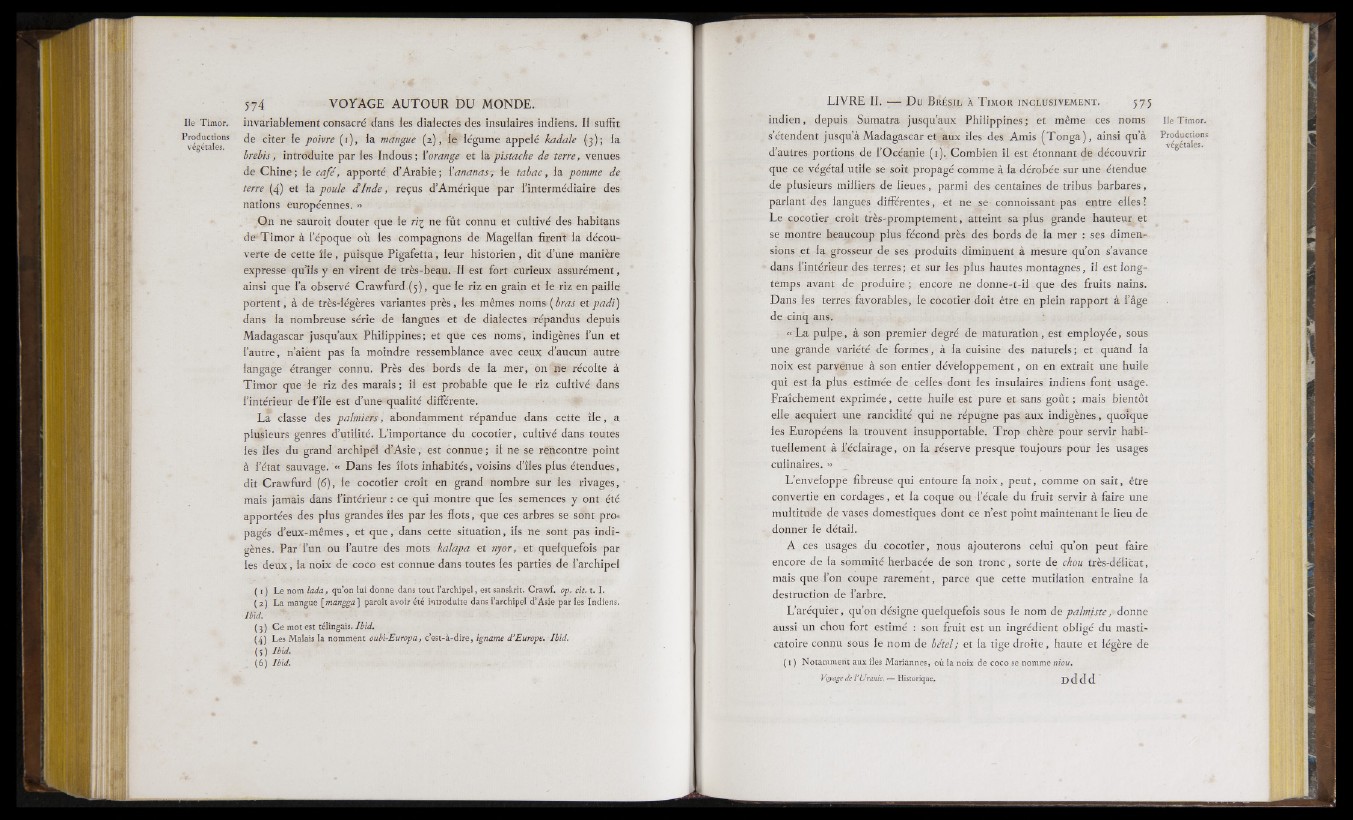
Productions
végétales.
invariablement consacré dans les dialectes des insulaires indiens. Il suffit
de citer le poivre (i), la mangue (a), le légume appelé kadale (.3); la
brebis, introduite par les Indous; l’orange et la pistache de terre, venues
de Chine ; le café, apporté d’Arabie ; l’ananas-, le tabac, la pomme de
terre (4 ) et la poule din de, reçus d’Amérique par l’intermédiaire des
nations européennes. »
On ne saurait douter que le riz ne fût connu et cultivé des habitans
de- Timor à l’époque où les compagnons de Magellan firent la découverte
de cette île , puisque Pigafetta, leur historien, dit d’une manière
expresse qu’ils y en virent de très-beau. Il est fort cürieux assurément,
ainsi que l’a observé Crawfurd.(5), que le riz en grain et le riz en paille
portent, à de très-légères variantes près, les mêmes noms (bras etpadi)
dans la nombreuse série de langues et de dialectes répandus depuis
Madagascar jusqu’aux Philippines; et que ces noms, indigènes l’un et
l’autre, n’aiènt pas la moindre ressemblance avec ceux d’aucun autre
langage étranger connu. Près des bords de la mer, on ne récolte à
Timor que le riz des marais ; il est probable que le riz cultivé dans
l’intérieur de l’île est d’une qualité différente.
La classe des palmiers, abondamment répandue dans cette île , a
plusieurs genres d’utilité. L ’importance du cocotier, cultivé dans toutes
les îles du grand archipel d’A sie, est connue ; il ne se rencontre point
à l’état sauvage. « Dans les îlots inhabités, voisins d’îles plus étendues,
dit Crawfurd (6), le cocotier croît en grand nombre sur les rivages,
mais jamais dans l’intérieur : ce qui montre que les semences y ont été
apportées des plus grandes îles par les flots, que ces arbres se sont pro=
pagés d’eux-mêmes, et que, dans cette situation, ils ne sont pas indigènes.
Par l’un ou l’autre des mots halapa et nyor, et quelquefois par
les deux, la noix de coco est connue dans toutes les parties de l’archipel
( 1 j Le nom lada, qu’on lui donne dans tout l’archipel, est sanskrit. Crawf. op. cit. t. I.
(2) La mangue [mangga] paroît avoir été introduite dans l’archipel d’Asie par les Indiens.
Ibid.
(3) Ce mot est télingais. Ibid.
(4) Les Malais la nomment oubi-Europa, c’est-à-dire, igname d’Europe. Ibid.
(s) Ibid.
j (6) Ibid.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s i v e m e n t . 575
indien, depuis Sumatra jusqu’aux Philippines ; et même ces noms
s’étendent jusqu’à Madagascar et aux îles des Amis (Tonga), ainsi qu’à
d’autres portions de l’Océanie (1), Combien il est étonnant de découvrir
que ce végétal utile se soit propagé comme à la dérobée sur une étendue
de plusieurs milliers de lieues, parmi des centaines de tribus barbares,
parlant des langues différentes, et ne se- connoissant pas entre elles ?
Le cocotier croît très-promptement, atteint sa plus grande hauteur et
se montre beaucoup plus fécond près des bords de la mer : ses dimensions
et la grosseur de ses produits diminuent à mesure qu’on s’avance
dans l’intérieur des terres ; et sur les plus hautes montagnes, il est longtemps
avant de produire; encore ne donne-t-il que des fruits nains.
Dans les terres favorables , le cocotier doit être en plein rapport à l’âge
de cinq ans.
«L a pulpe, à son premier degré de maturation, est employée, sous
une grande variété de formes, à la cuisine des naturels; et quand la
noix est parvenue à son entier développement, on en extrait une huile
qui est la plus estimée de celles dont les insulaires indiens font usage.
Fraîchement exprimée, cette huile est pure et sans goût ; mais bientôt
elle acquiert une rancidité qui ne répugne pas aux indigènes, quoique
les Européens la trouvent insupportable. Trop chère pour servir habituellement
à l’éclairage, on la réserve presque toujours pour les usages
culinaires. »
L ’enveloppe fibreuse qui entoure la noix, peut, comme on sait, être
convertie en cordages, et la coque ou fécale du fruit servir à faire une
multitude de vases domestiques dont ce n’est point maintenant le lieu de
donner le détail.
A ces usages du cocotier, nous ajouterons celui qu’on peut faire
encore de la sommité herbacée de son tronc, sorte de chou très-délicat,
mais que l’on coupe rarement, parce que cette mutilation entraîne la
destruction de l’arbre.
L’aréquier, qu’on désigne quelquefois sous le nom de palmiste, donne
aussi un chou fort estimé : son fruit est un ingrédient obligé du masticatoire
connu sous le nom de bétel ; et la tige droite, haute et légère de
( 1 ) Notamment aux îles Mariannes, où la noix de coco se nomme niou.
Productions
végétales.