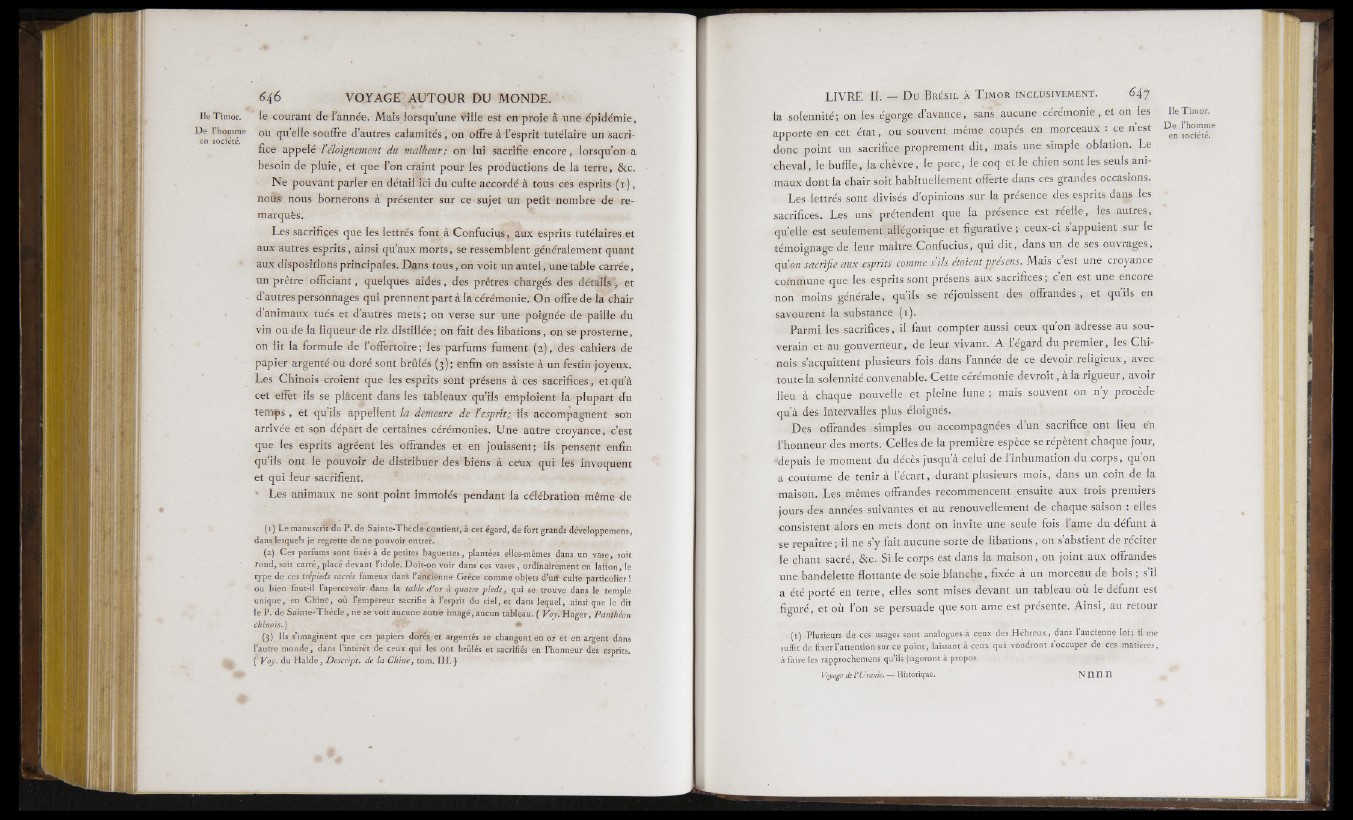
l’homme
société.
le courant de l’année. Mais lorsqu’une ville est en proie à une épidémie,
ou qu’elle souffre d’autres calamités, on offre à l’esprit tutélaire un sacri-
ficé appelé ïéloignement du malheur; on lui sacrifie encore, lorsqu’on a
besoin de pluie, et que l’on craint pour les productions de la terre, &c.
Ne pouvant parler en détail ici du culte accordé à tous ces esprits (1),
nous! nous bornerons à présenter sur ce sujet un petit nombre de remarqués.
Les sacrifices que les lettrés font à Confucius, aux esprits tutélaires et
aux autres esprits, ainsi qu’aux morts, se ressemblent généralement quant
aux dispositions principales. Dans tous, on voit un autel, une table carrée,
un prêtre officiant, quelques aides, des prêtres chargés des détails , et
d’autres personnages qui prennent part à la cérémonie. On offre de la chair
d animaux tués et d’autrës mets ; on verse sur une poignée de paille du
vin ou de la liqueur de riz distillée ; on fait des libations, on se prosterne,
on lit la formule de l’offertoire; les parfums fument (2), des cahiers de
papier argenté ou doré sont brûlés (3); enfin on assiste à un festin joyeux.
Les Chinois croient que les esprits sont présens à ces sacrifices, et qu à
cet effet ils se placent dans les tableaux qu’ils emploient la plupart du
temps , et qu’ils appellent la demeure de l'esprit; ils accompagnent son
arrivée et spn départ de certaines cérémonies. Une autre croyance, c’est
que les esprits agréent les offrandes et en jouissent; ils penserit enfin
qu’ils ont le pouvoir de distribuer des biens à ceux qui les invoquent
et qui leur sacrifient.
* Les animaux ne sont point immolés pendant la célébration même de
(1) Le manuscrit'du P. de Sainte-Thècle contient, à cet égard, de fort grands développemens,
dansjesqueïs je regrette de ne pouvoir entrer.
(2) Ces parfums sont fixés à de petites baguettes, plantées elles-mêmes dans un vase, soit
rond, soit carré, placé devant l’idole. Doit-on voir dans ces vases, ordinairement en laîion, le
type de ces trépieds sacrés fameux dans I’anciènne Grèce comme objets durp culte particulier !
ou bien faut-il 1 apercevoir dans la table d’or cl quatre pieds, qui se- trouve dans le temple
unique, en Chine, où l’empereur sacrifie à l’esprit du ciel, et dans lequel, ainsi que le dit
le P. de Sainte-Thècle, ne se voit aucune autre imagé, aucun tableau. ( Voy. Hager, Panthéon
chinois.)
(3) Ils s’imaginent que ces papiers dorés et argentés se changent en or et en argent dans
l’autre monde, dans l’intérêt de ceux qui les ont brûlés et sacrifiés en l’honneur des esprits.
( Voy. du Halde, Descript. de la Chine, tom. III. )
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r i n c l u s i v e m e n t . ¿ 4 7
la solennité; on les égorge d’avance, sans aucune cérémonie, et on les
apporte en cet état, ou souvent même coupés en morceaux : ce nest
donc point un sacrifice proprement dit, mais une simple oblation. Le
cheval, le buffle* la chèvre, le porc, le coq et le chien sont les seuls animaux
dont la chair soit habituellement offerte dans ces grandes occasions.
-Les lettrés sont divisés d’opinions sur la presence des esprits dans les
sacrifices. Les uns prétendent que la presence est reelle, les autres,
qu’elle est seulement allégorique et figurative ; ceux-ci s appuient sur le
témoignage de leur maître,Confucius, qui dit, dans un de.ses ouviages,
qu’on sacrifie aux esprits comme s’ils étoient presens. Mais cest une croyance
commune que les esprits sont presens aux sacrifices ; c en est une encore
non moins générale, qu’ils se rejouissent des offrandes, et quils en
savourent la substance (i).
Parmi les sacrifices, il faut compter aussi ceux qu’on adresse au souverain
et au gouverneur, de leur vivant. A 1 égard du premier, les Chinois
s’acquittent plusieurs fois dans l’année de ce devoir religieux, avec
toute la solennité convenable. Cette cérémonie devroït, à la rigueur, avoir
lieu à chaque nouvelle et pleine lune ; mais souvent on n’y procède
qu’à des intervalles plus éloignés.
Des offrandes simples ou accompagnées d’un sacrifice ont lieu en
l’honneur des morts. Celles de la première espèce se répètent chaque jour,
^depuis le moment du décès jusqu’à celui de l’inhumation du corps, qu’on
a coutume de tenir à l’écart, durant plusieurs mois, dans un coin de la
-maison. Les mêmes offrandes recommencent ensuite aux trois premiers
jours des années suivantes et au renouvellement de chaque saison : elles
consistent alors en mets dont on invite une seule fois l’ame du défunt à
se repaître ; il ne s’y fait aucune sorte de libations, on s’abstient de réciter
le chant sacré, & c. Si le corps est dans la maison, on joint aux offrandes
une bandelette flottante de soie blanche, fixée à un morceau de bois ; s’il
a été porté en terre, elles sont mises devant un tableau où le défunt est
figuré, et où l’on se persuade que son ame est présente. Ainsi, au retour
(1) Plusieurs de ces usages sont analogues à ceux des Hébreux, dans l’ancienne loi; il me
suffit de fixer l’attention sur ce point, laissant à ceux qui voudront s’occuper de ces matières,
à faire les rapprochemens qu ils jugeront à propos.
Voyage de V Uranie. — Historique. N II II II
De l’homme
en société.