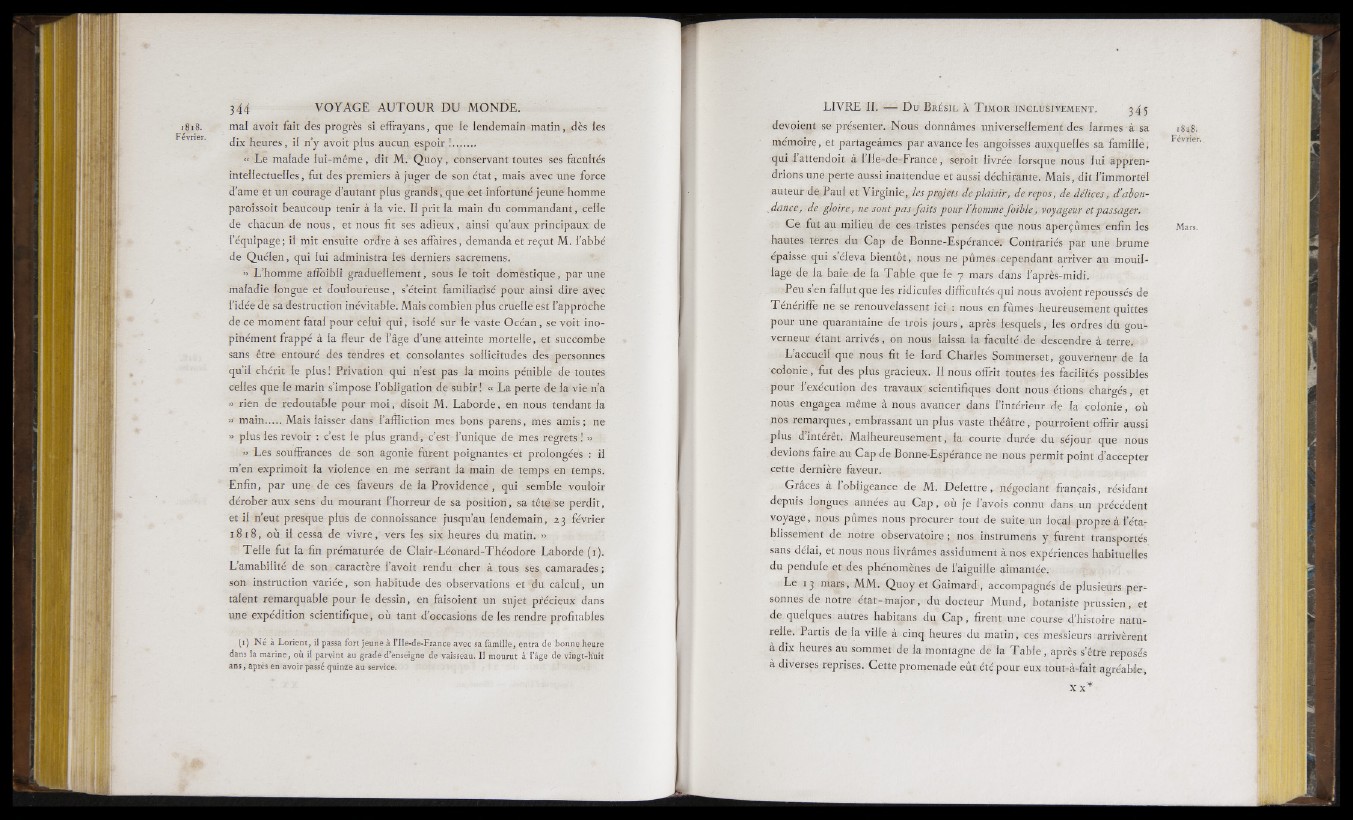
34 4 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
1 8 18. mal avoit fait des progrès si effrayans, que le lendemain matin, dès les
dix heures, il n’y avoit plus aucun espoir !.......
« Le malade lui-même, dit M. Quoy, conservant toutes ses facultés
intellectuelles, fut des premiers à juger de son état, mais avec une force
d’ame et un courage d’autant plus grands, que cet- infortuné jeune homme
paroissoit beaucoup tenir à la vie. II prit la main du commandant, celle
de chacun de nous, et nous fit ses adieux, ainsi qu’aux principaux de
l’équipage; il mit ensuite ordre à ses affaires, demanda et reçut M. l’abbé
de Quélen, qui lui administra les derniers sacremens.
» L ’homme affbibli graduellement, sous le toit domestique, par une
maladie longue et douloureuse, s’éteint familiarisé pour ainsi dire avec
l’idée de sa destruction inévitable. Mais combien plus cruelle est l’approche
de ce moment fatal pour celui qui, isolé sur le vaste Océan, se voit inopinément
frappé à la fleur de l’âge d’une atteinte mortelle, et succombe
sans être entouré des tendres et consolantes sollicitudes des personnes
qu’il chérit le plus! Privation qui n’est pas la moins pénible de toutes
celles que le marin s’impose l’obligation de subir ! « La perte de la vie n’â
» rien de redoutable pour moi, disoit M. Laborde, en nous tendant fa
main Mais laisser dans l’affliction mes bons parens, mes amis; ne
» plus les revoir : c’est le plus grand, c’est l’unique de mes regrets !» :
» Les souffrances de son agonie furent poignantes et prolongées : il
m’en exprimoit la violence en me serrant la main de temps en temps.
Enfin, par une de ces faveurs de la Providence, qui semble vouloir
dérober aux sens du mourant l’horreur de sa position, sa tête se perdit,
et il n’eut presque plus de connoissance jusqu’au lendemain, 23 février
18 18 , où il cessa de vivre, vers les six heures du matin. »
Telle fut la fin prématurée de Clair-Léonard-Théodore Laborde (1).
Lamabilité de son caractère l’avoit rendu cher à tous ses camarades;
son instruction variée, son habitude des observations et du calcul, un
talent remarquable pour le dessin, en faisoient un sujet pfécieux dans
une expédition scientifique, où tant d’occasions de les rendre profitables
(1) Ne a Lorient, il passa fort jeune à l’Ile-de-France avec sa famille, entra de bonne heure
dans la marine, où il parvint au grade d’enseigne de vaisseau. II mourut a ¡Page de vingt-huit
ans, après en avoir passé quinze au service.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 3 4 5
devoient se présenter. Nous donnâmes universellement des larmes à sa 18x8.
mémoire, et partageâmes par avance les angoisses auxquelles sa famille, Fevrier'
qui 1 attendoit à 1 Ile-de-France, seroit livrée lorsque nous lui apprendrions
une perte aussi inattendue et aussi déchirante. Mais , dit l’immortel
auteur de Paul et Virginie, les projets de plaisir, de repos, de délices, d’abondance,
de gloire, ne sont pas faits pour l’homme foible, voyageur et passager.
Ce fut au milieu de ces tristes pensées que nous aperçûmes enfin les Mars,
hautes terres du Cap de Bonne-Espérance. Contrariés par une brume
épaisse qui s’éleva bientôt, nous ne pûmes cependant arriver au mouil-
iage de la baie de la Table que le 7 mars dans l’après-midi.
Peu s en fallut que les ridicules difficultés-qui nous avoient repoussés de
Téneriffe ne se renouvelassent ici : nous en fûmes heureusement quittes
pour une quarantaine de trois jours, après lesquels, les ordres du gouverneur
étant arrivés, on nous laissa la faculté de descendre à terre.
L accueil que nous fit le lord Charles Sommerset, gouverneur de la
colonie, fut des plus gracieux. Il nous offrit toutes les facilités possibles
pour l’exécution des travaux scientifiques dont nous étions chargés, et
nous engagea même à nous avancer dans l’intérieur de la colonie, où
nos remarques, embrassant un plus vaste théâtre, pourroient offrir aussi
plus d’intérêt. Malheureusement, la courte durée du séjour que nous
devions faire au Cap de Bonne-Espérance ne nous permit point d’accepter
cette dernière faveur.
Grâces à 1 obligeance de M. Delettre, négociant français, résidant
depuis longues années au C ap , où je l’avois connu dans un précédent
voyage, nous pûmes nous procurer tout de suite,un local propre à l’établissement
de notre observatoire ; nos instrumens y furent transportés
sans délai, et nous nous livrâmes assidûment à nos expériences habituelles
du pendule et des phénomènes de l’aiguille aimantée.
Le 13 mars, MM. Quoy et Gaimard, accompagnés de plusieurs personnes
de notre état-major, du docteur Mund, botaniste prussien, et
de quelques autres habitans dp Cap, firent une course d’histoire naturelle.
Partis de la ville à cinq heures du matin, ces messieurs arrivèrent
à dix heures au sommet de la montagne de la Table, après s’être reposés
à diverses reprises. Cette promenade eût été pour eux tout-à-fait agréable,