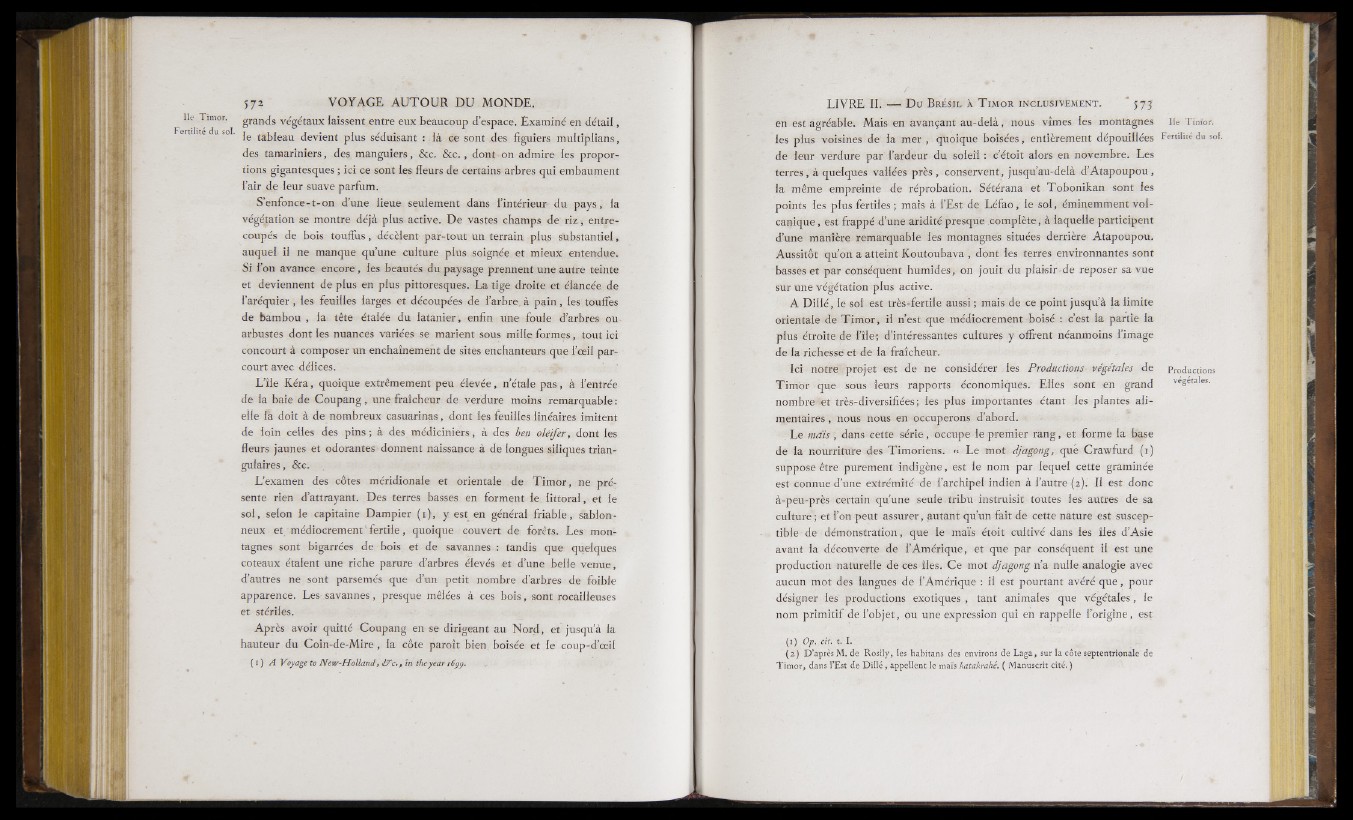
grands végétaux laissent entre eux beaucoup d’espace. Examiné en détail,
le tableau devient plus séduisant : là ce sont des figuiers muitipiians,
des tamariniers, des manguiers, &c. S ic ., dont on admire les proportions
gigantesques ; ici ce sont les fleurs de certains arbres qui embaument
i’air de ieur suave parfum.
S’enfonce-t-on d’une iieue seulement dans l’intérieur du pays, la
végétation se montre déjà plus active. De vastes champs de riz , entrecoupés
de bois touffus, décèlent par-tout un terrain plus substantiel,
auquel il ne manque qu’une culture plus soignée et mieux entendue.
Si l’on avance encore, les beautés du paysage prennent une autre teinte
et deviennent de plus en plus pittoresques. La tige droite et élancée de
l’aréquier , les feuilles larges et découpées de l’arbre,à pain, les touffes
de bambou , la tête étalée du latanier, enfin une foule d’arbres ou
arbustes dont les nuances variées se marient sous mille formes, tout ici
concourt à composer un enchaînement de sites enchanteurs que l’oeil parcourt
avec délices.
L ’île Kéra, quoique extrêmement peu élevée, n’étale pas, à l’entrée
de la baie de Coupang, une fraîcheur de verdure moins remarquable :
elle la doit à de nombreux casuarinas, dont les feuilles linéaires imitent
de loin celles des pins ; à des médiciniers, à des ben olêifer, dont les
fleurs jaunes et odorantes ■ donnent naissance à de longues siiiques triangulaires,
&c.
L’examen des côtes méridionale et orientale de Timor, ne présente
rien d’attrayant. Des terres basses en forment le littoral, et le
soi, selon le capitaine Dampier (i), y est en générai friable, sablonneux
et médiocrement'fertile, quoique couvert de forêts. Les montagnes
sont bigarrées de bois et de savannes : tandis que quelques
coteaux étaient une riche parure d’arbres élevés et d’une belle venue,
d’autres ne sont parsemés que d’un petit nombre d’arbres de foible
apparence. Les savannes, presque mêlées à ces bois, sont rocailleuses
et stériles.
Après avoir quitté Coupang en se dirigeant au Nord, et jusqu’à la
hauteur du Coin-de-Mire , la côte paroît bien boisée et le coup-d’oeil
( i ) A Voyage to New-Holland, & c,, in theyear ¡6py. v
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r i n c l u s i v e m e n t . " 575
en est agréable. Mais en avançant au-delà, nous vîmes les montagnes
les plus voisines de la mer , quoique boisées, entièrement dépouillées
de leur verdure par l’ardeur du soleil : c’étoit alors en novembre. Les
terres, à quelques vallées près , conservent, jusqu’au-delà d’Atapoupou,
la même empreinte de réprobation. Sétérana et Tobonikan sont les
points les plus fertiles ; mais à l’Est de Léfao, le sol, éminemment volcanique
, est frappé d’une aridité presque complète, à laquelle participent
d’une manière remarquable les montagnes situées derrière Atapoupou.
Aussitôt qu’on a atteint Koutoubava , dont les terres environnantes sont
basses et par conséquënt humides, on jouit du plaisir de reposer sa vue
sur une végétation plus active.
A Dillé, le sol est très-fertile aussi ; mais de ce point jusqu’à la limite
orientale de Timor, il n’est que médiocrement boisé ; c’est la partie la
plus étroite de l’île; d’intéressantes cultures y offrent néanmoins l’image
de la richesse et de la fraîcheur.
Ici notre projet est de ne considérer les Productions végétales de
Timor que sous leurs rapports économiques. Elles sont en grand
nombre et très-diversifiées; les plus importantes étant les plantes alimentaires
, nous nous en occuperons d’abord.
Le maïs , dans cette série, occupe le premier rang, et forme la base
de la nourriture des Timoriens. « Le mot djagong, que Crawfurd (1)
suppose être purement indigène, est le nom par lequel cette graminée
est connue d’une extrémité de l’archipel indien à l’autre (2). Il est donc
à-peu-près certain qu’une seule tribu instruisit toutes les autres de sa
culture; et l’on peut assurer, autant qu’un fait de cette nature est susceptible
de démonstration, que le maïs étoit cultivé dans les îles d’Asie
avant la découverte de l’Amérique, et que par conséquent il est une
production naturelle de ces îles. Ce mot djagong n’a nulle analogie avec
aucun mot des langues de l’Amérique : il est pourtant avéré que, pour
désigner les productions exotiques , tant animales que végétales, le
nom primitif de l’objet, pu une expression qui en rappelle l’origine, est
(1) Op. cit. t. I.
(2) D’après M. de Rosiiy, les habitans des environs de Laga, sur la côte septentrionale de
Timor, dans l’Est de Dillé, appellent le maïs katakrahé. ( Manuscrit cité. )
Productions
végétales.