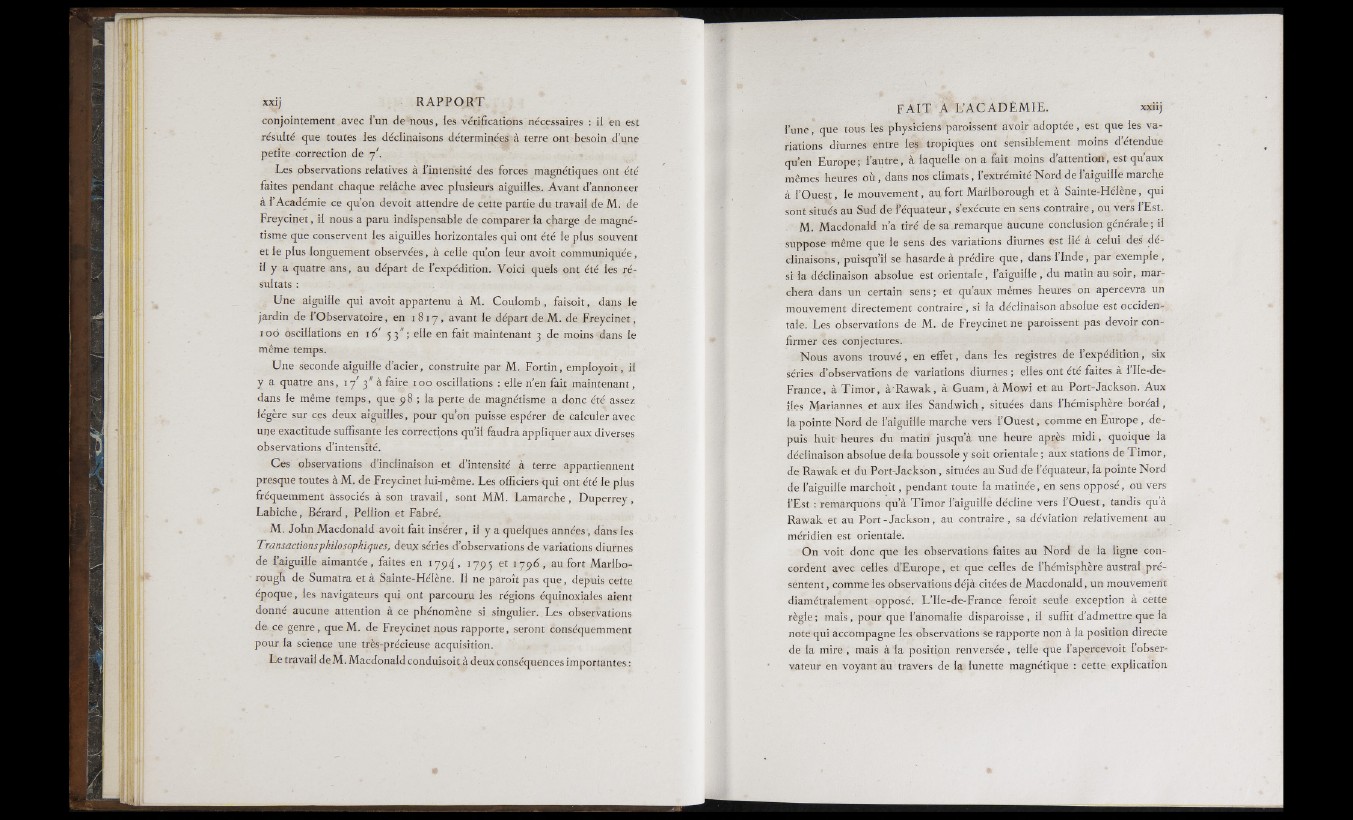
conjointement avec l’un de nous, les vérifications nécessaires : ii en est
résulté que toutes les déclinaisons déterminées à terre ont besoin d’une
petite correction de j .
Les pbservations relatives à l’intensité des forces magnétiques ont été
faites pendant chaque relâche avec plusieurs aiguilles. Avant d’annoneer
à l’Académie ce qu’on devoit attendre de cette partie du travail de M. de
Freycinet, il nous a paru indispensable de comparer la charge de magnétisme
que conservent les aiguilles horizontales qui ont été le plus souvent
et le plus longuement observées, à celle qu’on leur avoit communiquée,
il y a quatre ans, au départ de l’expédition. Voici quels ont été les résultats
:
Une aiguille qui avoit appartenu à M. Coulomb, faisoit, dans le
jardin de l’Observatoire, en 1 8 1 7 , avant le départ de M. de Freycinet,
100 oscillations en 1 6' 5 3 "; elle en fait maintenant 3 de moins dans le
même temps.
Une seconde aiguille d’acier, construite par M. Fortin, empioyoit, il
y a quatre ans, 17 ' 3" à faire 100 oscillations : elle n’en fait maintenant,
dans le même temps, que p8 ; la perte de magnétisme a donc été assez
légère sur ces deux aiguilles, pour qu’on puisse espérer de calculer avec
une exactitude suffisante les corrections qu’il faudra appliquer aux diverses
observations d’intensité.
Ces observations d’inclinaison et d’intensité à terre appartiennent
presque toutes à M. de Freycinet lui-même. Les officiers qui ont été le plus
fréquemment associés à son travail, sont MM. Lamarche, Duperrey,
Labiche, Bérard, Pellion et Fabré.
M. John Macdonald avoit fait insérer, il y a quelques années, dans les
Transactions philosophiques, deux séries d’observations de variations diurnes
de l’aiguille aimantée, faites en 17^4 » 175»5 et 179 6 , au fort Marlborough
de Sumatra et à Sainte-Hélène. Il ne paroît pas que, depuis cette
époque, les navigateurs qui ont parcouru les régions équinoxiales aient
donné aucune attention à ce phénomène si singulier. Les observations
de ce genre, queM. de Freycinet nous rapporte, seront conséquemment
pour la science une très-précieuse acquisition.
Le travail de M. Macdonald conduisoit à deux conséquences importantes :
l’une, que tous les physiciens paroissent avoir adoptée, est que les variations
diurnes entre les tropiques ont sensiblement moins d’étendue
qu’en Europe ; l’autre, à laquelle on a fait moins d’attention, est qu’aux
mêmes heures où, dans nos climats, l’extrémité Nord de l’aiguille marche
à l’Ouest, le mouvement, au fort Marlborough et à Sainte-Hélène, qui
sont situés au Sud de ¡’équateur, s’exécute en sens contraire, ou vers l’Est.
M. Macdonald n’a tiré de sa remarque aucune conclusion générale; il
suppose même que le sens des variations diurnes est lié à celui dej déclinaisons
, puisqu’il se hasarde à prédire que, dans 1 Inde, par exemple ,
si la déclinaison absolue est orientale, l’aiguille, du matin au soir, marchera
dans un certain sens ; et qu’aux mêmes heures on apercevra un
mouvement directement contraire , si la déclinaison absolue est occidentale.
Les observations de M. de Freycinet ne paroissent pas devoir confirmer
ces conjectures.
Nous avons trouvé, en effet, dans les registres de l’expédition, six
séries d’observations de variations diurnes ; elles ont été faites à l’Ile-de-
France, à Timor, à'Rawak, à Guam, à Mowi et au Port-Jackson. Aux
îles Mariannes et aux îles Sandwich, situées dans l’hémisphère boréal,
la pointe Nord de l’aiguille marche vers l’Ouest, comme en Europe , depuis
huit heures du matin jusqu’à une heure après midi, quoique la
déclinaison absolue de la boussole y soit orientale ; aux stations de Timor,
de Rawak et du Port-Jackson, situées au Sud de l’équateur, la pointe Nord
de l’aiguille marchoit, pendant toute la matinée, en sens opposé, ou vers
l’Est : remarquons qu’à Timor l’aiguille décline vers l’Ouest, tandis qu a
Rawak et au Port-Jackson, au contraire, sa déviation relativement au
méridien est orientale.
On voit donc que les observations faites au Nord de la ligne concordent
avec celles d’Europe, et que celles de l’hémisphère austral présentent,
comme les observations déjà citées de Macdonald, un mouvement
diamétralement opposé. L ’Ile-de-France feroit seule exception à cette
règle ; mais, pour que l’anomalie disparoisse , il suffit d’admettre que la
note qui accompagne les observations se rapporte non à la position directe
de la mire , mais à la position renversée, telle que i’apercevoit l’observateur
en voyant au travers de la lunette magnétique : cette explication