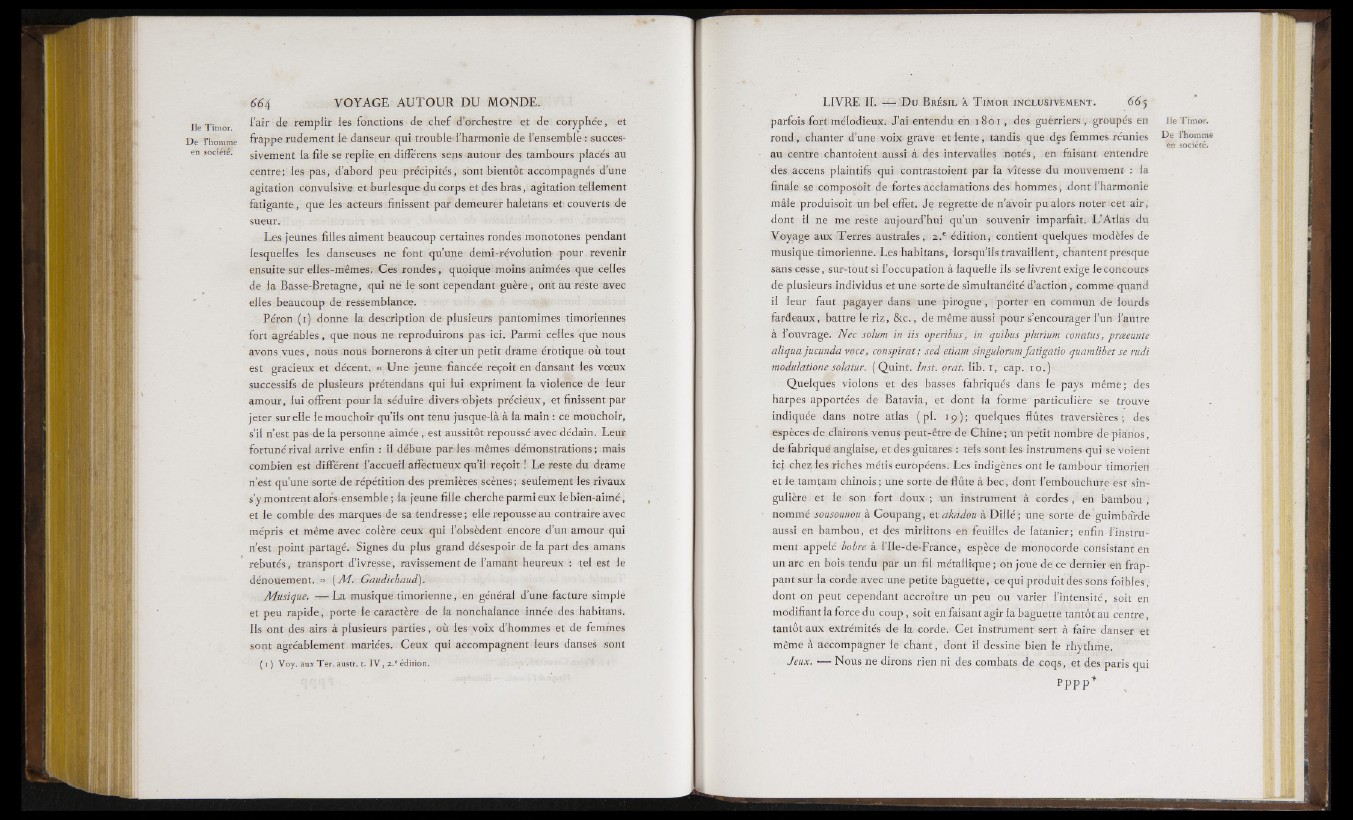
De l’homme
en société.
i’air de remplir les fonctions de chef d’orchestre et de coryphée, et
frappe rudement le danseur qui trouble l’harmonie de l’ensemble : successivement
la file se replie en différens sens autour des tambours placés au
centre; les pas, d’abord peu précipités, sont bientôt accompagnés d’une
agitation convulsive et burlesque du corps et des bras, agitation tellement
fatigante, que les acteurs finissent par demeurer haletans et couverts de
sueur.
Les jeunes filles aiment beaucoup certaines rondes monotones pendant
lesquelles les danseuses ne font qu’une demi-révolution pour revenir
ensuite sur elles-mêmes. Ces rondes, quoique moins animées que celles
de la Basse-Bretagne, qui ne le sont cependant guère , ont au reste avec
elles beaucoup de ressemblance.
Péron (1) donne la description de plusieurs pantomimes timoriennes
fort agréables, que nous ne reproduirons pas ici. Parmi celles que nous
avons vues, nous nous bornerons à citer un petit drame érotique où tout
est gracieux et décent. « Une jeune fiancée reçoit en dansant les voeux
successifs de plusieurs prétendans qui lui expriment la violence de leur
amour, lui offrent pour la séduire divers-objets précieux, et finissent par
jeter sur elle le mouchoir qu’ils ont tenu jusque-là à la main : ce mouchoir,
s’il n’est pas de la personne aimée , est aussitôt repoussé avec dédain. Leur
fortuné rival arrive enfin : il débute par les mêmes démonstrations ; mais
combien est différent l’accueil affectueux qu’il reçoit ! Le reste du drame
n’est qu’une sorte de répétition des premières scènes; seulement les rivaux
s’y montrent alors ensemble ; la jeune fille cherche parmi eux lebien-aimé,
et le comble des marques de sa tendresse; elle repousse au contraire avec
mépris et même avec colère ceux qui l’obsèdent encore d’un amour qui
n’est point partagé. Signes du plus grand désespoir de la part des amans
rebutés, transport d’ivresse, ravissement de l’amant heureux : tel est le
dénouement. » [M . Gaudichaud).
Musique. — La musique timorienne, en général d’une facture simple
et peu rapide, porte le caractère de la nonchalance innée des habitans.
Us ont des airs à plusieurs parties, où les voix d’hommes et de femmes
sont agréablement mariées. Ceux qui accompagnent leurs danses sont
( i ) Voy. aux Ter. austr. t. IV , 2 .e édition.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r i n c l u s i v e m e n t . 6 6 5
parfois fort mélodieux. J ’ai entendu en 18 0 1 , des guerriers r groupés en
rond, chanter d’une voix grave et lente, tandis que des femmes réunies
au centre chantoient aussi à des intervalles notés, en faisant entendre
des accens plaintifs qui contrastoient par la vitesse du mouvement : la
finale s.e composoit de fortes acclamations des hommes > dont l’harmonie
mâle produisoit un bel effet. Je regrette de n’avoir pu alors noter cet air,
dont il ne me reste aujourd’hui qu’un souvenir imparfait. L’Atlas du
Voyage aux Terres australes, 2.e édition, contient quelques modèles de
musique timorienne. Les habitans, lorsqu’ils travaillent, chantent presque
sans cesse, sur-tout si l’occupation à laquelle ils se livrent exige le concours
de plusieurs individus et une sorte de simultanéité d’action, comme quand
il leur faut pagayer dans une pirogue , porter en commun de lourds
fardeaux, battre le riz, & c ., de même aussi pour s’encourager l’un l’autre
à l’ouvrage. Nec solum in iis operibus, in quibus plurium conatus, prxeunte
aliqua jucunda voce, conspirât; sed etiam singulorum fatigatio quamlibet se rudi
modulatione solatur. (Quint. Inst. orat. lib. 1, cap. 10.)
Quelques violons et des basses fabriqués dans le pays même; des
harpes apportées de Batavia, et dont la forme particulière se trouve
indiquée dans notre atlas (pl. 19 ) ; quelques flûtes traversières ; des
espèces de clairons venus peut-être de Chine; un petit nombre de pianos,
de fabrique anglaise, et des guitares : tels sont les instrumens qui se voient
ici chez les riches métis européens. Les indigènes ont le tambour timprien
et le tamtam chinois; une sorte de flûte à bec, dont l’embouchure est singulière
et le son fort doux; un instrument à cordes, en bambou,'
nommé sousounou à Coupang, et akadou à Dillé; une sorte de'guimbarde
aussi en bambou, et des mirlitons en feuilles de latanier; enfin l’instrument
appèlé bobre à l'Ile-de-France, espèce de monocorde consistant en
un arc en bois tendu par un fil métallique ; on joue de ce dernier en frappant
sur la corde avec une petite baguette, ce qui produit des sons foibles,
dont on peut cependant accroître un peu ou varier l’intensité, soit en
modifiant la force du coup, soit en faisant agir la baguette tantôt au centre,
tantôt aux extrémités de la corde. Cet instrument sert à faire danser et
même à accompagner le chant, dont il dessine bien le rhythme.
Jeux. — Nous ne dirons rien ni des combats de coqs, et des paris qui
P p p p *
De l’homme
en société.