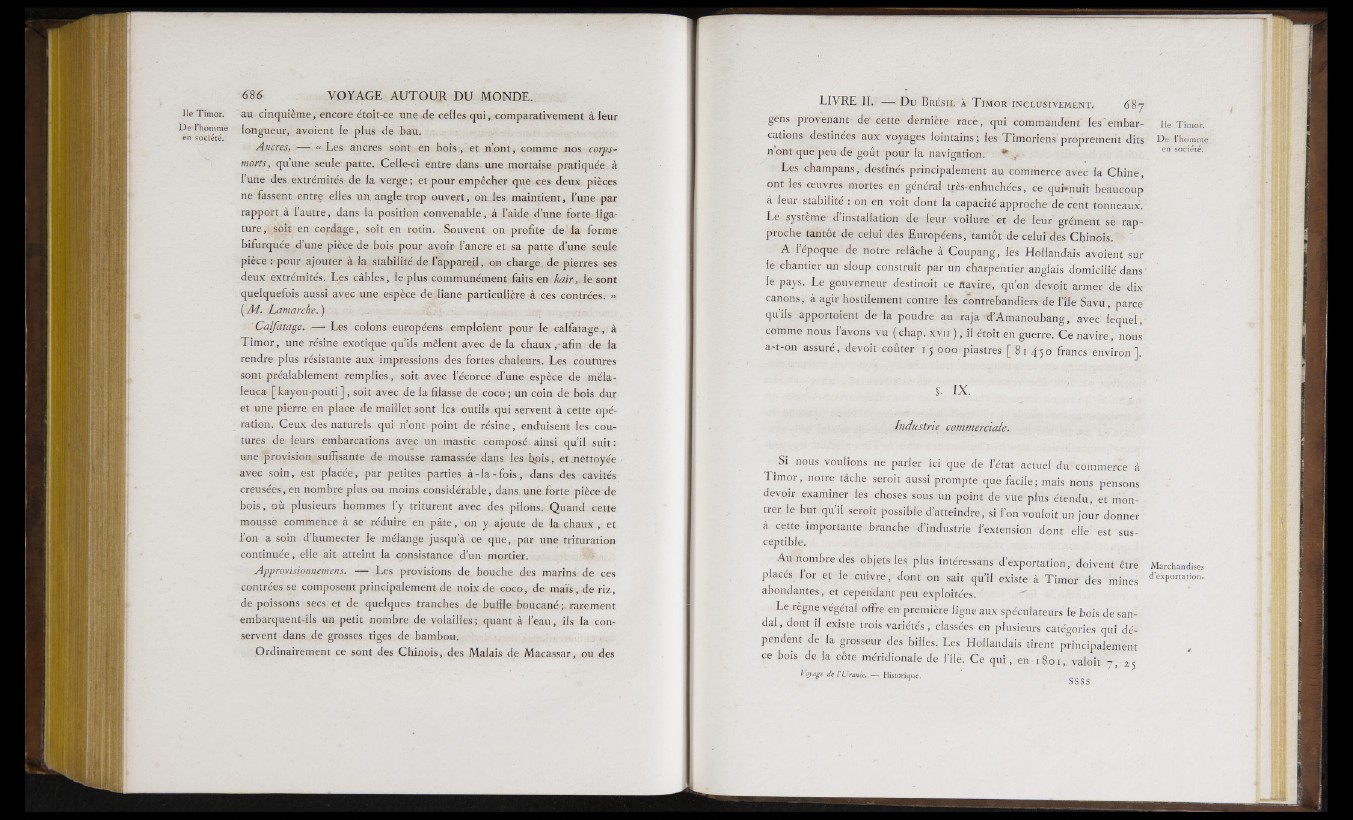
De l’homme
en société.
au cinquième, encore étojt-ce une de celles qui, comparativement à leur
longueur, avoient le plus de bau.
Ancres, — «Les ancres sont en bois, et n’ont, comme nos corps-
morts, qu’une seule patte. Celle-ci- entre dans une mortaise pratiquée à
lune des. extrémités de la verge; et pour empêcher que ces deux pièces
ne fassent entre elles un angle trop ouvert, ondes maintient, l’une par
rapport à l’autre, dans la position convenable, à l’aide d’une forte, ligature,
soit en cordage, soit en rotin. Souvent on profite de la forme
bifurquée d’une pièce de bois pour avoir l’ancre et sa patte d’une seule
piece : pour ajouter à la stabilité de l’appareil, on charge, de pierres ses
deux extrémités. Les câbles, le plus communément faits en kair, le sont
quelquefois aussi avec une espèce de liane particulière à ces contrées. »
( A4. Lamarche. )
Calfatage. — Les colons européens emploient pour le calfatage, à
Timor, une résine exotique qu’ils mêlent avec de la chaux,-afin de la
rendre plus résistante aux impressions des fortes chaleurs. Les coutures
sont préalablement remplies, soit avec l’écorcé d’une espèce de mëla-
leuca [ kayou-pouti ] , soit avec de la filasse de coco ; un coin de bois dur
et une pierre en place de maillet sont les outils qui servent à cette opération.
Ceux des naturels qui n’ont point de résine, enduisent les coutures
de leurs embarcations avec un mastic composé: ainsi qu’il suit:
une provision suffisante de mousse ramassée dans les hpis, et nêttoyée
avec soin, est placée, par petites parties à - la - fo is , dans des cavités
creusées, en nombre plus ou moins considérable, dans, une forte pièce de
bois, où plusieurs hommes l’y triturent avec des pilons.;Quand cette
mousse commence à se réduire en pâte, on y. ajoute de la chaux , et
l’on a soin d’humecter le mélange jusqu’à ce que, par une trituration
continuée, elle ait atteint la consistance d’un mortier.
Approvisipnnemens. — Les provisions de bouche des marins de ces
contrées se composent principalement de noix de coco, de maïs, de riz,
de poissons secs et de quelques- tranches de buffle boucané ;, rarement
embarquent-ils un petit nombre de volailles; quant à l’eau, ils la conservent
dans de grosses tiges de bambou.
Ordinairement ce sont des Chinois, des Malais de Macassar, ou des
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r i n c l u s i v e m e n t . 68y
gens provenant de' cette dernière racé, qui commandent' les embarcations
destinées aux voyages lointains ; les Timoriens proprement dits
nont que peu de goût pour la navigation. *
Les champans, destinés principalement au commerce avec la Chine,
ont les oeuvres mortes en général très-enhuchées, ce quû-nuit beaucoup
à leur stabilité : on en voit dont la capacité approche de cent tonneaux.
Le système d installation de leur voilure et de leur grément se rapproche
tantôt de celui dés Européens, tantôt de celui des Chinois.'
A 1 epoque de notre relâche à Coupang, lés Hollandais avoient sur
le chantier un sloup construit par un charpentier anglais domicilié dans
le pays. Le gouverneur destinoit ce navire, qu’on devoit armer de dix
canons, à agir hostilement contre les contrebandiers de l’île Savu, parce
qu’ils apportoient de ia poudre au raja ’d’Amanoubang, avec lequel,
comme nous l’avons vu (chap. xvn ), il étoit en guerre. Ce navire, nous
a-t-on assuré, devoit coûter 15 000 piastres [ 81 4-50 francs environ],
S. IX.
Industrie commerciale.
Si nous voulions ne parier ici que de l’état actuel du commerce à
Timor, notre- tâche seroit aussi prompte que facile; mais nous pensons
devoir examiner les choses sous un point de vue plus étendu, et montrer
le but qu’il seroit possible d’atteindre, si l’on vouloit un jour donner
à cette importante branche d’industrie l’extension dont elle est susceptible.
Au nombre des objets les plus intéressâns d’exportation, doivent être
placés l’or et le cuivre, dont on sait qu’il existe à Timor des mines
abondantes, et cependant peu exploitées. '
Le regne végétal offre en première ligne aux spéculateurs le bois de san-
dal, dont il existe trois variétés, classées en plusieurs catégories qui dépendent
de la grosseur des billes. Les Hollandais tirent principalement
ce bois de ia côte méridionale de l’île. Ce qui, en 1801 , valoit 7, 25
V y âge de lUranie. - - , Histcrrigue.
De l’homme
en société.
Marchandises
d’exportation.