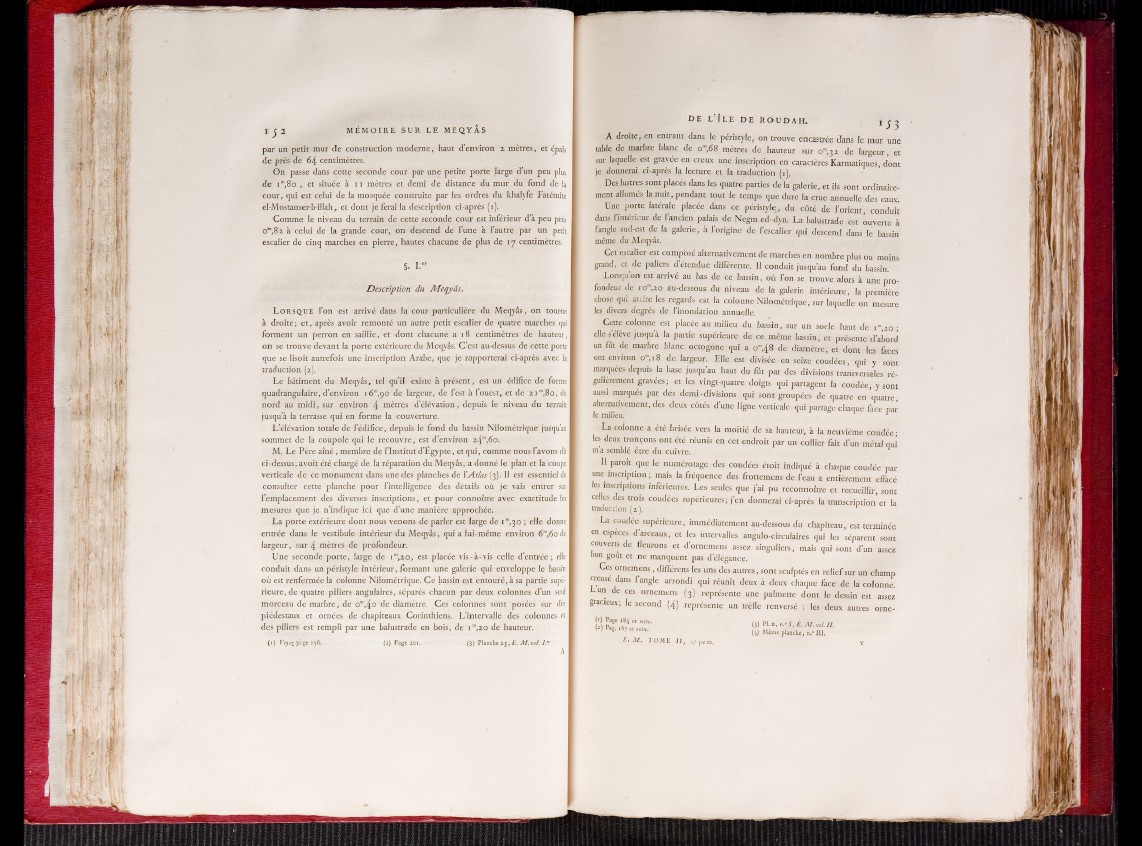
par un petit mur de construction moderne, haut d’environ 2 mètres, et épais I
de près de 64 centimètres.
On passe dans cette seconde cour par une petite porte iarge d’un peu plus I
de i m,8o , et située à 11 mètres et demi de distance du mur du fond de la I
cour, qui est celui de la mosquée construite par les ordres du khalyfe Fatémite I
el-Mostanser-b-illah, et dont je ferai la description ci-après (1).
Comme le niveau du terrain de cette seconde cour est inférieur d’à peu près I
o”,8 z à celui de la grande cour, on descend de l’une à l’autre par un petit I
escalier de cinq marches en pierre, hautes chacune de plus de 17 centimètres.
§. I . "
Description du M eqyâs.
L o r s q u e l’on est arrivé dans la cour particulière du Meqyâs, on tourne I
à droite; e t, après avoir remonté un autre petit escalier de quatre marches qui I
forment un perron en saillie, et dont chacune a 18 centimètres de hauteur, I
on se trouve devant la porte extérieure du Meqyâs. C ’est au-dessus de cette porte I
que se lisoit autrefois une inscription Arabe, que je rapporterai ci-après avec la I
traduction (2).
L e bâtiment du Meqyâs, tel qu’il existe à présent, est un édifice de forme I
quadrangulaire, d’environ 16™,90 de largeur, de l’est à l’ouest, et de 2 1 ”,80, du I
nord au midi, sur environ 4 mètres d’élévation, depuis le niveau du terrain I
jusqu’à la terrasse qui en forme la couverture.
L ’élévation totale de l’édifice, depuis le fond du bassin Nilométrique jusqu’au I
sommet de la coupole qui le recouvre, est d’environ 24”,60.
M. L e Père aîné, membre de l’Institut d’Egypte, et qui, comme nous l’avons dit I
ci-dessus, avoit été chargé de la réparation du Meqyâs, a donné le plan et la coupe I
verticale de ce monument dans une des planches de \A tlas (3). Il est essentiel de I
consulter cette planche pour l’intelligence des détails où je vais entrer sur I
l’emplacement des diverses inscriptions, et pour connoître avec exactitude les I
mesures que je n’indique ici que d’une manière approchée.
L a porte extérieure dont nous venons de parler est large de ¡ ”,30 ; elle donne I
entrée dans le vestibule intérieur du Meqyâs, qui a lui-même environ 6”,60 de I
largeur, sur 4 mètres de profondeur.
Une seconde porte, large de i ”,20, est placée vis-à-v is celle d’entrée; elle I
conduit dans un péristyle intérieur, formant une galerie qui enveloppe le bassin I
où est renfermée la colonne Nilométrique. C e bassin est entouré, à sa partie supé- |
rieure, de quatre piliers angulaires, séparés chacun par deux colonnes d’un seul H
morceau de marbre, de o” ,4° rie diamètre. Ces colonnes sont posées sur des I
piédestaux et ornées de chapiteaux Corinthiens. L ’intervalle des colonnes et I
des piliers est rempli par une balustrade en bois, de i ”,20 de hauteur.
( 1 ) Voyez page 156, (2) Page 201. (3) Planche 23, Ê. M. vol. I."
A I
A droite, en entrant dans le péristyle, on trouve encastrée dans le mur une
table de marbre blanc de o”,68 mètres de hauteur sur ora,32 de largeur, et
sur laquelle est gravée en creux une inscription en caractères Karmatiques, dont
je donnerai ci-après la lecture et la traduction (i).
Des lustres sont placés dans les quatre parties de la galerie, et ils sont ordinairement
allumés la nuit, pendant tout le temps que dure la crue annuelle des eaux.
Une porte latérale placée dans ce péristyle, du côté de l’orient, conduit
dans l’intérieur de l’ancien palais de Negm ed-dyn. L a balustrade est ouverte à
l'angle sud-est de la galerie, à l’origine de l’escalier qui descend dans le bassin
même du Meqyâs.
Cet escalier est compbsé alternativement de marches en nombre plus ou moins
grand, et de paliers d étendue différente. Il conduit jusqu’au fond du bassin.
Lorsqu’on est arrivé au bas de ce bassin, où l’on se trouve alors à une profondeur
de io m,20 au-dessous du niveau de la galerie intérieure, la première
chose qui attire les regards est la colonne Nilométrique, sur laquelle on mesure
les divers degrés de l’inondation annuelle.
Cette colonne est placée au milieu du bassin, sur un socle haut de i ”,20 ;
elle s élève jusquà la partie supérieure de ce même bassin, et présente d’abord
un fût de marbre blanc octogone qui a o”,48 de diamètre, et dont les faces
ont environ o™, 18 de largeur. Elle est divisée en seize coudées, qui y sont
marquées depuis la base jusqu’au haut du fût par des divisions transversales- régulièrement
gravées ; et les vingt-quatre doigts qui partagent la coudée, y sont
aussi marqués par des demi-divisions qui sont groupées de quatre en quatre,
alternativement, des deux côtés d’une ligne verticale qui partage chaque face par
le milieu.
La colonne a été brisée vers la moitié de sa hauteur, à la neuvième coudée;
les deux tronçons ont été réunis en cet endroit par un collier fait d’un métal qui
m a semblé être du cuivre.
Il paroît que le numérotage des coudées étoit indiqué à chaque coudée par
une inscription ; mais la fréquence des frottemens de l’eau a entièrement effacé
les inscriptions inférieures. Les seules que j’ai pu reconnoître et recueillir, sont
celles des trois coudées supérieures; j’en donnerai ci-après la transcription et la
traduction (2).
La coudée supérieure, immédiatement au-dessous du chapiteau, est terminée
en espèces d’arceaux, et les intervalles angulo-circulaires qui les séparent sont
couverts de fleurons et d’ornemens assez singuliers, mais qui sont d’un assez
bon gout et ne manquent pas d’élégance.
Ces ornemens, différens les uns des autres, sont sculptés en relief sur un champ
creuse dans l’angle arrondi qui réunit deux à deux chaque face de la colonne.
ntl de ces ornemens (3) représente une palmette dont le dessin est assez
gracieux; le second (4) représente un trèfle renversé : les deux autres ome-
I Sf 91 S“iV' (3) 1 a, M l .I V*/ 1 ag- 107 et SUIV. /,» iv/1 A „ , , „ vol, , ,
(4) Meme planche, n.° III.
Ê. M. T O M E I I , 2.e partie. y