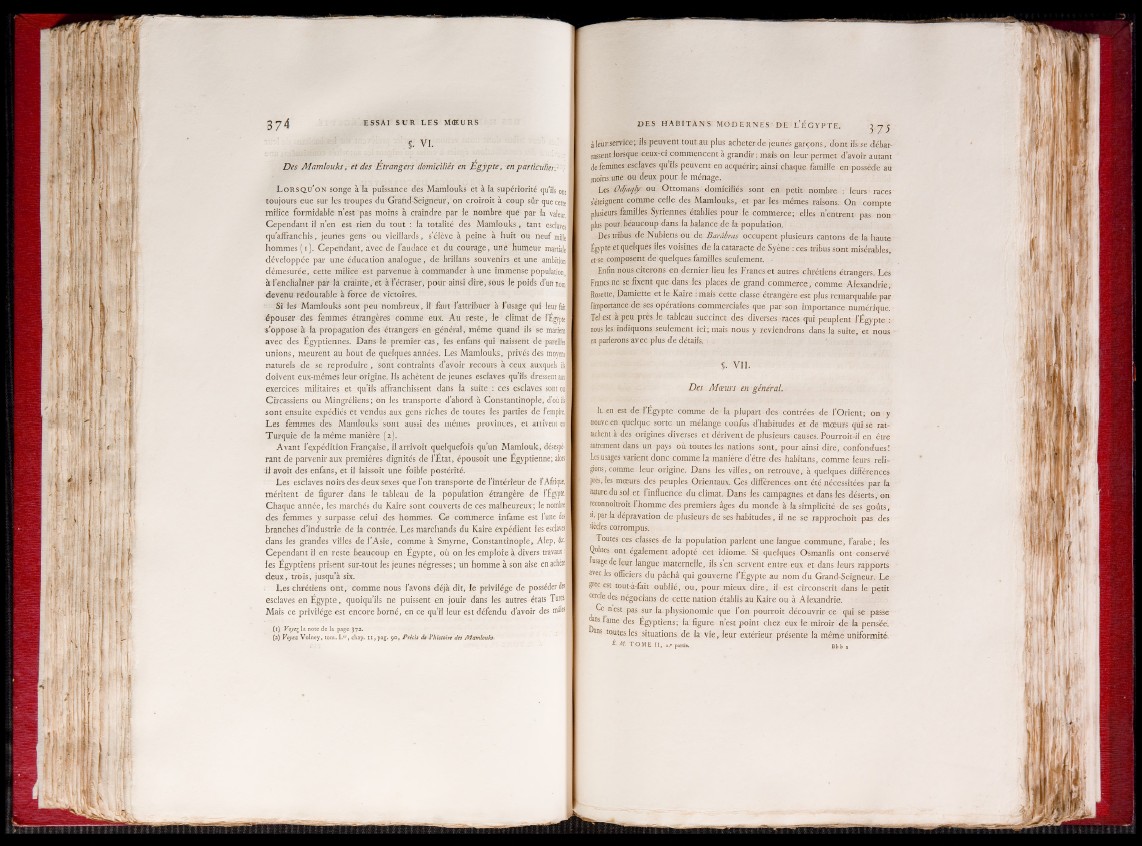
D es M am lou k s, et des Étrangers domiciliés en È g y p te , en p a r ticu lier. ■
L o r s q u ' o n songe à la puissance des Mamlouks et à la supériorité qu’ils ont
toujours eue sur les troupes du Grand-Seigneur, on croiroit à coup sûr que cette
milice formidable n’est pas moins à craindre par le nombre que par la valeur
Cependant il n’en est rien du tout : la totalité des Mamlouks, tant esclaves
qu’affranchis, jeunes gens ou vieillards, s’élève à peine à huit ou neuf mille
hommes (r). Cependant, avec de l’audace et du courage, une humeur martiale
développée par une éducation analogue, de brillans souvenirs et une ambitionI
démesurée, cette milice est parvenue à commander à une immense population,
à l'enchaîner par (a crainte, et h l’écraser, pour ainsi dire, seus le poids d’un nom
devenu redoutable à force de victoires.
Si les Mamlouks sont peu nombreux, il faut l’attribuer à l’usage qui leur fait
épouser des femmes étrangères comme eux. A u reste, le climat de l'Egypte
s’oppose à la propagation des étrangers en général, même quand ils se marient
avec des Egyptiennes. Dans le premier cas, les enfans qui naissent de pareilles
unions, meurent au bout de quelques années. Les Mamlouks, privés des moyens!
naturels de se reproduire, sont contraints d’avoir recours à ceux auxquels ils]
doivent eux-mêmes leur origine. Us achètent de jeunes esclaves qu’ils dressent aux]
exercices militaires et qu’ils affranchissent dans la suite : ces esclaves sont ou
Circassiens ou Mingréliens; on les transporte d’abord à Constantinople, d’où ils
sont ensuite expédiés et vendus aux gens riches de toutes les parties de l’empire.]
Les femmes des Mamlouks sont aussi des mêmes provinces, et arrivent en]
Turquie de la même manière (2).
Avan t l’expédition Française, il arrivoit quelquefois qu’un Mamlouk, désespé-J
rant de parvenir aux premières dignités de l’Etat, épousoit une Égyptienne; alors]
if avoit des enfans, et il laissoit une foible postérité.
Les esclaves noirs des deux sexes que l’on transporte de l’intérieur de l’Afrique,]
méritent de figurer dans le tableau de la population étrangère de l’Egypu]
Chaque année, les marchés du Kaire sont couverts de ces malheureux; le nomk]
des femmes y surpasse celui des hommes. C e commerce infâme est l’une de]
branches d’industrie de la contrée. Les marchands du Kaire expédient les esclave]
dans les grandes villes de l’As ie , comme à Smyrne, Constantinople, Alep, 4tj
Cependant il en reste beaucoup en Egypte, où on les emploie à divers travaux:]
les Égyptiens prisent sur-tout les jeunes négresses ; un homme à son aise en adieu]
deu x , trois, jusqu’à six.
Les chrétiens ont, comme nous l’avons déjà dit, le privilège de posséder des]
esclaves en Egypte, quoiqu’ils ne puissent en jouir dans les autres états Turcs.]
Mais ce privilège est encore borné, eh ce qu’il leur est défendu d’avoir des mâlesl
(1) Voyeç la note de la page. 372.
(2) Voyez Volney, tom. I.cr, chap. i l , pag. 90, Précis de-Vhistoire des Atamlouh.
àleurservice; ils.peuvent tout au plus acheterde jeunes garçons, dont ils se débar-
r a s s e n t lorsque ceux-ci commencent a grandir : mais on leur permet d’avoir autant
d e femmes esclaves quils peuvent en acquérir; ainsi chaque famille en possède au
ju o in s u u n e ou deux pour.le ménage.
Les Odjaqly ou Ottomans domiciliés sont en petit nombre : leurs1 races
¡’éteignent comme celle, des Mamlouks, et par les mêmes raisons. On compte
plusieurs familles Syriennes établies pour le commerce; elles n’entrent pas non
plus pour, beaucoup dans la balance d e la population.
Des .tribus de Nubiens ou de Barâbras occupent plusieurs cantons de la haute
Egypte et quelques îles voisines de la cataracte de Syène : ces tribus sont misérables,
et-se composent de quelques familles seulement.
Enfin nous citerons en dernier lieu les Francs et autres chrétiens étrangers. Les
Francs.ne se fixent que dans les places de grand commerce, comme Alexandrie,
Rosette, Damiette et le Kaire : mais cette classe étrangère est plus remarquable par
l’importance de ses opérations commerciales que par son importance numérique.
Tel est. à: peu près le tableau succinct des diverses races qui peuplent l'Egypte :
nous les. indiquons seulement ici; mais nous y reviendrons dans la suite, et nous -
en parlerons avec plus de détails, t .
§. V I I .
D es Moeurs en général.
Il en est de l’Egypte comme de la plupart des contrées de l’Orient; on y
trouve, en quelque sorte , un mélange confus d’habitudes et de moeurs qui se rattachent
à des origines diverses et dérivent de plusieurs causes. Pourroit-il en être
autrement dans un pays où toutes les nations sont, pour ainsi dire, confondues!
Les usages varient donc comme la manière d’être des habitans, comme leurs religions,
comme leur origine. Dans les villes, on retrouve, à quelques différences
près, les moeurs des peuples Orientaux. Ces différences ont été nécessitées par la
nature du sol et l’influence du climat. Dans les campagnes et dans les déserts,-on
reconnoîtroit l’homme des premiers âges du monde à la simplicité de ses goûts,
si, par la dépravation de plusieurs de ses habitudes, il ne se rapprochoit pas des
siècles corrompus.
Toutes ces classes de la population parlent une langue commune, l’arabe; les
Qobtes ont également adopté cet idiome. Si quelques Osmanlis ont conservé
■usage de leur langue maternelle, ils s en servent entre eux et dans leurs rapports
avec les officiers du pâchâ qui gouverne l’Egypte au nom du Grand-Seigneur.- L e
grec, est tout-à-fait oublié, ou, pour mieux dire, il est circonscrit dans le petit
cercle des négocians de cette nation établis au Kaire ou à Alexandrie.
Ce n est pas sur la physionomie que l’on pourroit découvrir ce qui se passe
ans.lame ^es Égyptiens; la figure n’est point chez eux le miroir de la pensée,
aos toutes.ies situations de la v ie , leur extérieur présente la même uniformité-,
î . M. T O M E I I , partie. Bbb a