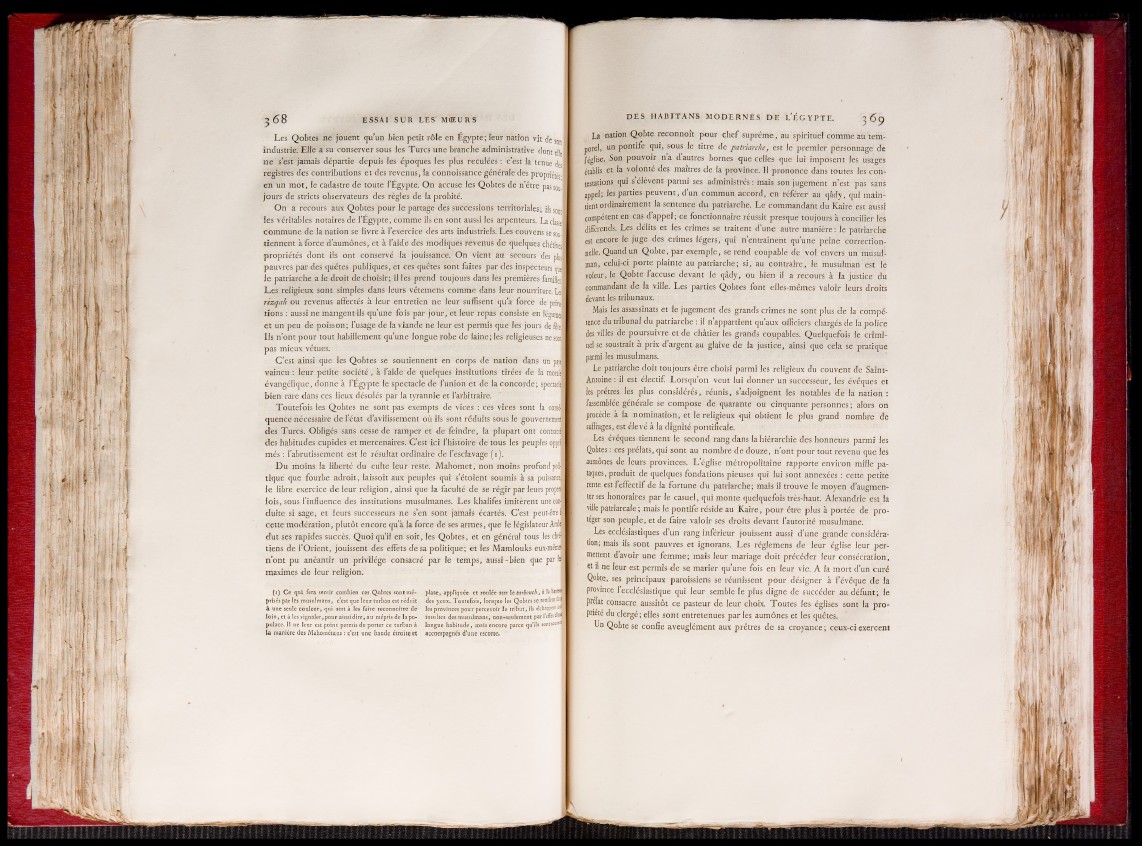
Les Qobtes ne jouent qu’un bien petit rôle en Egypte; leur nation vit de son
industrie. Elle a su conserver sous les Turcs une branche administrative dont elle
ne s’est jamais départie depuis les époques les plus reculées : c’est la tenue des!
registres des contributions et des revenus, la connoissance générale des propriétés !
en un mot, le cadastre de toute l’Egypte. O n accuse les Qobtes de n’être pas ton.
jours de stricts observateurs des règles de la probité.
On a recours aux Qobtes pour le partage des successions territoriales; ils sont
les véritables notaires de l’Egypte, comme ils en sont aussi les arpenteurs. La classe
commune de la nation se livre à l’exercice des arts industriels. Les couvens sesou l
tiennent à force d’aumônes, et à l’aide des modiques revenus de quelques chétives!
propriétés dont ils ont conservé la jouissance. On vient au secours des p|us!
pauvres par des quêtes publiques, et ces quêtes sont faites par des inspecteurs ipd
le patriarche a le droit de choisir; il les prend toujours dans les premières familfei
Les religieux sont simples dans leurs vêtemens comme dans leur nourriture. La
rizqah ou revenus affectés à leur entretien ne leur suffisent qu’à force de privai
tions ; aussi ne mangent-ils qu’une fois par jour, et leur repas consiste en légume!
et un peu de poisson; l’usage de la viande ne leur est permis que les jours de fét!
Us n’ont pour tout habillement qu’une longue robe de laine; les religieuses ne soi!
pas mieux vêtues.
C ’est ainsi que les Qobtes se soutiennent en corps de nation dans un paj!
vaincu : leur petite so c iété , à l’aide de quelques institutions tirées de la moral!
évangélique, donne à l’Egypte le spectacle de l’union et de la concorde; spectad!
bien rare dans ces lieux désolés par la tyrannie et l’arbitraire.
Toutefois les Qobtes ne sont pas exempts de vices : ces vices sont la conséfl
quence nécessaire de l’état d’avilissement où ils sont réduits sous le gouvernemeal
des Turcs. Obligés sans cesse de ramper et de feindre, la plupart ont contracta
des habitudes cupides et mercenaires. C ’est ici l’histoire de tous les peuples oppri
més : l’abrutissement est le résultat ordinaire de l’esclavage ( i ).
D u moins la liberté du culte leur reste. Mahomet, non moins profondpoli|
tique que fourbe adroit, iaissoit aux peuples qui s’étoient soumis à sa puissant*
le libre exercice de leur religion, ainsi que la faculté de se régir par leurs propre!
lois, sous l’influence des institutions musulmanes. Les khalifes imitèrent unecoal
duite si sage, et leurs successeurs ne s’en sont jamais écartés. C ’est peut-être 1
cette modération, plutôt encore qu’à la force de ses armes, que le législateur Arall
dut ses rapides succès. Qu oi qu’il en soit, les Qobtes, et en général tous les chrefl
tiens de l’Orient, jouissent des effets de sa politique; et les Mamlouks eux-mêira!
n’ont pu anéantir un privilège consacré par le temps, aussi-bien que par Itfl
maximes de leur religion.
(i) Ce qui fera sentir combien ces Qobtes sont mé~- plate, appliquée et roulée sur le tarbouch> à la tijow®
prbés par les musulmans, c’est que leur turban est réduit des yeux. Toutefois, lorsque les Qobtes se-rendent dan®
à une seule couleur, qui sert à les faire reconnoître de les provinces pour percevoir le tribut, ils échappent a«: ;
loin, et à les signaler, pour ainsi dire, au mépris de la po- insultes des musulmans, non-*seulement par Teffet aaAfl
pulace. Il ne leur est point permis de porter ce turban à longue habitude, mais encore parce qu’ils sontsouvwB
la manière des Mahométans : c’est une bande étroite et accompagnés d’une escorte. '
I
La nation Qobte reconnoît pour chef suprême, au spirituel comme au temporel.
un pontife qui, sous le titre de patriarche, est le premier personnage de
l’église. Son pouvoir n a d autres bornes que celles que lui imposent les usages
établis et la volonté des maîtres de la province. 11 prononce dans toutes les contestations
qui s’élèvent parmi ses administrés: mais son jugement n’est pas sans
appel; les parties peuvent, d’un commun accord, en référer au qâdy, qui maintient
ordinairement la sentence du patriarche. L e commandant du Kaire est aussi
compétent en cas d’appel; ce fonctionnaire réussit presque toujours à concilier les
différends. Les délits et ies crimes se traitent d’une autre manière : le patriarche
est encore le juge des crimes légers, qui n’entraînent qu’une peine correction-
pelle. Quand un Qobte, par exemple, se rend coupable de vol envers un musulman,
celui-ci porte plainte au patriarche; si, au contraire, le musulman est le
voleur, le Qobte l’açcuse devant le qâdy, qu bien il a recours à la justice du
commandant de la ville. Les parties Qobtes font elles-mêmes valoir leurs droits
devant les tribunaux.
Mais les assassinats et le jugement des grands crimes ne sont plus de la compétence
du tribunal du patriarche : il n’appartient qu’aux officiers chargés de la police
des villes de poursuivre et de châtier les grands coupables. Quelquefois le criminel
se soustrait a prix d argent au glaive de la justice, ainsi que cela se pratique
parmi les musulmans.
Le patriarche doit toujours être choisi parmi les religieux du couvent de Saint-
Antoine : il est électif. Lorsqu’on veut lui donner un successeur, les évêques et
¡es prêtres les plus considérés, réunis, s’adjoignent les notables de la nation :
l’assemblée générale se compose de quarante ou cinquante personnes ; alors on
procède à la nomination, et Je religieux qui obtient le plus grand nombre de
suffrages, est élevé à la dignité pontificale.
Les évêques tiennent le second rang dans la hiérarchie des honneurs parmi les
Qobtes : ces prélats, qui sont au nombre de douze, n’ont pour tout revenu que les
aumônes de leurs provinces. L ’église métropolitaine rapporte environ mille pataquès,
produit de quelques fondations pieuses qui lui sont annexées : cette petite
rente est 1 effectif de la fortune du patriarche; mais il trouve le moyen d’augmenter
ses honoraires par le casuei, qui monte quelquefois très-haut. Alexandrie est la
ville patriarcale; mais le pontife réside au Kaire, pour être plus à portée de protéger
son peuple, et de faire valoir ses droits devant l’autorité musulmane.
Les ecclésiastiques d’un rang inférieur jouissent aussi d’une grande considération;
mais ils sont pauvres et ignorans. Les réglemens de leur église leur permettent
davoir une femme; mais leur mariage doit précéder leur consécration,
et il ne leur est permis de se marier qu’une fois en leur vie. A la mort d’un curé
Qobte, ses principaux paroissiens se réunissent pour désigner à levêque de la
province 1 ecclésiastique qui leur semble le plus digne de succéder au défunt; le
prélat consacre aussitôt ce pasteur de leur choix. Toutes Jes églises sont la propriété
du clergé; elles sont entretenues parles aumônes et les quêtes.
Un Qobte se confie aveuglément aux prêtres de sa croyance ; ceux-ci exercent
ï