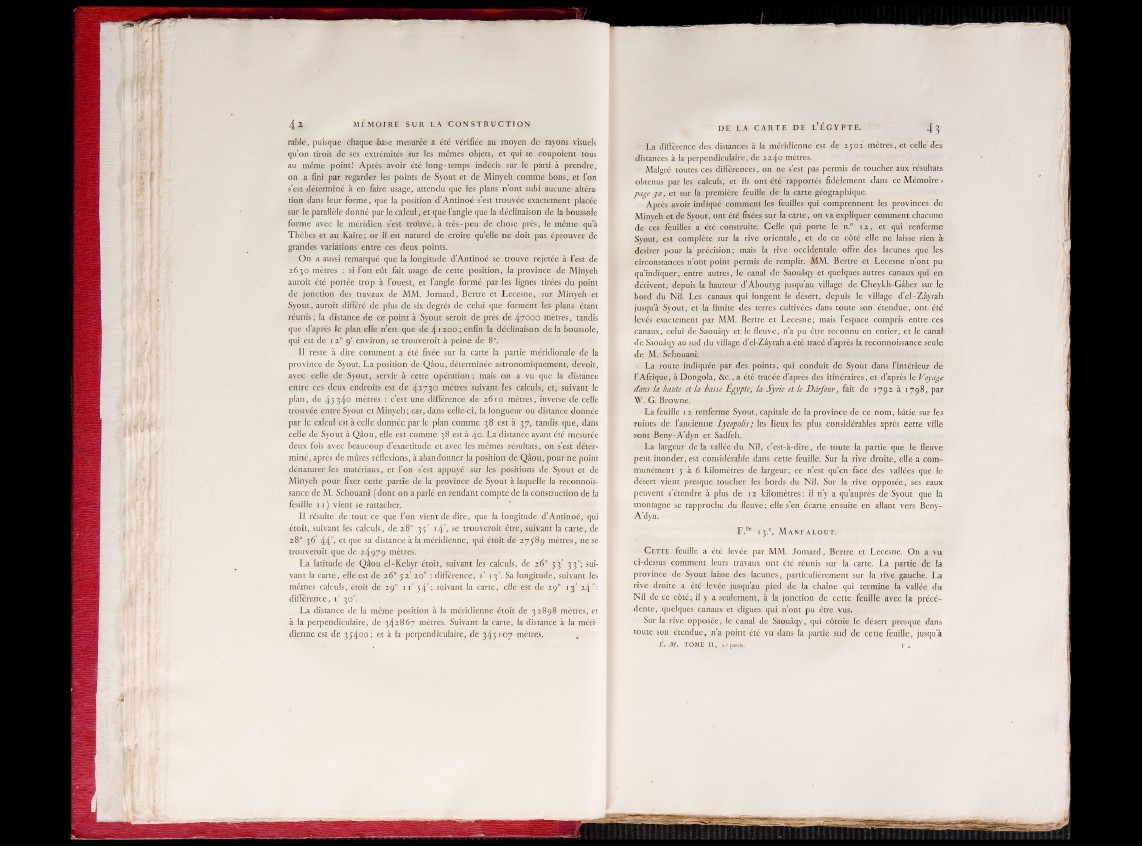
rable, puisque chaque hase mesurée a été vérifiée au moyen de rayons visuels
qu’on tiroit de ses extrémités sur les mêmes objets, et qui se coupoient tous
au même point! Après avoir été long-temps indécis sur le parti à prendre,
on a fini par regarder les points de Syout et de Minyeh comme bons, et l’on
s’est déterminé à en faire usage, attendu que les plans n’ont subi aucune altération
dans leur forme, que la position d’Antinoé s’est trouvée exactement placée
sur le parallèle donné par le calcul, et que l’angle que la déclinaison de la boussole
forme avec le méridien s’est troâivé, à très-peu de chose près, le même qu’à
Thèbes et au Kaire; or il est naturel de croire qu’elle nè doit pas éprouver de
grandes variations entre ces deux points.
On a aussi remarqué que la longitude d’Antinoé se trouve rejetée à l’est de
2630 mètres : si l’on eût fait usage de cette position, la province de Minyeh
auroit été portée trop à l’ouest, et l’angle formé par les lignes tirées du point
de jonction des travaux de MM. Jomard, Bertre et Lecesne, sur Minyeh et
Syout, auroit différé de plus de six degrés de celui que forment les plans étant
réunis ; la distance de ce point à Syout seroit de près de 47000 mètres, tandis
que d’après le plan elle n’est que de 4 1 200 ; enfin la déclinaison de la boussole,
qui est de 12° 9' environ, se trouveroit à peine de 8°.
Il reste à dire comment a été fixée sur la carte la partie méridionale de la
province de Syout. L a position de Qâou, déterminée astronomiquement, devoit,
avec celle de Syout, servir à cette opération ; mais on a vu que la distance
entre ces deux endroits est de 4 27 3 ° mètres suivant les calculs, et, suivant le
plan, de 4 j3 4 ° mètres : c’est une différence de 2610 mètres, inverse de celle
trouvée entre Syout et Minyeh ; car, dans celle-ci, la longueur ou distance donnée
par le calcul est à celle donnée par le plan comme 38 est à 37, tandis que, dans
celle de Syout à Qâou, elle est comme 38 est à 4o. La distance ayant été mesurée
deux fois avec beaucoup d’exactitude et avec les mêmes résultats, on s’est déterminé,
après de mûres réflexions, à abandonner la position de Qâou, pour ne point
dénaturer les matériaux, et l’on s’est appuyé sur les positions de Syout et de
Minyeh pour fixer cette partie de la province de Syout à laquelle la reconnois-
sance de M. Schouani ( dont on a parlé en rendant compte de la construction de la
feuille 1 1 ) vient se rattacher.
Il résulte de tout ce que l’on vient de dire, que la longitude d’Antinoé, qui
étoit, suivant les calculs, de 28e 35' i4 , se trouveroit être, suivant la carte, de
28° 36 44 > et flue sa distance à la méridienne, qui étoit de 27^89 mètres, ne se
trouveroit que de 24979 mètres.
La latitude de Qâou el-Kebyr étoit, suivant les calculs, de 26° 73 ' 33"; suivant
la carte, elle est de 26° 52’ 20“ : différence, i ’ 13 “. Sa longitude, suivant les
mêmes calculs, étoit de 29° 1 1 ' y 4 ” ; suivant la carte, elle est de 290 13' 2 4 ” :
différence, 1' 30”.
L a distance de la même position à la méridienne étoit de 32898 mètres, et
à la perpendiculaire, de 342867 mètres. Suivant la carte, la distance à la méridienne
est de 35400; et à la perpendiculaire, de 345 107 mètres.
La différence des : distances à la méridienne est de 2502 mètres, et celle'des
distances à la perpendiculaire, de 2240 mètres.
Malgré toutes ces différences, on ne s’est pas permis de toucher aux résultats
obtenus par les calculs, et ils ont été rapportés fidèlement dans ce Mémoire »
jpage y o , et sur la première feuille de la carte géographique.
Après avoir indiqué comment les feuilles qui comprennent les provinces de
Minyeh et de Syout, ont été fixées sur la carte, on va expliquer comment chacune
de ces feuilles a été construite. C e lle qui porte le n.° 12 , et qui renferme
Syout, est complète sur la rive orientale, et de ce côté elle ne laisse rien à
desirer pour la précision; mais la rive occidentale offre des lacunes que les
circonstances n’ont point permis de remplir. MM. Bertre et Lecesne n’ont pu
qu’indiquer, entre autres, le canal de Saouâqy et quelques autres canaux qui en
dérivent, depuis la hauteur d’Aboutyg jusqu’au village de Cheykh-Gâber sur le
bord du Nil. Les canaux qui longent le désert, depuis le village d’el-Zâyrah
jusqu’à Syout, et la limite des terres cultivées dans toute son étendue, ont été
levés exactement par MM. Bertre et Lecesne; mais l’espace compris entre ces
canaux, celui de Saouâqy et le fleuve, n’a pu être reconnu en entier, et le canal-
de Saouâqy au sud du village d’el-Zâyrah a été tracé d’après la reconnoissance seule
de M. Schouani.
: La route indiquée par des points, qui conduit de Syout dans l’intérieur de
l’Afrique, àDon gola , & c ., a été tracée d’après des itinéraires, et d’après le Voyage
dans la haute et la basse Egypte, la Syrie et le Dârfour, fait de 1792 à 179 8 , par
W. G. Browne.
L a feuille 12 renferme Syout, capitale de la province de ce nom, bâtie sur les
ruines de l’ancienne Lycopolis ; les lieux les plus considérables après cette ville
sont B eny-A’dyn et Sadfeh.
La largeur d e là vallée du Nil, c’est-à-dire, de toute la partie que le fleuve
peut inonder, est considérable dans cette feuille. Sur la rive droite, elle a communément
y à 6 kilomètres de largeur; ce n’est qu’en face des vallées que le
désert vient presque toucher les bords du Nil. Sur la rive opposée, ses eaux
peuvent s’étendre à plus de 12 kilomètres: il n’y a qu’auprès de Syout que la
montagne se rapproche du fleuve; elle s’en écarte ensuite en allant vers Beny-
A ’dyn.
F .Ilp 1 3 . ', M a n f a l o u t .
C e t t e feuille a été levée par MM. Jomard, Bertre et Lecesne. On a vu
ci-dessus comment leurs travaux ont été réunis sur la carte. La partie de la
province de Syout laisse des lacunes, particulièrement sur la rive gauche. La
rive droite a été levée jusqu’au pied de la chaîne qui termine la vallée du
Nil de ce côté; il y a seulement, à la jonction de cette feuille avec la précédente,
quelques canaux et digues qui n’ont pu être vus.
Sur la rive opposée, le canal de Saouâqy, qui côtoie le désert presque dans
toute son étendue, n’a point été vu dans la partie sud de cette feuille, jusqu’à
É . M, TOME II, 2.c partie. F î