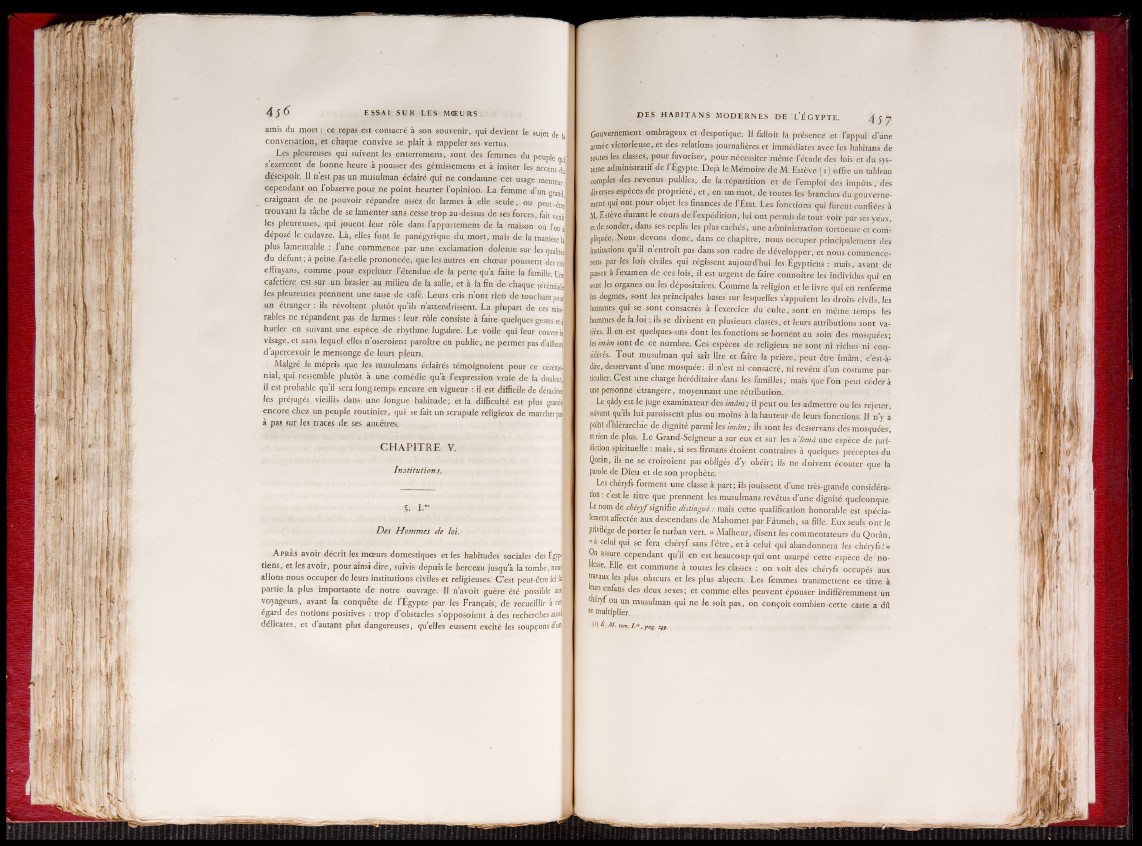
amis du mort : ce repas est consacré à son souvenir, qui devient ie sujet de | I
conversation, et chaque convive se plaît à rappeler ses vertus.
Les pleureuses qui suivent les enterremens, sont des femmes du peuple u ]
s exercent de bonne heure à pousser des gémissemens et à imiter les accens d jl
désespoir. Il n’est pas un musulman éclairé qui ne condamne cet usage menteur I
cependant on ¡observe pour ne point heurter l’opinion. L a femme d’un grandi
craignant de ne pouvoir répandre assez de larmes à elle seule, ou peut-étreB
trouvant la tâche de se lamenter sans cesse trop au-dessus de ses forces, fait veni V
les pleureuses, qui jouent leur rôle dans l’appartement de la maison où l’on J
déposé le cadavre. Là, elles font le panégyrique du mort, mais de la manière lal
plus lamentable : l’une commence par une exclamation dolente sur les qualités!
du défunt; à peine l’a-t-elle prononcée, que les autres en choeur poussent des c r i
effrayans, comme pour exprimer l’étendue de la perte qu’a faite la famille. Une!
cafetière est sur un brasier au milieu de la salle, et à la fin de chaque jérémiade!
les pleureuses prennent une tasse de café. Leurs cris n’ont rien de touchant p o l
un étranger : iis révoltent plutôt qu’ils n’attendrissent. L a plupart de ces mis !
rables ne répandent pas de larmes : leur rôle consiste à faire quelques gestes et i l
hurler en suivant une espèce de rhythme lugubre. L e voile qui leur couvre i l
visage, et sans lequel elles n’oseroient paroître en public, ne permet pas d’ailleul
d’apercevoir le mensonge de leurs pleurs.
Malgré le mépris que les musulmans éclairés témoignoient pour ce cérémol
niai, qui ressemble plutôt à une comédie qu’à l’expression vraie de la douleur,!
il est probable qu’il sera long temps encore en vigueur : il est difficile de déracine!
les préjugés vieillis dans une longue habitude; et la difficulté est plus grandi
encore chez un peuple routinier, qui se fait un scrupule religieux de marcher pai|
à pas sur les traces de ses ancêtres.
CHAPITRE V.
In stitu tion s.
S- I-"
D es Hommes de loi.
A p r è s avoir décrit les moeurs domestiques et les habitudes sociales des Égyp-J
tiens, et les avoir, pour ainsi dire , suivis depuis le berceau jusqu’à la tombe, nous!
allons nous occuper de leurs institutions civiles et religieuses. C ’est peut-être ici lal
partie la plus importante de notre ouvrage. U n’avoit guère été possible aux!
voyageurs, avant la conquête de l’Égypte par les Français, de recueillir à cell
égard des notions positives : trop d obstacles s’opposoient à des recherches aussi!
délicates, et d autant plus dangereuses, qu’elles eussent excité les soupçons d’uni
Gouvernement ombrageux et despotique. Il fklloit la présence et l’appui d’une
armee victorieuse, et des relations journalières et immédiates avec les habitans de
toutes les classes, pour favoriser, .pour nécessiter même letude des lois et du système
administratif de l’Égypte. Déjà le M émoire de M. Estève ( i ) offre un tableau
complet des revenus publics, de la répartition et de l’emploi des impôts, des
diverses especes de propriété, e t, en un mot, de toutes les branches du gouvernement
qui ont pour objet les finances de l’État. Les fonctions qui furent confiées à
M. Esteve durant le cours de 1 expédition, lui ont permis de tout voir par ses yeux,
et de sonder, dans ses replis les plus cachés, une administration tortueuse et compliquée.
Nous devons donc, dans ce chapitre, nous occuper principalement des
institutions quil n entroit pas dans son cadre de développer, et nous commencerons
par les lois civiles qui régissent aujoürdhui les Égyptiens : mais, avant de
passer à l’examen de ces lois, il est urgent de faire conuoître les individus qui en
sont les organes ou les dépositaires. Comme la religion et le livre qui en renferme
les dogmes, sont les principales bases sur lesquelles s’appuient les droits civils, les
hommes qui se sont consacrés à l’exercice du culte, sont en même temps’ les
hommes de la loi : ils se divisent en plusieurs classes, et leurs attributions sont variées.
Il en est quelques-uns dont les fonctions se bornent au soin des mosquées ;
les imâm sont de ce nombre. Ces espèces de religieux ne sont ni riches ni consideres.
Tout musulman qui sait lire et faire la prière, peut être imâm, c’est-à-
dire, desservant dune mosquée: il n’est ni consacré, ni revêtu d’un costume particulier,
C est une charge héréditaire dans les familles, mais que l’on peut céder à
une personne étrangère, moyennant une rétribution.
Le qâdy est le juge examinateur des imâm; il peut ou les admettre ou les rejeter,
suivant qu’ils lui paroissent plus ou moins à la hauteur de leurs fonctions. Il n’y a
point d’hiérarchie de dignité parmi les imâm; ils sont les desservans des mosquées,
et rien de plus. L e Grand-Seigneur a sur eux et sur les u'iemâ une espèce de juridiction
spirituelle : mais, si ses firmans étoient contraires à quelques préceptes du
Qoran, ils ne se croiroient pas obligés d’y obéir; ils ne doivent écouter que la
parole de Dieu et de son prophète.
Les chéryfs forment une classe à part; ils jouissent d’une très-grande considération:
c est le titre que prennent les musulmans revêtus d’une dignité quelconque.
Le nom de clicryf signifie distingué : mais cette qualification honorable est spécialement
affectée aux descendans de Mahomet par Fâuneh, sa fille. Eux seuls ont le
privilège de porter le turban vert. « Malheur, disent les commentateurs du Qorân,
»a celui qui se fera chéryf sans l’être, et à celui qui abandonnera les chéryfs!»
^ n assure cependant qu’il en est beaucoup qui ont usurpé cette espèce de n o blesse.
Elle est commune à toutes les classes : on voit des chéryfs occupés aux
fravaux les plus obscurs et les plus abjects. Les femmes transmettent ce titre à
eurs enfans des deux sexes; et comme elles peuvent épouser indifféremment un
cheryf ou un musulman qui ne le soit pas, on conçoit combien .cette caste a dû
se multiplier.
10 É . M . tout. /, 'r, p a g , 2 ÿ f .