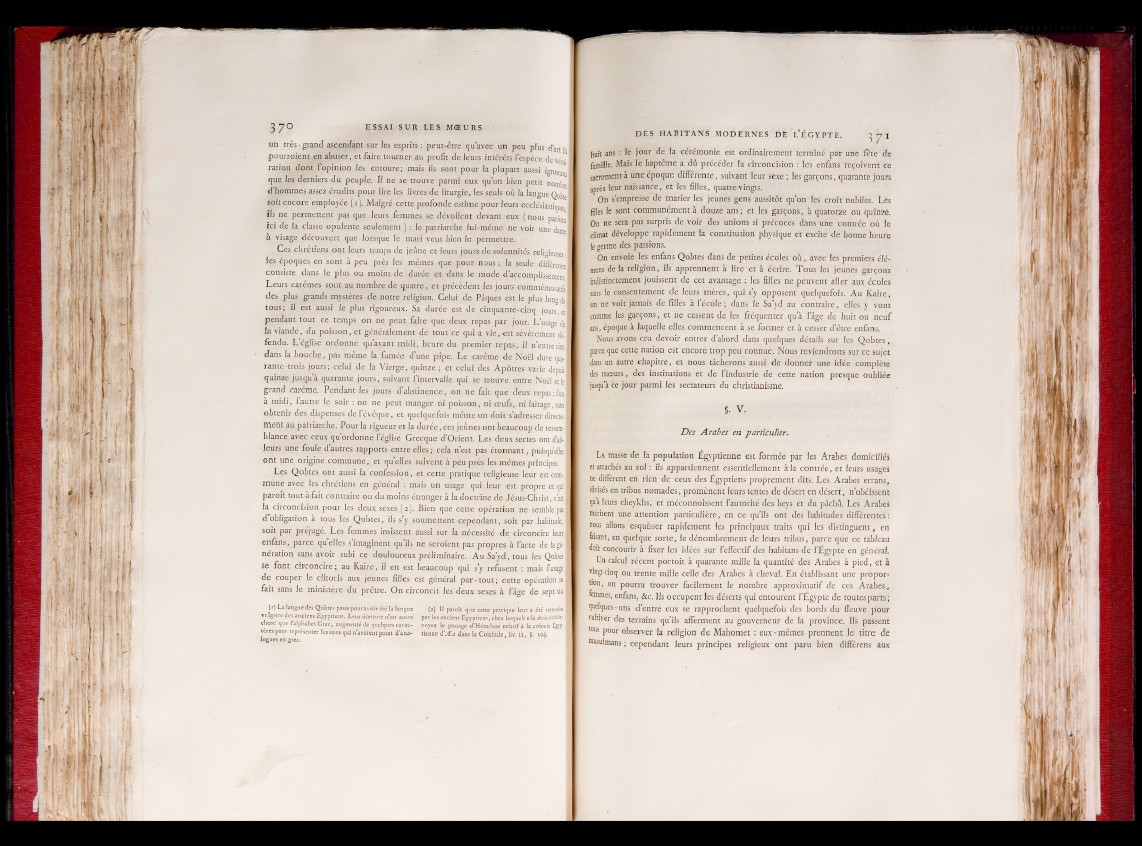
un très - grand ascendant sur ies esprits : peut-être qu’avec un peu plus r f’a r t jj
pourraient en abuser, et faire tourner.au profit de leurs intérêts l’espèce de véné
ration dont 1 opinion ies entoure; mais ils sont pour la plupart aussi ignora
que les derniers du peuple. Il ne se trouve parmi eux qu’un bien petit nomfo
d hommes assez érudits pour lire les livres de liturgie, les seuls où la langue Qofctt
soit encore employée ( i ). Malgré cette profonde estime pour leurs ecclésiastiques
ils ne permettent pas que leurs femmes se dévoilent devant eux (nous parlons!
ici de la classe opulente seulement ) : le patriarche lui-même ne voit une dame
a visage découvert que lorsque le mari veut bien le permettre.
Ces chrétiens ont leurs temps de jeûne et leurs jours de solennités religieuses■ J
les époques en sont à peu près les mêmes que pour nous ; la seule différence!
consiste dans le plus ou moins, de durée et dans le mode d’accomplissement I
Leurscarêmes sont au nombre de quatre, et précèdent les jours commémoratifs
des plus grands mystères de notre religion. Celui de Pâques est le plus long de!
tous; il est aussi le plus rigoureux. Sa durée est de cinquante-cinq jours,«!
pendant tout ce temps on ne peut faire que deux repas par jour. L ’usage de]
la viande, du poisson, et généralement de tout ce qui a v ie, est sévèrement dé-|
fendu. L é glise ordonne quavant midi, heure du premier repas, il n’entrerienj
dans la bouche, pas même la fumée d’une pipe. L e carême de Noël dure qua-|
rante-trois jours; celui de la Vierge, quinze; et celui des Apôtres varie depuisl
quinze jusqua quarante jours, suivant l’intervalle qui se trouve entre Noël et le I
grand carême. Pendant les jours d’abstinence, on ne fait que deux repas ; l’un I
■a midi, lautre le soir : on ne peut manger ni poisson, ni oeufs, ni laitage, sans J
obtenir des dispenses de I évêque, et quelquefois même on doit s’adresser directe-1
ment au patriarche. Pour la rigueur et la durée, ces jeûnes ont beaucoup de ressem-|
blance avec ceux qu ordonne 1 eglise Grecque d Orient. Les deux sectes ont d’ail-1
leurs une foule d autres rapports entre elles ; cela n’est pas étonnant, puisqu’elles ]
ont une origine commune, et qu’elles suivent à peu près les mêmes principes. |
Les Qobtes ont aussi la confession, et cette pratique religieuse leur estcom-1
mune avec ies chrétiens en général : mais un usage qui leur est propre et qui J
paraît tout-à-fait contraire ou du moins étranger à la doctrine de Jésus-Christ, c’estI
la circoncision pour les deux sexes (2). Bien que cette opération ne semble pas I
d obligation a tous les Qobtes, ils s y soumettent cependant, soit par habitude, j soit par préjugé. Les femmes insistent aussi sur la nécessité de circoncire leurs J
enfans, parce quelles s imaginent qu ils ne seraient pas propres à l’acte de lagé-l
nération sans avoir subi ce douloureux préliminaire. A u Sa’yd , tous les Qobtes 1
se font ■ circoncire ; au Kaire, il en est beaucoup qui s’y refusent : mais l’usage I
de couper le clitoris aux jeunes filles est général p a r-tou t; cette opération sel
fait sans le ministère du prêtre. O n circoncit les deux sexes à l’âge de sept ou I
( l) La langue des Qobtes passepournvoir été la langue (2) I! paroit que cette pratique leur a été transmise ■
vulgaire des anciens Égyptiens. Leur écriture n'est autre par les anciens Égyptiens, chez lesquels elle étoii établit: I
chose que l'alphabet G re c, augmenté de quelques carac- voyez le passage d’Hérodote relatif à la colonie Égyp- I
tères pour représenter les sons qui n'avoientpoint d'anà- tienne A'Æa d a n s la C olchide, Hv. I I , S- l°-f-
lo g u e s en grec.
¡mit ans : le jour de la cérémonie est ordinairement terminé par une fête de
famille. Mais le bapteme a dû précéder la circoncision : les enfans reçoivent Ce
sa c rem en t-à une epoque différente, suivant leur sexe; les garçons, quarante jours
après leur naissance, et les.filles, quatre-vingts.
On s’empresse de marier les jeunes gens aussitôt qu’on les croit nubiles. Lès
filles le sont communément à douze ans; et les garçons, à quatorze ou quinze.
On ne sera pas surpris de voir des unions si précoces dans une contrée où le
climat développe rapidement la constitution physique et excite de bonne heure
le germe des passions.
On envoie les enfans Qobtes dans de petites écoles o ù , avec les premiers élé-
mens de la religion, ils apprennent à lire et à écrire. Tous les jeunes garçons
indistinctement jouissent de cet avantage : les filles ne peuvent aller aux écoles
sans le consentement de leurs mères, qui s’y opposent quelquefois. A u Kaire,
on ne voit jamais de filles à l’école ; dans le Sa’yd au contraire, elles y vont
comme les garçons, et ne cessent de les fréquenter qu’à lage de huit ou neuf
ans, époque à laquelle elles commencent à se former et à cesser detre enfans.
Nous avons cru devoir entrer d’abord dans quelques détails sur les Q o b te s ,
parce que cette nation est encore trop peu connue. Nous reviendrons sur ce sujet
dans un autre chapitre, et nous tâcherons aussi de donner une idée complète
des moeurs, des institutions et de l’industrie de cette nation presque oubliée
jusqu’à ce jour parmi les sectateurs du christianisme.
§- v.
D es A ra bes en particulier.
L a masse de la population Egyptienne est formée par les Arabes domiciliés
et attachés au sol : ils appartiennent essentiellement à la contrée, et leurs usages
ne diffèrent en rien de ceux des Egyptiens proprement dits. Les Arabes errans,
divisés en tribus nomades, promènent leurs tentes de désert en désert, n’obéissent
qu’à leurs cheykhs, et méconnoissent l’autorité des beys et du pâchâ. Les Arabes
méritent une attention particulière, en ce qu’ils ont des habitudes différentes:
nous allons esquisser rapidement les principaux traits qui les distinguent, en
feisant, en quelque sorte, le dénombrement de leurs tribus, parce que ce tableau
doit concourir à fixer les idées sur l’effectif des habitans de l’Égypte en général.
Un calcul récent portoit à quarante mille la quantité des Arabes à pied, et à
vingt-cinq ou trente mille celle des Arabes à cheval. En établissant une proportion,
on pourra trouver facilement le nombre approximatif de ces Arabes,
femmes, enfans, & c. Ils occupent les déserts qui entourent l’Égypte de toutes parts;
quelques-uns d’entre eux se rapprochent quelquefois des bords du fleuve pour
cultiver des terrains qu’ils afferment au gouverneur de la province. Ils passent
tous pour observer la religion de Mahomet : eux-mêmes prennent le titre de
musulmans ; cependant leurs principes religieux ont paru bien différens aux