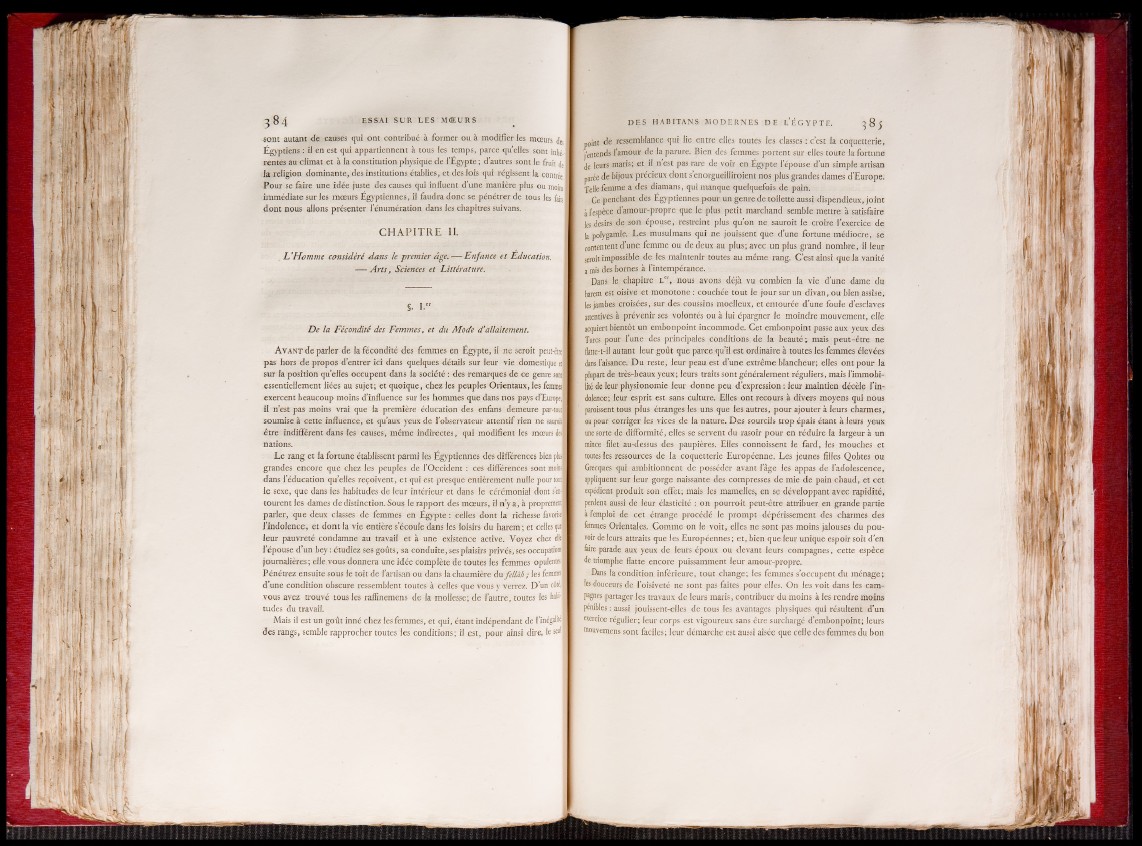
sont autant de causes qui ont contribué à former ou à modifier les moeurs Jj,
Égyptiens : il en est qui appartiennent à tous les temps, parce quelles sont inhé-
rentes au climat et à la constitution physique de l’Égypte ; d’autres sont le f r u i t de
la religion dominante, des institutions établies, et des lois qui régissent la contrée
Pour se faire une idée juste des causes qui influent d’une manière plus ou moins
immédiate sur les moeurs Égyptiennes, il faudra donc se pénétrer de tous les faits
dont nous allons présenter l’énumération dans les chapitres suivans.
CH A P ITR E II.
L ’Homme considéré d ans le premier â g e.-— E n fan ce et Education.
— A r ts , Sciences et L ittérature.
§. I ."
D e la Fécondité des Fem m es, et du M ode d ’allaitement.
A v a n t de parler de la fécondité des femmes en Égypte, il ne seroit peut-êtrel
pas hors de propos d’entrer ici dans quelques détails sur leur vie domestique et!
sur la position qu’elles occupent dans la société : des remarques de ce genre sont!
essentiellement liées au sujet; et quoique, chez les peuples Orientaux, les femmesl
exercent beaucoup moins d’influence sur les hommes que dans nos pays d’Europe,!
il n’est pas moins vrai que la première éducation des enfans demeure par-toiij
soumise à cette influence, et qu’aux yeux de l’observateur attentif rien ne sauroitl
être indifférent dans les causes, même indirectes, qui modifient les moeurs des!
nations.
L e rang et la fortune établissent parmi les Égyptiennes des différences bien plus!
grandes encore que chez les peuples de l’Occident : ces différences sont moins!
dans l’éducation qu’elles reçoivent, et qui est presque entièrement nulle pourtouil
le sexe, que dans les habitudes de leur intérieur et dans le cérémonial dont s’e i l
tourent les dames de distinction. Sous le rapport des moeurs, il n’y a , à proprement!
parler, que deux classes de femmes en Égypte : celles dont la richesse favoris«
l ’indolence, et dont la vie entière s’écoule dans les loisirs du harem ; et celles quel
leur pauvreté condamne au travail et à une existence active. Voyez chez elle!
l’épouse d’un bey : étudiez ses goûts, sa conduite, ses plaisirs privés, ses occupations!
journalières; elle vous donnera une idée complète de toutes les femmes opulentes!
Pénétrez ensuite sous le toit de l’artisan ou dans la chaumière du fella h ; les femmes!
d’une condition obscure ressemblent toutes à celles que vous y verrez. D ’un côte!
vous avez trouvé tous les raffinemens de la mollesse; de l’autre, toutes les hati-l
tudes du travail.
Mais il est un goût inné chez les femmes, et qui, étant indépendant de l’inégalite|
des rangs, semble rapprocher toutes les conditions; il est, pour ainsi dire, le seul!
point de ressemblance qui lie entre elles toutes les classes : c’est la coquetterie,
j’e n te n d s l’amour de la parure. Bien des femmes portent sur elles toute la fortune
de leurs maris; et il n est pas rare de voir en Égypte l’épouse d’un simple artisan
parée de bijoux précieux dont s enorgueilliroient nos plus grandes dames d’Europe.
T e l l e femme a des diamans, qui manque quelquefois de pain.
Ce penchant des Égyptiennes pour un genre de toilette aussi dispendieux, joint
à l’espèce d’amour-propre que le plus petit marchand semble mettre à satisfaire
les désirs de son épouse, restreint plus qu’on ne saurait le croire l’exercice de
la polygamie. Les musulmans qui ne jouissent que d’une fortune médiocre, se
contentent d’une femme ou de deux au plus; avec un plus grand nombre, il leur
seroit impossible de les maintenir toutes au même rang. C ’est ainsi que la vanité
a mis des bornes à l’intempérance.
Dans le chapitre i.er, nous avons déjà vu combien la vie d’une dame du
harem est oisive et monotone ; couchée tout le jour sur un divan, ou bien assise,
les jambes croisées, sur des coussins moelleux, et entourée d’une foule d’esclaves
attentives à prévenir ses volontés ou à lui épargner le moindre mouvement, elle
acquiert bientôt un embonpoint incommode. C e t embonpoint passe aux yeux des
Turcs pour l’une des principales conditions de la beauté; mais peut-être ne
flatte-t-il autant leur goût que parce qu’il est ordinaire à toutes les femmes élevées
dans l’aisance. Du reste, leur peau est d’une extrême blancheur; elles ont pour la
plupart de très-beaux yeux; leurs traits sont généralement réguliers, mais l’immobilité
de leur physionomie leur donne peu d’expression ; leur maintien décèle l’indolence
; leur esprit est sans culture. Elles ont recours à divers moyens qui nous
paroissent tous plus étranges les uns que les autres, pour ajouter à leurs charmes,
ou pour corriger les vices de la nature. Des sourcils trop épais étant à leurs yeux
une sorte de difformité, elles se servent du rasoir pour en réduire la largeur à un
mince filet au-dessus des paupières. Elles connoissent le fard, les mouches et
toutes les ressources de la coquetterie Européenne. Les jeunes filles Qobtes ou
Grecques qui ambitionnent de posséder avant l’âge les appas de l’adolescence,
appliquent sur leur gorge naissante des compresses de mie de pain chaud, et cet
expédient produit son effet; mais les mamelles, en se développant avec rapidité,
perdent aussi de leur élasticité : on pourroit peut-être attribuer, en grande partie
1 l’emploi de cet étrange procédé le prompt dépérissement des charmes des
femmes Orientales. Comme on le voit, elles ne sont pas moins jalouses du pouvoir
de leurs attraits que les Européennes; et, bien que leur unique espoir soit d’en
faire parade aux yeux de leurs époux ou devant leurs compagnes, cette espèce
de triomphe flatte encore puissamment leur amour-propre.
Pans la condition inférieure, tout change; les femmes s’occupent du ménage;
lés douceurs de l’oisiveté ne sont pas faites pour elles. On les voit dans les campagnes
partager les travaux de leurs maris, contribuer du moins à les rendre moins
pénibles : aussi jouissent-elles de tous les avantages physiques qui résultent d’un
exercice régulier; leur corps est vigoureux sans être surchargé d’embonpoint; leurs
mouvemens sont faciles; leur démarche est aussi aisée que celle des femmes du bon