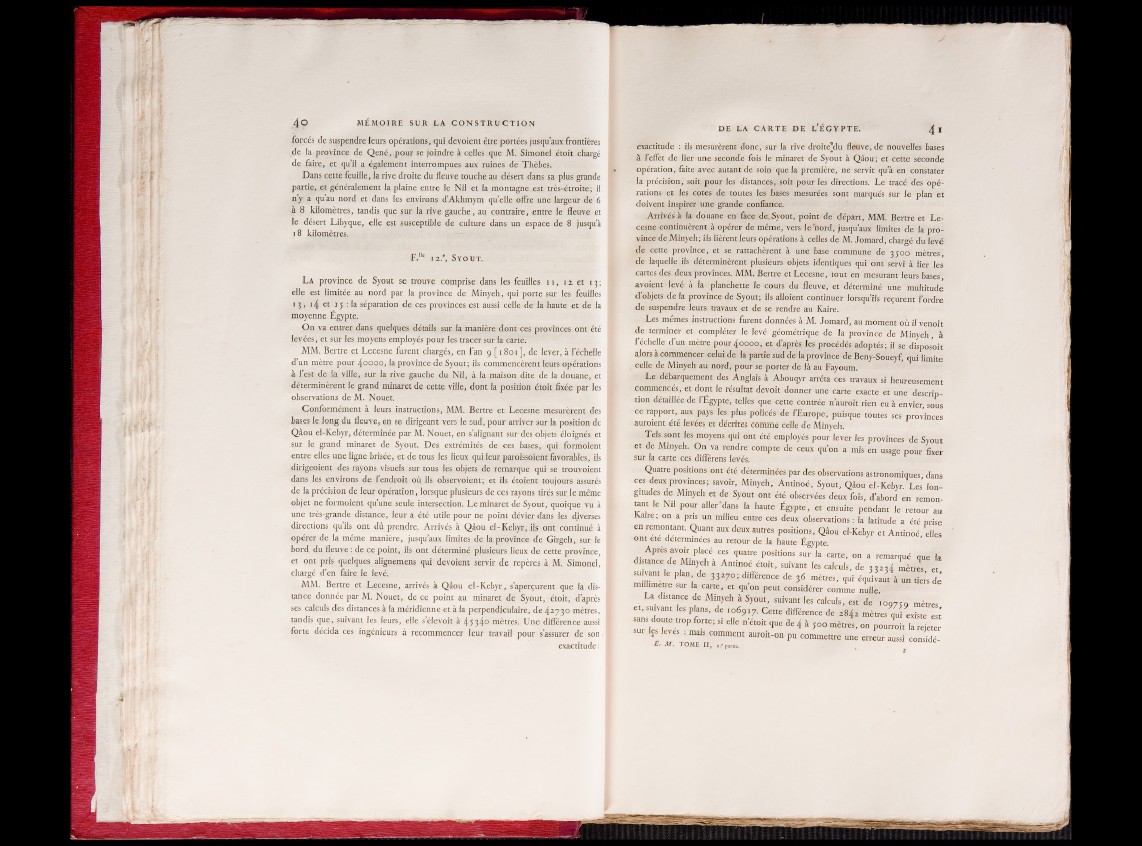
forcés de suspendre leurs opérations, qui de voient être portées jusqu’aux frontières
de la province de Q en é , pour se joindre à celles que M. Simonel étoit chargé
de faire, et qu’il a également interrompues aux ruines de Thèhes.
Dans cette feuille, la rive droite du fleuve touche au désert dans sa plus grande
partie, et généralement la plaine entre le Nil et la montagne est très-étroite; il
n y a qu au nord et dans les environs d’Akhmym qu’elle offre une largeur de 6
a 8 kilomètres, tandis que sur la rive gauche, au contraire, entre le fleuve et
le désert Libyque, elle est susceptible de culture dans un espace de 8 jusqu’à
18 kilomètres.
F."' i2.', S y o u t .
L a province de Syout se trouve comprise dans les feuilles 1 1 , 1 1 et 13;
elle est limitée au nord par la province de Minyeh, qui porte sur les feuilles
13 , 14 et 1 y : la séparation de ces provinces est aussi celle de la haute et de la
moyenne Egypte.
O n va entrer dans quelques détails sur la manière dont ces provinces ont été
levées, et sur les moyens employés pour les tracer sur la carte.
MM. Bertre et Lecesne furent chargés, en l’an 9 [ 1801 ], de lever, à l’échelle
d’un mètre pour 4° o o o , la province de Syout; ils commencèrent leurs opérations
à 1 est de la ville, sur la rive gauche du Nil, à la maison dite de la douane, et
déterminèrent le grand minaret de cette ville, dont la position étoit fixée par les
observations de M. Nouet.
Conformément à leurs instructions, MM. Bertre et Lecesne mesurèrent des
bases le long du fleuve, en se dirigeant vers le sud, pour arriver sur la position de
Qâou el-Kebyr, déterminée par M. Nouet, en s’alignant sur des objets éloignés et
sur le grand minaret de Syout. Des extrémités de ces bases, qui formoient
entre elles une ligne brisée, et de tous les lieux qui leur paroissoient favorables, ils
dirigeoient des rayons visuels sur tous les objets de remarque qui se trouvoient
dans les environs de l’endroit où ils observoient; et ils étoient toujours assurés
de la précision de leur opération, lorsque plusieurs de ces rayons tirés sur le même
objet ne formoient qu’une seule intersection. L e minaret de Syout, quoique vu à
une très-grande distance, leur a été utile pour ne point dévier dans les diverses
directions qu’ils ont dû prendre. Arrivés à Qâou el-Kebyr, ils ont continué à
opérer de la même manière, jusqu’aux limites de la province de Girgeh, sur le
bord du fleuve : de ce point, ils ont déterminé plusieurs lieux de cette province,
et ont pris quelques alignemens qui de voient servir de repères à M. Simonel,
chargé d’en faire le levé.
MM. Bertre et Lecesne, arrivés à Qâou el-Kebyr, s’aperçurent que la distance
donnée par M. Nouet, de ce point au minaret de Syout, étoit, d’après
ses calculs des distances à la méridienne et à la perpendiculaire, de 42730 mètres,
tandis que, suivant les leurs, elle sélevoit à 4534° mètres. Une différence aussi
forte décida ces ingénieurs à recommencer leur travail pour s’assurer de son
exactitude :
exactitude : ils mesurèrent donc, sur la rive droiteMu fleuve, de nouvelles bases
à l’effet de lier une seconde fois le minaret de Syout à Qâou; et cette seconde
opération, faite avec autant de soin que la première, ne servit qu’à en constater
la précision, soit pour les distances, soit pour les directions. L e tracé des opérations
et les cotes de toutes les bases mesurées sont marqués sur le plan et
doivent inspirer une grande confiance.
Arrivés à la douane en face de. Syout, point de départ, MM. Bertre et L e cesne
continuèrent à opérer de même, vers le nord, jusqu’aux limites de la province
de Minyeh; ils lièrent leurs opérations à celles de M. Jomard, chargé du levé
de cette province, et se rattachèrent à une base commune de 3500 mètres,
de laquelle ils déterminèrent plusieurs objets identiques qui ont servi à lier les
canes des deux provinces. MM. Bertre et Lecesne, tout en mesurant leurs bases
avoient levé à la planchette le cours du fleuve, et déterminé une multitude
d’objets de la province de Syout; ils alloient continuer lorsqu’ils reçurent l’ordre
de suspendre leurs travaux et de se rendre au Kaire.
Les mêmes instructions furent données à M. Jomard, au moment où il venoit
de terminer et compléter le levé géométrique de la province de Minyeh, à
l’échelle d’un mètre pour 40000, et d’après les procédés adoptés; il se disposoit
alors à commencer celui de la partie sud de la province de Beny-Soueyf, qui limite
celle de Minyeh au nord, pour se porter de là au Fayoum.
L e débarquement des Anglais à Abouqyr arrêta ces travaux si heureusement
commencés, et dont le résultat devoit donner une carte exacte et une description
détaillée de 1 Égypte, telles que cette contrée n’auroit rien eu à envier, sous
ce rapport, aux pays les plus policés de l’Europe, puisque toutes ses provinces
auroient été levées et décrites comme celle de Minyeh.
Tels sont les moyens qui ont été employés pour lever les provinces de Syout
et de Minyeh. On va rendre compte de ceux qu’on a mis en usage pour fixer
sur la carte ces différens levés.
Quatre positions ont été déterminées par des observations astronomiques, dans
ces deux provinces; savoir, Minyeh, An tin oé , Syout, Qâou el-Kebyr. Les longitudes
de Minyeh et de Syout ont été observées deux fois, d’abord en remontant
le Nil pour aller‘ dans la haute Égypte , et ensuite pendant le retour au
Kaire; on a pris un milieu entre ces deux observations : la latitude a été prise
en remontant. Quant aux deux autres positions, Qâou el-Kebyr e t Antinoé elles
ont ete déterminées au retour de la haute Égypte.
Après avoir placé ces quatre positions sur la carte, on a remarqué que la
distance de Minyeh a Antinoé étoit, suivant les calculs, de 33234 mètres et
suivant e plan de 33270; différence de 36 mètres, qui é q u i L i à un f e s de
millimétré sur la carte, et quon peut considérer comme nulle.
L a distance de Minyeh à Syout, suivant les calculs, est de ,0 9 7 3 9 mètres
et, suivant les plans, de 106917. Cette différence de 2842 mètres ^ e x i s t e i
r . * r ' rop ° * ° ' ,o,‘ • *< * * »mè*” -« * j u r i £
1 es eyes mai: comment auroit-on pu commettre une erreur aussi considé-
£ . M. TOME II. a.e partie
F