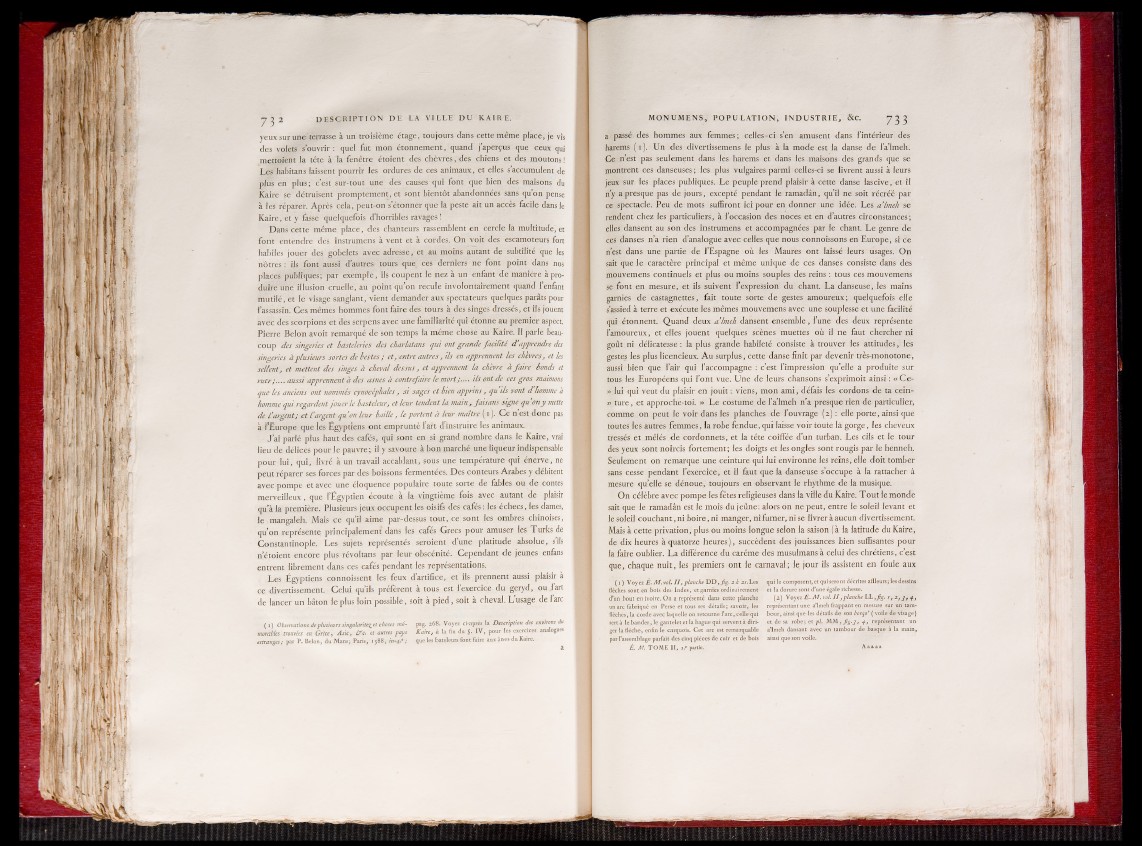
yeux sur une terrasse à un troisième étage, toujours dans cette même place, je vis
des volets s’ouvrir : quel fut mon étonnement, quand j’aperçus que ceux qui
mettoient la tête à la fenêtre étoient des chèvres, des chiens et des moutons !
Les habitans laissent pourrir les ordures de ces animaux, et elles s’accumulent de
plus en plus; c’ est sur-tout une des causes qui font que bien des maisons du
Kaire se détruisent promptement, et sont bientôt abandonnées sans qu’on pense
à les réparer. Après cela, peut-on s’étonner que la peste ait un accès facile dans le
Kaire, et y fasse quelquefois d’horribles ravages î
Dans cette même place, des chanteurs rassemblent en cercle la multitude; et
font entendre des instrumens à vent et à cordes. On voit des escamoteurs fort
habiles jouer des gobelets avec adresse, et au moins autant de subtilité que les
nôtres : ils font aussi d’autres tours que ces derniers ne font point dans nos
places publiques; par exemple, ils coupent le nez à un enfant de manière à produire
une illusion cruelle, au point qu’on recule involontairement quand l’enfant
mutilé, et le visage sanglant, vient demander aux spectateurs quelques parâts pour
l’assassin. Ces mêmes hommes font faire des tours à des singes dresses, et ils jouent
avec des scorpions et des serpens avec une familiarité qui étonne au premier aspect.
Pierre Belon avoit remarqué de son temps la même chose au Kaire. Il parle beaucoup
des singeries et bdsteleries des charlatans qui ont grande facdité d apprendre des
singeries à plusieurs sortes de bestes; et, entre autres, ils en apprennent les chèvres, et les
sellent, et mettent des singes h cheval dessus, et apprennent la chèvre à faire bonds et
ruer;.... aussi apprennent h des asnes à contrfaire le mort;.... ils ont de ces gros maimons
que les anciens ont nommés cynocéphales, si sages et bien apprins, qu ils vont d homme à
homme qui regardent jouer le basteleur, et leur tendent la main, faisans signe qu on y mette
de l ’argent; et l ’argent qu’on leur baille, le portent à leur maître ( i ). Ce n est donc pas
à l’Europe que les Égyptiens ont emprunte la it d instruire les animaux.
J’ai parlé plus haut des cafés, qui sont en si grand nombre dans le Kaire, vrai
lieu de délices pour le pauvre; il y savoure à bon marché une liqueur indispensable
pour lui, qui, livré à un travail accablant, sous une température qui énerve, ne
peut réparer ses forces par des boissons fermentées. Des conteurs Arabes y débitent
avec pompe et avec une éloquence populaire toute sorte de fables ou de contes
merveilleux, que l’Égyptien écoute à la vingtième fois avec autant de plaisir
qu’à la première. Plusieurs jeux occupent les oisifs des cafés : les échecs, les dames,
le mangaleh. Mais ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les ombres chinoises,
qu’on représente principalement dans les cafés Grecs pour amuser les Turks de
Constantinople. Les sujets représentés seroient d’une platitude absolue, s’ils
n’étoient encore plus révoltans par leur obscénité. Cependant de jeunes enfàns
entrent librement dans ces cafés pendant les représentations.
Les Égyptiens connoissent les feux d’artifice, et ils prennent aussi plaisir à
ce divertissement. Celui qu’ils préfèrent à tous est l’exercice du geryd, ou .l’art
de lancer un bâton le plus loin possible, soit a pied, soit a cheval. L usage de lare
( I ) Observations de plusieurs singulàriteiet choses mé- pag. 268. Voyez ci-après la Description des environs du
rnoribles trouvées en Grèce, Asie, tfc. et autres pays Kaire, à la fin du S- IV , pour les exercices analogues
estranges; par P. Belon, du Mans; Paris, 1588, in-;.’ ; que les bateleurs font faire aux ânes du Kaire.
a passé des hommes aux femmes; celles-ci s’en amusent dans l’intérieur des
harems ( i) . Un des divertissemens le plus à la mode est la danse de l’a’lmeh.
Ce n’est pas seulement dans les harems et dans les maisons des grands que se
montrent ces danseuses ; les plus vulgaires parmi celles-ci se livrent aussi à leurs
jeux sur les places publiques. L e peuple prend plaisir à cette danse lascive, et il
n’y a presque pas de jours, excepté pendant le ramadan, qu’il ne soit récréé par
ce spectacle. Peu de mots suffiront ici pour en donner une idée. Les a ’imeh se
rendent chez les particuliers, à l’occasion des noces et en d’autres circonstances;
elles dansent au son des instrumens et accompagnées par le chant. Le genre de
ces danses n’a rien d’analogue avec celles que nous connoissons en Europe, si ce
n’est dans une partie de l’Espagne où les Maures ont laissé leurs usages. On
sait que le caractère principal et même unique de ces danses consiste dans des
mouvemens continuels et plus ou moins souples des reins : tous ces mouvemens
se font en mesure, et ils suivent l’expression du chant. La danseuse, les mains
garnies de castagnettes, fait toute sorte de gestes amoureux; quelquefois elle
s’assied à terre et exécute les mêmes mouvemens avec une souplesse et une facilité
qui étonnent. Quand deux a ’imeh dansent ensemble, l’une des deux représente
l’amoureux, et elles jouent quelques scènes muettes où il ne faut chercher ni
goût ni délicatesse : la plus grande habileté consiste à trouver les attitudes, les
gestes les plus licencieux. A u surplus, cette danse finit par devenir très-monotone,
aussi bien que l’air qui l’accompagne : c’est l’impression qu’elle a produite sur
tous les Européens qui l’ont vue. Une de leurs chansons s’exprimoit ainsi : « C e -
» lui qui veut du plaisir en jouit : viens, mon ami, défais les cordons de ta cein-
» tu re , et approche-toi. » L e costume de l’a’lmeh n’a presque rien de particulier,
comme on peut le voir dans les planches de l’ouvrage (2) : elle porte, ainsi que
toutes les autres femmes, la robe fendue, qui laisse voir toute la go rge , les cheveux
tressés et mêlés de cordonnets, et la tête coiffée d’un turban. Les cils et le tour
des yeux sont noircis fortement; les doigts et les ongles sont rougis par le henneh.
Seulement on remarque une ceinture qui lui environne les reins, elle doit tomber
sans cesse pendant l’exercice, et il faut que la danseuse s’occupe à la rattacher à
mesure qu’elle se dénoue, toujours en observant le rhythme de la musique.
O n célèbre avec pompe les fêtes religieuses dans la ville du Kaire. T o u t le monde
sait que le ramadân est le mois du jeûne : alors on ne peut, entre le soleil levant et
le soleil couchant, ni boire, ni manger, ni fumer, ni se livrer à aucun divertissement.
Mais à cette privation, plus ou moins longue selon la saison ( à la latitude du Kaire,
de dix heures à quatorze heures ) , succèdent des jouissances bien suffisantes pour
la faire oublier. La différence du carême des musulmans à celui des chrétiens, c’est
que, chaque nuit, les premiers ont le carnaval; le jour ils assistent en foule aux
( 1 ) Voyez È. M.vol. I I , planche D D , fig. z à 21. Les qui le composent, et qui seront décrites ailleurs; les dessins
flèches sont en bois des Indes, et garnies ordinairement et la dorure sont d’une égale richesse,
d’un bout en ivoire. On a représenté dans cette planche (2) Voyez É. M . vol. I I , planche L L ,fig. /, 2,3,4.,
un arc fabriqué en Perse et tous ses détails ; savoir, les représentant une a’imeh frappant en mesure sur un tam-
flèches, la corde avec laquelle on rétourne l’arc, celle qui bour, ainsi que les détails de son borqo’ ( voile de visage)
sert à le bander, le gantelet et la bague qui servent à diri- et de sa robe; et pl. MM, fig-f > 4> représentant un
ger la flèche, enfin le carquois. Cet arc est remarquable a’imeh dansant avec un tambour de basque à la main,
par l’assemblage parfait des cinq pièces de cuir et de bois ainsi que son voile.
É. M . TOME II, 2.6 partie. Aaaaa